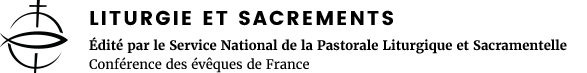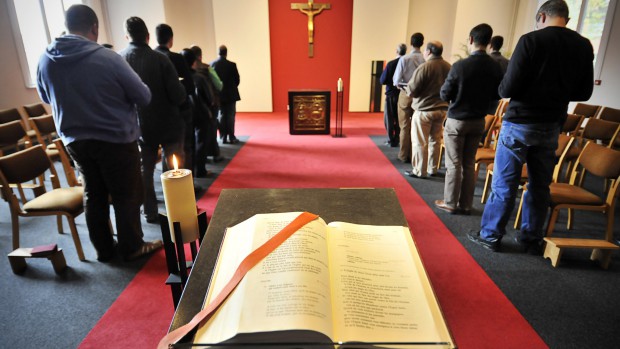Accomplissement des écritures et liturgie dominicale
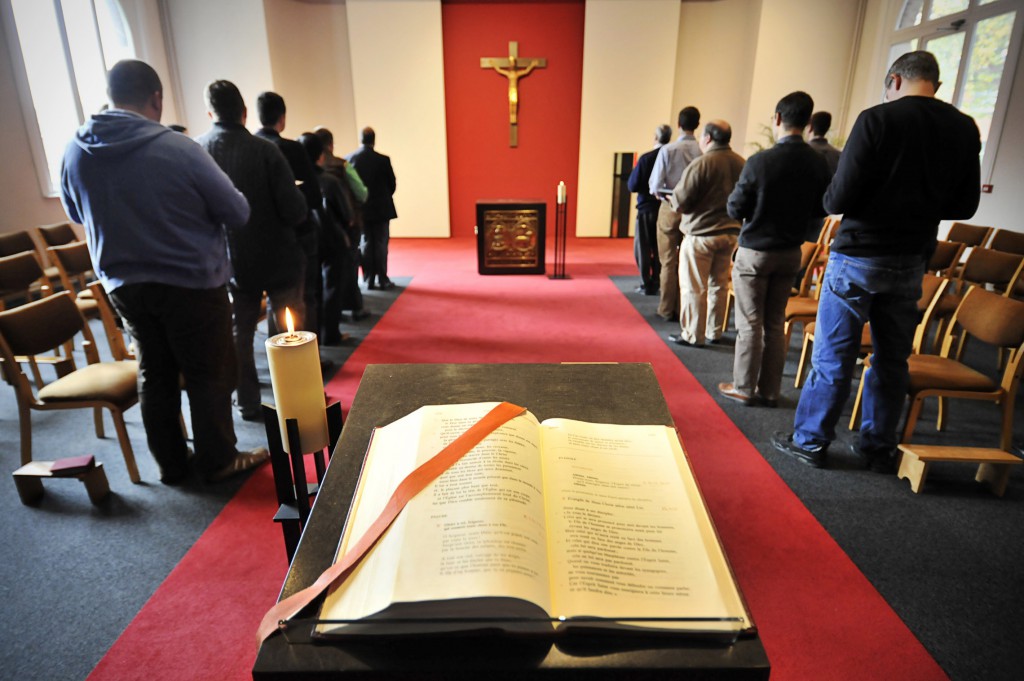 Par Yves-Marie Blanchard, Prêtre exégète, spécialisé dans les écrits johanniques, il est professeur à l’ISL.
Par Yves-Marie Blanchard, Prêtre exégète, spécialisé dans les écrits johanniques, il est professeur à l’ISL.
« Accomplir les Écritures : depuis quelques années, cette formule attire et inquiète. » Présentant en ces termes le deuxième volume du grand œuvre de Paul Beauchamp, L’Un et l’Autre Testament : 2. Accomplir les Écritures, l’éditeur souligne la difficulté d’aborder un motif, dont on pressent par ailleurs l’intérêt, voire l’actualité, eu égard aux nouvelles perspectives affectant la théologie biblique.
Une question difficile
Cet embarras se confirme quand on considère le petit nombre d’études, au moins en langue française, consacrées à une question pourtant pressentie comme essentielle. Ainsi, depuis l’ouvrage de Pierre-Marie Beaude, justement intitulé L’Accomplissement des Écritures et principale ment consacré à « l’histoire des systèmes de représentation de l’idée d’accomplissement», il n’y a guère que Paul Beauchamp pour être incessamment revenu sur notre notion centrale, dans le cadre d’une herméneutique attachée à l’ensemble du corpus biblique, considéré du point de vue de la totalité du livre dans son état achevé. L’accomplissement y est présenté comme « le travail de l’Un qui fait converger les figures vers un centre transcendant ».
Les critères principaux de la figure, au nombre de cinq (centralité, répétitivité, corporéité, déficience, choix de liberté) trouvent dans le « mystère » christique le centre qui tout à la fois les achève et les transcende, dans une épiphanie du sens, portant la corporéité à l’invisible et faisant de la déficience le lieu de l’excès. Une telle affirmation suppose le « franc-parler », la « parrhêsia » du Nouveau Testament, c’est-à-dire la référence à une instance hors texte, assumée par le corps ecclésial et instituant la jonction des deux Testaments comme la clé de voûte de la notion de Canon. Bref, l’accomplissement de l’Écriture paraît constituer un principe herméneutique majeur, dans l’appréhension d’un corpus biblique qui n’est pas seulement le fruit d’une accumulation quelque peu gratuite de morceaux parfaitement hétéroclites, mais reçoit de sa lecture dans le corps social chrétien un certain nombre de règles structurantes, dont la plus visible tient à l’articulation des deux Testaments.
La difficulté à honorer la problématique de l’accomplissement, comme essentielle à l’herméneutique biblique, n’est pas l’apanage des théologiens. Elle figure aussi bien dans le grand public chrétien, confronté à la dualité des Testaments, du fait du principe typologique présidant au cycle des lectures dominicales.
On le sait, la première lecture est habituellement choisie en fonction de la péricope évangélique, dont elle est supposée préparer ou éclairer la lecture. Or, pour beaucoup de chrétiens, ce rapprochement n’est pas perçu comme signifiant, soit que le manque de formation biblique rende parfaitement abscons l’abord des textes vétéro-testamentaires, soit que demeure, plus ou moins consciemment, le préjugé marcionite à l’égard d’un Ancien Testament, considéré comme inégal au Nouveau, voire contradictoire à la Révélation véritable inaugurée en Christ.
[…] Télécharger l’article intégral ci-contre
Article extrait de la revue La Maison-Dieu, n°210, 1997, p 51-65.
Télécharger l’article complet en PDF :