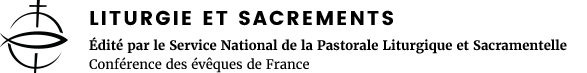Comment bien mourir ?
 Par Laurent Denizeau, Docteur en Sociologie et Anthropologie à l’Université Catholique de Lyon
Par Laurent Denizeau, Docteur en Sociologie et Anthropologie à l’Université Catholique de Lyon
La grande question pour un mourant, c’est « comment bien mourir ? » et ce n’est pas une question contemporaine. Mais « bien mourir » aujourd’hui c’est « mourir dans la dignité ». Ce qui est étonnant, c’est que l’on se pose la question du mourir dans la dignité mais beaucoup moins celle du vivre dans la dignité. Qu’est-ce que la dignité humaine ? Il est difficile d’y répondre. Mais ce qui est sociologiquement intéressant, c’est de se poser une autre question : quels sont les mots qui gravitent aujourd’hui autour de cette notion de dignité humaine ? Qualité de vie, autonomie et conscience. Nos représentations actuelles de la dignité soulignent l’importance que revêt le choix à nos yeux : la dignité c’est de pouvoir choisir. Est-ce que ce pouvoir de choisir est liberté ? Rien n’est moins sûr. Ce pouvoir choisir alimente davantage un imaginaire de pouvoir sur la vie. Nous devons choisir notre vie, jusqu’à notre mort. La mort provoquée apparaîtrait presque comme une liberté réaffirmée face à la mort, une protestation métaphysique devant la fatalité de nos existences, et évacue totalement la mort comme énigme, et en ce sens point d’échappement de nos existences. Cela traduit un contexte d’imaginaires beaucoup plus large qui révèle notre refus de l’incontrôlable, de l’inconnu, de l’imprévu, de l’incertitude.
Tout le discours sur la maîtrise de la mort se rapporte en fait à un désir de maîtriser sa propre mort, la manière dont « cela » va finir. Le mourir digne c’est une mort où l’homme reste maître de lui-même, pleinement autonome et conscient, libre de partir avant que les choses ne se détériorent, avant que les choses lui échappent. Avant que l’on perde sa dignité aux yeux des autres. Ma mort doit être propre, pacifiée, ne pas se prolonger, pour ne pas scandaliser les vivants. Finalement pour ne pas rappeler aux vivants qu’ils sont aussi concernés par la mort.
Le sentiment d’indignité (car ce ne peut être qu’un sentiment !) est aussi souvent lié au sentiment d’inutilité de sa vie. La notion de fin de vie parle de plus en plus de la fin de ce que l’on voit comme sa raison de vivre. La raison de vivre va à l’encontre du sentiment de vivre pour rien. Ce sentiment d’une vie qui ne rime à rien est souvent lié au rôle que l’on peut jouer dans la vie sociale (cela rejoint un autre facteur de demande d’euthanasie : la solitude, le sentiment de ne plus compter). Mais c’est encore plus que de la simple inutilité : non seulement le sujet éprouve le sentiment de ne plus servir le groupe (et donc de ne plus y avoir sa place) mais encore d’être une charge pour le groupe (la famille et la société), le sentiment d’être « de trop ». Il y aurait ainsi une mort sociale qui précèderait la mort biologique (voir Louis-Vincent Thomas, 1988).
Se positionner devant la réalité d’un décès, c’est se confronter à l’impensable, l’incroyable, l’irrecevable. La mort est un événement traumatisant, une rupture, un déchirement. Lorsque l’on parle de bonne mort, on parle plutôt d’une injonction à bien mourir, sans défaillance, avant la déchéance. Jusqu’au bout, il faut être impeccable, rester maître de ce que l’on fait, vit et dit. La mort « n’est pas seulement l’aboutissement de mes années et de mes jours. Elle est cet événement qui désorganise radicalement la conception organisatrice de l’existence » (Baudry, 1995 : 62-63).