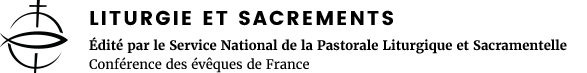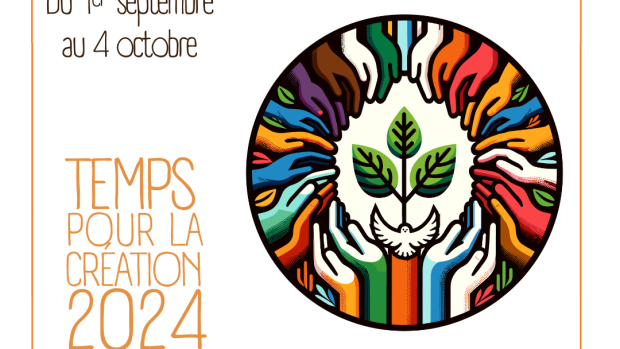Fleurir : « Un ministère de beauté, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit »

Dans la démonstration florale qui suit, frère Didier, moine à l’abbaye Notre-Dame de Tamié en Savoie propose une méditation théologique, symbolique et esthétique sur la composition florale liturgique. Il envisage celle-ci à partir du signe de croix, symbole de la relation entre Dieu, l’homme et la création.
.
Le contenant
Le signe de croix constitue la structure même de la composition florale, articulée autour de trois mouvements : l’ascension vers Dieu, l’enracinement dans la terre et l’embrassement du monde. Dans cette structure, le contenant joue un rôle essentiel : il symbolise l’homme, enraciné sur la terre mais tourné vers le ciel, image de l’alliance divine entre le ciel et la terre. Comme l’homme créé à l’image de Dieu, le contenant doit être beau — simple ou précieux — pour refléter la beauté restaurée de la création.
Une dimension cosmique
La composition florale exprime la terre aimée de Dieu. Elle a une dimension cosmique. Elle unit la profondeur terrestre et l’ouverture céleste, faisant entrer dans la liturgie le chant de la création. Les éléments naturels — sable, bois, mousse, pierres — rendent visible cette terre vivante et sa transformation. Dans cette œuvre, la forêt, faite de branchages morts et frais, symbolise le mystère de la mort et de la résurrection.
Un ministère
L’artiste, en façonnant la nature, ne la déforme pas mais la transfigure. Par son art, il révèle la gloire cachée de Dieu dans la création, comme le Christ transfiguré sur le mont Thabor manifeste sa divinité. Ainsi, l’artiste devient témoin de la résurrection, car chaque acte de transfiguration porte la trace de la vie nouvelle. Ce ministère n’est pas réservé aux artistes floraux : musiciens, peintres ou danseurs participent tous à cette même mission de révéler la beauté divine à travers la matière.
La notion de verticalité
Dans la composition, la verticalité des branches et l’horizontalité de l’ensemble évoquent à la fois la croix et l’union du ciel et de la terre. Même sans fleurs, la forêt sèche et la forêt fraîche suffisent à exprimer la symbolique trinitaire. L’ajout de fleurs, harmonisant les différents éléments, fait naître une nuptialité spirituelle comparable à la recherche de deux notes qui s’aiment, selon Mozart.
Dieu se donne dans le silence de la beauté
La beauté ainsi créée invite au silence contemplatif. Il ne s’agit pas tant d’en parler que de l’écouter. Dans cette attitude d’émerveillement et d’offrande, l’homme reçoit la beauté de Dieu, la transforme et la lui rend, dans un geste profondément eucharistique.
Frère Didier achève sa méditation sur un poème japonais ou haïku : le silence partagé entre l’hôte, l’invité et le chrysanthème blanc devient image de la communion entre les hommes et avec Dieu. La fleur, comme la composition florale tout entière, acquiert une dimension sacramentelle, en rendant visible la présence de Dieu et en unissant les hommes dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
La vidéo est divisée en huit chapitres ou sections suivantes :
- 0.04 à 1.34 : « Un ministère de beauté à la gloire du Père, du Fils et du Saint Esprit »
- 1.35 à 4.18 : « Le contenant : à la rencontre de la terre et du ciel »
- 4.19 à 6.09 : « La dimension cosmique de la composition florale »
- 6.10 à 15.28 : « La création d’une architecture, verticalité et horizontalité »
→ 1e partie : « La forêt sèche » 6.10 à 12.26
→ 2e partie : « La forêt fraîche » 12.45 à 15.28 - 15.29 à 17.41 : « La recherche de l’harmonie »
- 17.42 à 19.40 : « Écouter le message de la beauté »
- 20.27 à 22.17 : « Le silence contemplatif »
- 22.17 à 25.00 : « La composition florale est sacramentelle »
Marie-Odile Lalo, novembre 2025