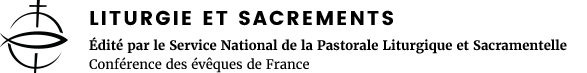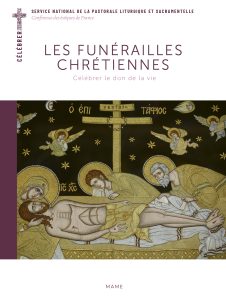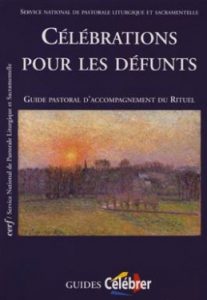La mort n’est pas (que) la fin de vie
Patrick Baudry fait une distinction stimulante entre la fin de la vie et la mort (2006), qui va l’amener à considérer, de manière un peu provocatrice, que la mort n’est pas la fin de la vie. Paradoxalement, il ne fait pas référence à une croyance en un au-delà, à une vie après la mort, mais veut nous montrer que la mort n’est pas réductible à la fin de la vie. La fin de la vie est un fait constatable de l’ordre de la terminaison d’un processus, de l’arrêt du fonctionnement du corps. La vie est associée au fonctionnement du corps, donc à l’idée de mouvement, et la fin de la vie, c’est la panne. Le terme de décès l’indique : il est de l’ordre de la constatation d’un fait. Le décès se réduit à un fait, qui ne concerne que l’individu et son entourage, et non à un événement qui concernerait la société.
Cette notion de fin de la vie ne cacherait-elle pas le fantasme de vouloir pacifier la mort ? La mort se réduit à l’arrêt du fonctionnement du corps. Lorsque le corps s’arrête de fonctionner, la mort survient, c’est tout. Cette approche biologique de la mort comme arrêt du fonctionnement du corps est vraie, mais la mort ne se réduit pas à l’arrêt du fonctionnement du corps.
On voit le glissement possible dans cette conception de la mort comme se résumant à la fin de la vie. Il s’agit aujourd’hui de ne plus avoir peur de la mort : c’est naturel, c’est normal, c’est dans l’ordre des choses et donc il ne sert à rien de s’en effrayer. C’est dans l’ordre biologique des choses. Il faut aborder la mort avec sérénité car la mort n’est que l’arrêt des fonctions corporelles. Et on peut rechercher cette sérénité par la maîtrise du processus qui aboutit à l’arrêt fonctionnel. L’arrêt d’un fonctionnement peut être en partie maîtrisé : il peut faire l’objet d’une intervention d’ordre technique.
Cette confusion actuelle entre la mort et la fin de la vie peut alimenter le fantasme de maîtriser la mort par une maîtrise de la manière dont cela va finir. Il s’agirait de faire de la mort une fin prévisible, contrôlable voire aménageable. Sous couvert d’humanisation de la fin de la vie, la recherche d’une certaine maîtrise de la mort peut en fait être une manière de vouloir éviter ce que la mort suscite dans la communauté : l’arrêt, la suspension, le silence, le désarroi, le vacillement de la parole qui ne sait que dire. Aucun agir d’ordre technologique ne peut répondre à ce que la mort suscite.
La mort semble une réalité de l’ordre de l’évidence, au moins d’un point de vue biologique. Elle apparaît comme la fin de la vie, c’est-à-dire comme l’arrêt des fonctions vitales. Mais précisément l’arrêt n’intervient pas à un instant T mais s’inscrit dans un processus. Comment décider dans ce processus du moment de la mort ? La définition de la mort a une histoire, liée aux progrès médicaux. Autrefois, la mort pouvait avoir un caractère d’évidence. Elle s’identifiait à l’arrêt de la respiration et de l’activité cardiaque. L’arrêt de la respiration survient bien à un moment précis qui amenait à parler du « dernier souffle » avec lequel la vie s’en va. Il existait plusieurs méthodes pour s’assurer de la mort : le miroir posé devant la bouche qui attestait de l’arrêt de la respiration, la vérification de l’arrêt du cœur, ou encore une stimulation nociceptive (faire très mal pour voir s’il y a une réaction, comme croquer le gros orteil qui a donné le nom de croque-mort), l’observation du présumé mort dans la durée.
En France, jusqu’au milieu du 20 ème s., les textes officiels définissaient la mort comme la cessation conjointe des activités cardiaques et respiratoires (car il y a solidarité de ces fonctions). Mais en 1960 la question de la définition de la mort va se reposer suite à deux facteurs :
- La possibilité de réanimer des patients en état de défaillance cardiaque ou respiratoire (défibrillation, ventilation assistée). Ces signes de la mort n’ayant rien d’irréversibles, ils deviennent caducs.
- La question des greffes d’organe qui suppose le maintien de la fonction cardio- respiratoire et en même temps la nécessité de prélever des organes de personnes mortes, sinon la greffe devient un homicide.
Un nouveau critère apparaît : la mort du cerveau. La définition de la mort à partir de l’arrêt de l’activité cérébrale est liée à l’impossibilité de suppléer à cette fonction alors que la fonction respiratoire comme la fonction cardiaque peuvent être assumées par une machine.
Avec les progrès de la médecine, la frontière de la mort est devenue plus floue. La mort étant maintenant de l’ordre du processus et non plus de l’instant. Dans la mesure où la mort se fait par étapes, il est parfois difficile d’être sûr du moment où le patient meurt (bien sûr plus on s’éloigne du décès et plus cela devient évident avec le processus de thanatomorphose). Il est donc difficile d’user de la représentation mécanique de la mort sur le mode « il s’est arrêté ». Qu’est-ce qui s’est arrêté ? On voit que les choses deviennent compliquées lorsqu’on descend à une échelle plus fine que celle de la clinique. Car tous les processus observables chez le vivant ne s’arrêtent pas dans la seconde qui suit l’arrêt cardiaque, ou même l’arrêt cérébral.
Les débats actuels sur la mort provoquée peuvent apparaître comme une esquive de la dimension provocatrice de la mort. Il est étonnant de constater que l’on dit de moins en moins de quelqu’un qu’il est mort. On préférera dire qu’« il n’est plus là », qu’« il est parti », qu’« il nous a quitté », ou encore qu’« il a disparu ».
On préfère parler de la mort comme d’un départ ou d’une disparition, c’est-à-dire sur le mode de l’absence. Reste que la mort n’est pas une absence comme une autre. Le mot même de mort tend à être remplacé aujourd’hui par la fin de la vie, cela apparaît comme moins violent. On ne dira pas de quelqu’un qu’il est mourant, mais qu’il est en fin de vie, ce qui s’apparente à la fin d’un parcours, d’une trajectoire de vie, de la vie d’un individu. En fait ce qui semble caractériser notre relation actuelle à la mort, ce n’est pas tant qu’elle soit acceptable ou inacceptable mais qu’elle constitue de moins en moins un événement collectif qui soit le lieu d’une élaboration de sens pour devenir un événement individuel à gérer soi-même en ayant recours à des professionnels du funéraire.
Mais la mort ne se réduit pas à la fin de la vie, comme l’arrêt d’un processus biologique. L’homme se saisit de l’événement biologique pour en faire autre chose. La mort ne se réduit pas à la fin de la vie, parce qu’elle est une énigme posée à l’existence. En cela Baudry nous rappelle que « la mort provoque la culture » (1995) : elle nous amène à élaborer du sens, penser le monde dans lequel nous vivons. Parce qu’elle est limite, elle nous conduit à définir notre rapport au monde. L’expérience de la mort convoque à l’élaboration collective de l’existence (ce que nous appelons communément la culture) : « Les morts posent toute la difficile question d’une séparation, et parce qu’ils obligent à l’imagination de l’invisible, ils contribuent à déterminer l’enracinement culturel de la société des vivants. » (Baudry, 2006 : 23)
Parler d’élaboration de l’existence ne se résume pas à la production de significations autour de la mort. Ce sont moins les énoncés produits qui sont importants, que cet espace d’élaboration qu’ouvre la mort.
La mort reste l’impensable par excellence, ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas la penser. La mort est le lieu le plus fécond de la pensée philosophique, et plus largement de la pensée humaine. Elle nous montre combien la pensée peut se faire en direction de ce qui échappe à l’ordre du pensable. Qui est-on pour penser la mort ? Mais qui serions-nous si nous ne nous attelions pas malgré tout à chercher à en dire quelque chose ? La mort nous convoque à penser l’existence.
Du côté des vivants, l’expérience de la mort est toujours associée à la mort d’un proche. Ce qui est bouleversant dans cette expérience, c’est l’impossibilité de l’échange, de la relation (ce qui n’empêche pas que l’on puisse s’adresser au mort). Le mort disparaît de la relation. Le mort n’est plus dans la communauté des vivants, n’est plus inscrit dans un tissu relationnel. Le mort disparaît du champ de la société. Envisagée comme de l’ordre de l’absence, de la disparition, la mort ne pose pas question à la société des vivants. Traiter la mort comme disparition est une manière de court-circuiter sa mise en récit par la société elle-même (elle devient une mise en récit individuelle).
Ces métaphores sont caractéristiques d’une individualisation de la mort. Le mort devient un absent. Le terme de disparition comme de départ fait de la mort un événement individuel. Un exemple d’individualisation de la mort se retrouve dans notre conception du deuil. Le deuil est vu aujourd’hui comme quelque chose de personnel, voire d’intime et les obsèques se déroulent souvent « dans la stricte intimité familiale ». Aujourd’hui, nous sommes presque dans une approche psychologique du deuil qui tend à se confondre avec une dépression liée à la mort d’un proche. Si cette période dure trop longtemps, il est alors question de « soigner » le deuil à coup d’antidépresseurs. Il convient de ne pas se laisser trop envahir par la mort. Mais le deuil n’est pas seulement une période de dépression dont il faudrait chercher à sortir le plus vite possible. C’est une forme de rapport à l’autre, et à la finitude, qui nous travaille.
La mort de l’autre nous renvoie toujours à notre propre mort. Il est alors fécond de faire
la distinction entre le travail de deuil (expression actuelle) et le travail du deuil. Dans le
travail de deuil, il s’agit de « faire son deuil », c’est-à-dire traverser la période de tristesse qui accompagne le départ d’un proche (passer de la tristesse de l’absence à la mémoire du proche). Dans le travail du deuil, il est davantage question de se laisser travailler par le deuil, par cette question que pose le mort aux vivants.
Tout le discours sur la maîtrise de la mort se rapporte en fait à un désir de maîtriser sa propre mort, la manière dont « cela » va finir. Le mourir digne c’est une mort où l’homme reste maître de lui-même, pleinement autonome et conscient, libre de partir avant que les choses ne se détériorent, avant que les choses lui échappent. Avant que l’on perde sa dignité aux yeux des autres. Ma mort doit être propre, pacifiée, ne pas se prolonger, pour ne pas scandaliser les vivants. Finalement pour ne pas rappeler aux vivants qu’ils sont aussi concernés par la mort.
Le sentiment d’indignité (car ce ne peut être qu’un sentiment !) est aussi souvent lié au sentiment d’inutilité de sa vie. La notion de fin de vie parle de plus en plus de la fin de ce que l’on voit comme sa raison de vivre. La raison de vivre va à l’encontre du sentiment de vivre pour rien. Ce sentiment d’une vie qui ne rime à rien est souvent lié au rôle que l’on peut jouer dans la vie sociale (cela rejoint un autre facteur de demande d’euthanasie : la solitude, le sentiment de ne plus compter). Mais c’est encore plus que de la simple inutilité : non seulement le sujet éprouve le sentiment de ne plus servir le groupe (et donc de ne plus y avoir sa place) mais encore d’être une charge pour le groupe (la famille et la société), le sentiment d’être « de trop ». Il y aurait ainsi une mort sociale qui précèderait la mort biologique (voir Louis-Vincent Thomas, 1988).
Se positionner devant la réalité d’un décès, c’est se confronter à l’impensable, l’incroyable, l’irrecevable. La mort est un événement traumatisant, une rupture, un déchirement. Lorsque l’on parle de bonne mort, on parle plutôt d’une injonction à bien mourir, sans défaillance, avant la déchéance. Jusqu’au bout, il faut être impeccable, rester maître de ce que l’on fait, vit et dit. La mort « n’est pas seulement l’aboutissement de mes années et de mes jours. Elle est cet événement qui désorganise radicalement la conception organisatrice de l’existence » (Baudry, 1995 : 62-63).
La professionnalisation du funéraire engendre une logique de concurrence qui encourage une diversification des offres rituelles en fonction des demandes. Il s’agit alors pour les professionnels du funéraire de produire un rite adapté. Bien souvent, l’« expert en rituel » construit un rite funéraire en fonction des attentes de la famille (avec l’idée de faire un enterrement à l’image de la vie de la personne décédée). Le rite ainsi
produit devient une mise en scène de significations individuelles.
Dans cette ritualisation du funéraire, il s’agit d’être utile, de soutenir les individus, de gérer le désordre introduit par la mort par le biais du rite. Le rite suit alors une logique de canalisation des affects, de dédramatisation, finalement une logique de management des émotions et des relations. La mort y semble soumise au contrôle d’un dispositif pacificateur. Si la ritualité funéraire tend à se sophistiquer sur le plan de la mise en scène, celle-ci se fait néanmoins au détriment de la mise en sens. Le rite semble y perdre de son sens, de son énergie symbolique pour se réduire à une mise en scène, à une fabrication de significations qui font du bien.
Cette ritualisation prend l’allure d’un lieu d’expression des affects vécus par les vivants en présence du mort, vu comme un ancien vivant à qui il s’agit de rendre hommage, dans une sorte de relation poursuivie. Fabriquer du rite consiste alors à produire et mettre en scène des significations plus « appropriées », plus singulières (et du coup moins partageables). La ritualisation devient un rite commenté, où l’on va insister sur la fonction expressive du rite. Elle se justifie par le souci du service et de la signification (ou plutôt du service par la mise en signification) : ça fait du bien parce que ça donne du sens au malheur, ça permet aux émotions de s’exprimer. Mais le danger serait de réduire la ritualité à un ensemble de significations produites autour de la mort que l’on va mettre en scène : il ne s’agit plus d’un rituel mais d’un commentaire.
La ritualisation ne produit pas du rite mais une scission entre soi et l’acteur du rite (où le rituel est une mise en scène) : on se regarde y assister, on s’écoute y participer, en ressentant sa présence sur le mode du rôle qu’on a à jouer dans le rite. En insistant sur les significations du rite, on perd le sens du rite qui n’est pas de signifier mais de travailler, et pour le sujet, de se laisser travailler par cette reprise collective de l’expérience du désarroi face à la mort.