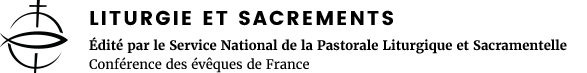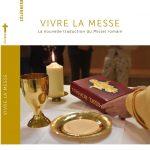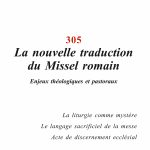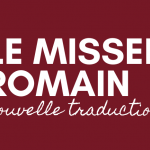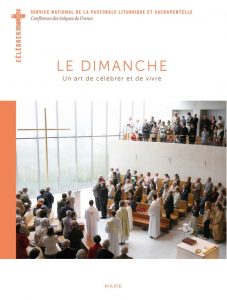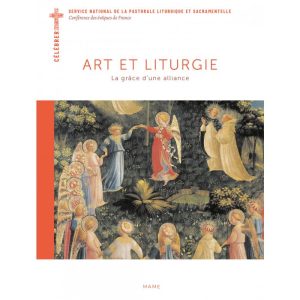La liturgie, clé pour la pastorale
 La question du rapport entre liturgie, sacrements d’une part et évangélisation d’autre part, ne date pas d’aujourd’hui. S’interroger sur la manière dont la liturgie constitue une ressource et des repères pour l’évangélisation aujourd’hui, demande que nous revisitions d’où nous venons. En effet, cette question du rapport entre liturgie, sacrements d’une part et évangélisation d’autre part, ne date pas d’aujourd’hui. Retour sur la réflexion des 60 ans dernières années.
La question du rapport entre liturgie, sacrements d’une part et évangélisation d’autre part, ne date pas d’aujourd’hui. S’interroger sur la manière dont la liturgie constitue une ressource et des repères pour l’évangélisation aujourd’hui, demande que nous revisitions d’où nous venons. En effet, cette question du rapport entre liturgie, sacrements d’une part et évangélisation d’autre part, ne date pas d’aujourd’hui. Retour sur la réflexion des 60 ans dernières années.
Le titre de cette conférence se veut un écho lointain à Joseph Jungmann – bien connu des liturgistes et des catéchistes –, qui en 1956, avait intitulé une conférence : « La pastorale clé de l’histoire liturgique ». Je cite un extrait de son introduction : « Les formes de la liturgie de l’Église ont varié au cours de l’histoire mais c’est la sollicitude du ministère pastoral envers le peuple de Dieu qui en est à la fois la cause et le principe ».
S’interroger sur la manière dont la liturgie constitue une ressource et des repères pour l’évangélisation aujourd’hui, demande en effet que nous revisitions d’où nous venons. En effet, cette question du rapport entre liturgie, sacrements d’une part et évangélisation d’autre part, ne date pas d’aujourd’hui.
Citons Bernard de Chartres (xiie siècle) : « Nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants ». Le Père Gy reprenait souvent cette expression dans ses cours de l’ISL, en nous rappelant quelques lancettes que nous trouvons dans les vitraux de Chartres. Su la rosace de l’Apocalypse, on peut y apercevoir l’évangéliste Matthieu juché sur les épaules d’Isaïe, nous avons aussi Marc juché sur les épaules de Daniel, Jean sur les épaules d’Ezéchiel et Luc sur les épaules de Jérémie.
Cette tentation de considérer que nos prédécesseurs ont échoué et qu’il nous faut tout reprendre à zéro est tout aussi prégnante aujourd’hui. Tenir compte du passé n’empêche ni l’audace, ni la créativité. Qui nierait l’audace et l’apport nouveau d’un saint Matthieu par rapport à Isaïe !
I Le Mouvement liturgique, avant Sacrosanctum concilium (4 décembre 1963)
Jungmann a prononcé sa conférence lors du premier Congrès international de pastorale liturgique qui a eu lieu à Assise en 1956 et s’est terminé à Rome. Elle a été publiée dans La Maison-Dieu, n°47-48. S’inscrivant dans le Mouvement liturgique, elle affirme que c’est la sollicitude pastorale qui a conduit à l’évolution de la liturgie. L’auteur va jusqu’à affirmer que la liturgie elle-même a une fonction pastorale, qu’elle exerce un ministère pastoral. La liturgie elle-même est pastorale.
De son côté, le jésuite missionnaire J. Hofinger se plaignait que la liturgie romaine à l’époque ne parvenait pas à rejoindre les autochtones du pays des missions. Il fallait dont envisager une démarche de transformation en quelque sorte, à la fois de la liturgie et de notre rapport à la liturgie. Romano Guardini – cher au pape François – a montré combien la liturgie pouvait être le creuset d’une authentique vie spirituelle. Il est intéressant de rappeler le débat entre le bénédictin Dom Festugière, et le jésuite Navatel au début du xxe siècle dans les années 1913-1914. Le premier soulignait que la liturgie était source de vie pastorale et le lieu de la prière, tandis que le second considérait que la vie spirituelle et la vie de prière se trouvaient en dehors de la liturgie.
C’est d’ailleurs la grande question qui a présidé à la fondation du CPL (Centre de pastorale liturgique). Nous en avons un aperçu très puissant dans le premier numéro de la collection « Lex Orandi » publiée aux éditions du Cerf en 1944, suite au congrès de fondation du CPL, la même année. Dans ce congrès, il y eut plusieurs interventions majeures notamment, des Pères Gaston Morin, Georges Michonneau, Paul Doncœur, etc. Tous furent des pasteurs engagés : le P. Doncœur avec les scouts ; le P. Michonneau, et le P. Morin en paroisse. Ils ont fait en 1944 le même constat que le P. Hofinger en 1956 : la liturgie a du mal à rejoindre les gens. D’ailleurs le Père Aimon-Marie Roguet– à l’initiative de la fondation du CPL –, écrit dans son ouverture au colloque de Vanves qui fonde le CPL :
« Ce qui nous meut, ce qui nous brûle, c’est une angoisse de missionnaire… nous sommes hantés par la pensée de ces énormes foules qui vivent sans idéal et qui sont captivées par des liturgies purement humaines, et souvent moins humaines de la classe, de la masse, des jeux du stade, ou des ombres de l’écran, et qui en tout cas méconnaissent la source intarissable de joie, de force, de salut, c’est-à-dire de santé qui jaillit de nos mystères chrétiens. Nous souffrons de voir nos églises si souvent vides ou bien emplit d’un peuple résigné, routinier, accablé par un culte subi comme une corvée indispensable ou rétrécie à une pratique individualiste ou sentimentale ».
De ce Congrès de Vanves va émerger la création de la Pastorale liturgique en France, avec une demande de transformation de la liturgie pour mieux rejoindre le peuple. Louis Bouyer n’interviendra pas au cours du colloque, mais écrira ceci dans la postface de l’ouvrage qui reprend les actes de ce colloque :
« Vous avez raison, vous avez raison il y a des difficultés pour le peuple à rejoindre la liturgie et les mystères chrétiens dans ce qu’ils ont de plus profond, mais la liturgie, elle, n’est pas faite pour évangéliser ! La liturgie elle est faite pour des initiés, elle n’est pas faite pour évangéliser ! » et il ajoute : « il faudrait plutôt oser, développer des « paraliturgies » qui s’inspirent de la liturgie elle-même, qui cherche à rejoindre les plus éloignés de la vie de l’Église et qui les conduisent progressivement à la participation à la liturgie.
La question pastorale et missionnaire est donc majeure, en 1944. Et on voit débattre les différentes écoles, pour transformer la liturgie et la rendre plus accessible. De son côté, en vue de la participation à la liturgie, le P. Morin voudrait développer l’éducation chrétienne et notamment, la formation biblique, tout comme le P. Hofinger ou le P. Doncœur. Quant au P. Bouyer, il rappelle la nécessité d’un chemin pour accéder à la liturgie.
II Une pastorale des liturgies
En 1951, un Directoire pour la « Pastorale des sacrements à l’usage du clergé » est présenté devant les évêques, par Mgr Émile Guerry, évêque de Cambrai. Il fut voté par l’ensemble des évêques. Ce document énonce qu’il faut développer une pastorale pour les sacrements, qui vise un grand mouvement d’évangélisation sacramentelle.
Pour y parvenir, il faut développer l’instruction des fidèles, en particulier à l’occasion des nombreuses demandes sacramentelles. Il s’agit :
- d’accroître l’éducation des consciences pour que les sacrements ne soient plus perçus comme des devoirs à accomplir où il faudrait avoir « fait » son baptême, sa première communion, etc…
- de lutter contre les superstitions : l’approche des sacrements qui protègeraient etc…
- de responsabiliser les communautés chrétiennes, pour qu’elles soient attentives à tous les hommes ; ouvertes notamment à ceux qui sont éloignés de la vie de l’église.
En 1955, Il y aura un autre Directoire pour la pastorale de la messe, exactement dans le même esprit et la même orientation que le précédent. La seule différence c’est qu’il n’a pas été voté par l’ensemble des évêques mais seulement par l’assemblée des cardinaux et archevêques. Mais on voit bien que l’enjeu est de passer de la pastorale de la liturgie à une pastorale liturgique, à l’instar de Sacrosanctum concilium (SC). A l’inverse de ce qui se passait auparavant, il s’agit de passer à une Pastorale liturgique dont la liturgie est le sujet, et nous les objets.
Lors de la fondation de l’Association Sacrosanctum Concilium – l’association des liturgistes francophones –, j’ai écrit un article publié dans La Maison-Dieu n° 265, « La pastorale liturgique et sacramentelle, une dynamique à revisiter, à réévaluer régulièrement ».
J’y développais l’idée que « la liturgie a vraiment besoin d’une pastorale » si l’on veut évangéliser. Pour le dire d’une autre manière, la liturgie n’est pas évangélisatrice par elle-même immédiatement, comme le disait Bouyer ; la liturgie a besoin d’une pastorale pour être évangélisatrice : une pastorale de la liturgie pour y accéder, mais aussi une pastorale liturgique par la liturgie elle-même pour en bénéficier. Quand on lit attentivement Sacrosanctum concilium qui date de 1964, on est très proche de Desiderio desideravi du pape François. Comment se fait-il dès lors, que Desiderio desideravi, ait pu passer pour une révélation ?
Or tout était déjà dit dans Sacrosanctum concilium qui donne le fondement de cette pastorale liturgique. En effet, elle définit la liturgie comme continuation par le Christ lui-même de sa mission de l’Église pour la gloire de Dieu et la sanctification de l’humanité et pour cela, s’associe son église dans la liturgie. On peut en conclure que l’Église qui célèbre la liturgie exerce la mission du Christ (SC 7).
À cette fin, il est reconnu la nécessité d’une pastorale liturgique, au niveau national avec une commission nationale (SC 44), avec des commissions diocésaines (SC 45) qui cherchent à promouvoir la liturgie et insistent aussi sur les besoins de formation pour donner toute sa chance à la liturgie d’accomplir sa mission.
Sacrosanctum concilium fut bien reçu, mais au fur et à mesure, comme dans un long enfantement. L’étonnement devant Desiderio desideravi en est l’un des derniers témoins.
III évangélisation et sacrements
Le rapport Coffy de 1971 « Église signe de salut au milieu des hommes »
À l’Assemblée de 1969, qui rassemblait évêques et prêtres, ces derniers en particulier, se sont interrogés sur la manière avec laquelle on pouvait accueillir les demandes sacramentelles, dans notre monde contemporain et comment les évangéliser.
Mgr Coffy, en 1971, aborde cette question de front en affirmant qu’il faut sortir de l’opposition entre évangélisation et sacrements, qui, à l’image du clivage entre vie spirituelle et liturgie, a occupé les esprits durant la première moitié du xxe siècle.
Pour lui, on ne peut sortir de cette opposition qu’à partir de l’identité de l’Église à percevoir dans le contexte culturel et sociétal de son temps. Il prend soin d’ailleurs de développer ce contexte. Il parle de sécularisation de la société, du désenchantement du monde, de la primauté de l’avenir sur la mémoire, de l’essoufflement de la métaphysique classique – c’est-à-dire les notions philosophiques que la doctrine chrétienne avait utilisées pour formuler sa foi.
On prend acte du pluralisme religieux, du transfert du sacré, qui appartenait au religieux vers un transfert du sacré laïc – on pourrait presque dire un sacré « profane » –, de l’absence de référence aux sacrements de l’Église pour accompagner le destin de l’homme, de la prégnance du langage rationnel sur le langage symbolique.
Dans ce contexte, le rapport invite à revenir à l’identité de l’Église : elle est « sacrement de salut », « sacrement du royaume de Dieu qui vient », parce qu’elle est sacrement du Christ mort et ressuscité, et qu’elle a la particularité de déployer la mission du Christ dans le monde jusqu’à l’achèvement de son œuvre. En conséquence, l’Église est missionnaire. Cette dimension n’est pas une « fonction » de l’Église, c’est son identité même ; elle est mission.
Et ajoute Mgr Coffy dans son rapport, c’est dans la célébration de la Parole et des sacrements que l’Église se découvre appelée à cette mission, qu’elle en perçoit le sens, qu’elle puise sa force, parce que c’est dans cette célébration qu’elle fait mémoire de la Pâque du Christ. C’est donc de là que jaillit sa dimension missionnaire.
1990, assemblée des évêques sur le l’articulation communion et mission
À cette occasion, les évêques aborderont la question du dimanche et de la célébration liturgique. Il fut demandé à Mgr Coffy de faire une intervention sur le sujet. Elle fut très courte :
« Dans la célébration, la mission de l’Église se révèle fondée sur un appel. Et elle se présente comme un refus avant d’être un faire […]. La mission se révèle comme la phase visible de la mission du fils et de l’Esprit ».
Il poursuivra en disant que cet appel nous oblige à aborder la question missionnaire, et finalement ce qu’est la mission sous un angle particulier, celui que nous donne, nous offre la liturgie. La célébration liturgique est le lieu de l’éducation de la foi des chrétiens, d’où un impératif de qualité de nos célébrations, en particulier les chants. Il est nécessaire de travailler la qualité de nos célébrations pour que la liturgie soit vraiment l’appel et l’envoi en mission quelle est censée être pour toute l’Église.
9 novembre 1996 : Lettre aux catholiques de France : « Proposer la foi dans la société actuelle », le Rapport Dagens
Il y est mentionné que dans notre société en crise comme la nôtre, l’Église se doit d’oser proposer la foi, et pour cela, elle doit se centrer sur le cœur de la foi, le kérygme tel qu’il se révèle dans la liturgie.
Pourquoi a-t-il fallu attendre 2023 pour faire un rassemblement ecclésial comme « Kerygma » ? On mesure effectivement le long enfantement que requiert tout changement de fond.
Dans cette Lettre aux catholiques, il s’agit de se recentrer sur le kérygme, tel qu’il se révèle dans la liturgie pour se fier au Dieu de Jésus Christ, pour affronter le mal, pour vivre selon l’Esprit. Elle dessine trois modalités selon lesquelles l’Église se réalise : célébrer le salut (leitourgia), servir la vie des hommes (diakonia), et annoncer l’Évangile (marturia). Il s’agit là d’une ligne d’action traditionnelle depuis plus de 20 siècles. Rien donc de bien nouveau, sinon l’audace de mettre la liturgie en premier, non parce que les autres domaines seraient moins importants, mais parce qu’elle donne leur pleine portée théologale aux deux autres. Autrement dit, pour reprendre les mots de Sacrosanctum concilium n° 10, la liturgie est la source et le sommet de la vie de l’église, parce que c’est dans la vie de l’Église que l’on va puiser la force et l’appel pour la vie.
IV La liturgie, lieu d’évangélisation
1994 : Les Points de repères en pastorale sacramentelle
Àpartir du rapport Dagens, les évêques de la Commission épiscopale de liturgie et pastorale sacramentelle, ont proposé des orientations intitulées : « Points de repères en pastorale sacramentelle », publiés dans les documents épiscopats dossiers 10 et 11. Ils ont ensuite été repris dans un livre publié au Cerf, dans la collection « Liturgie » n° 7 : Pastorale sacramentelle points de repères.
Ces derniers portent essentiellement sur la pastorale de l’initiation chrétienne et le mariage. Quelques années après, un document concernera la célébration des funérailles.
La ligne de force de ces repères est la suivante : « Comment faire un chemin d’évangélisation, de la pastorale de ces sacrements que sont le baptême, la confirmation, la première eucharistie, le mariage ?
Première réponse : en acceptant d’être nous-mêmes évangélisés par les personnes en demande de sacrement. Il n’y a d’évangélisation que réciproque : c’est là, toute la théologie de la mission !
La seconde réponse est qu’il s’agit d’un chemin commun, sur lequel progresser ensemble et qui comprend quatre étapes :
– 1e étape : accueillir de manière désintéressée ;
– 2e étape : favoriser une progression, en n’hésitant pas à marquer une certaine distance entre ce que nous croyons et ce qu’ils croient ; entre ce que nous faisons, que nous sommes prêts à faire et ce qu’ils font, de manière à favoriser la progression. Il n’y a pas de progression possible s’il n’y a pas un minimum de piste ;
– 3e étape : célébrer le sacrement, en laissant toute leur chance aux rites tels qu’ils nous sont proposés par l’Église, d’où l’importance d’un art de célébrer, perçu comme l’art de mettre en œuvre les rites pour qu’ils soient opérants ;
– 4e étape : veiller à la suite, non pour maîtriser la volonté de Dieu ou l’avenir de ceux qui ont reçu un sacrement, mais pour soutenir la conversion de ces derniers.
Quatre étapes qui déjà en 1996, décrivent un processus catéchuménal, dans lequel la célébration liturgique est le pivot, puisque la célébration de ce sacrement est comme la pierre d’angle de l’itinéraire proposé. C’est d’ailleurs pour cette raison que ceux qui viennent demander un sacrement désirent nous rencontrer.
On voit dans cette proposition, une progression par rapport aux décennies précédentes.
Aujourd’hui, en ce qui concerne la 1ère étape, de nets progrès dans l’accueil ont été entrepris au sein de la communauté chrétienne. Dans la 3e étape, l’essentiel a été dit sur la nécessité de donner toute sa chance à la ritualité de l’Église telle qu’elle nous est proposée, parce qu’elle sait comment rejoindre dans leur existence, les hommes et les femmes de ce temps.
Il nous faut en revanche, nous pencher sur l’étape 2 qui est un peu faible : ne pas hésiter à marquer une distance entre ceux qui sont accueillis et ceux qui accueillent. Mais il nous faut aller plus loin en développant sans avoir peur de le dire, la dimension catéchétique propre à la célébration liturgique.
Idem pour la 4e étape qui concerne l’initiation chrétienne des adultes. Aujourd’hui, quelles sont les paroisses qui mettent en œuvre le temps de la mystagogie ? Si peu… Dès lors, il ne faut pas s’étonner des difficultés rencontrées pour intégrer les nouveaux baptisés à nos communautés chrétiennes. Par ailleurs, on a besoin de déployer une catéchèse liturgique, à partir de la célébration.
V Liturgie, catéchèse et éthique
Comme l’a montré Louis-Marie Chauvet, il y a une nécessaire intrication entre ces trois termes ; la vie de l’Église c’est la circulation entre les trois. Si l’on se polarise sur un seul de ces trois mots, on s’égare :
– Si on en reste au pôle sacrement, sans développer en même temps la Parole, l’annonce, la catéchèse, et sans regarder en même temps les prolongements éthiques – c’est-à-dire à quelle vie cela nous conduit dans le service de nos frères –, alors on fait des sacrements un ritualisme, un rubricisme ;
– si l’on se focalise sur le pôle Parole en oubliant qu’elle se déploie dans les sacrements et la vie éthique, alors la Parole devient fondamentaliste ;
– si l’on s’en tient exclusivement au pôle éthique, aux valeurs chrétiennes, en oubliant la liturgie, l’annonce de la Parole et la dimension catéchétique, alors on est un humaniste comme il en existe beaucoup aujourd’hui, sans dimension chrétienne. En conséquence, c’est l’intrication entre les trois qui est importante.
Prenons le Directoire de la catéchèse de 1997, document romain – que le Directoire de 2020 qui en est issu, déploie encore davantage.
Il soulignait comment la catéchèse devait s’appuyer nécessairement sur les célébrations liturgiques, en présentant l’initiation chrétienne comme modèle catéchétique. On sait que l’initiation chrétienne est un itinéraire structuré par des célébrations liturgiques ; la colonne vertébrale de l’initiation chrétienne ce sont les célébrations liturgiques en particulier l’entrée en catéchuménat, l’appel décisif, les scrutins et la veillée pascale.
C’est à partir de ce Directoire de 1997 que les évêques de France, ont engagé une démarche pour une nouvelle orientation de la catéchèse. Elle a conduit au Texte national pour la catéchèse en France publié en 2006, qui s’appuie sur la veillée pascale. Souvenons-nous du document Aller au cœur de la foi qui a précédé cette orientation, dans laquelle on invitait les chrétiens à revisiter la veillée pascale pour y redécouvrir le cœur de la foi, le kérygme, comme le disait la Lettre aux catholiques de France. Il s’agissait de penser une démarche catéchétique qui s’enracine et s’appuie sur la célébration liturgique – comme c’est le cas dans l’initiation chrétienne des adultes, en particulier pendant le temps de catéchuménat.
Plus encore le Texte national pour l’orientation de la catéchèse, nous invite à envisager toute catéchèse selon ce qu’on appelle la pédagogie d’initiation, qui s’appuie sur les célébrations liturgiques comme annonce et expérience du kérygme, parce qu’on y fait mémoire du passage du Christ de la mort à la vie et de l’envoi de son Esprit.
Les quatre axes de mise en œuvre présents dans le Texte national pour l’orientation de la catéchèse sont éloquents. Il s’agit de développer une catéchèse selon l’année liturgique, une catéchèse liée au demande sacramentelles, une catéchèse liée au passage de l’existence, une catéchèse liée au lieu de vie.
Dans cette démarche catéchétique, les démarches liturgiques qu’elles soient sacramentelles ou non, constituent des étapes décisives, mais aussi des étapes flottantes. Cela signifie que les démarches liturgiques sont proposées ad limitum comme dans le temps du catéchuménat, où l’on va proposer des liturgies de la Parole, des bénédictions, des prières d’exorcismes aux catéchumènes en fonction des étapes flottantes qui précèdent les étapes décisives. Les célébrations liturgiques constituent toujours des étapes, qui mobilisent une catéchèse avant et après elles.
On voit ainsi que le Texte national pour l’orientation de la catéchèse a repris l’intuition développée déjà précédemment en 1996 dans Les Points de repères. Cela signifie que si on veut que la liturgie soit vraiment le fondement, le creuset de la mission, alors il nous faut penser la liturgie dans un itinéraire avec une catéchèse qui précède et une catéchèse qui suit. C’est tout l’enjeu des approches mystagogiques. Expérimentées par les Pères de l’Église au ive siècle, comment va-t-on les déployer aujourd’hui, se les approprier à travers la relecture d’une manière de parler, de gestes, de rites, de postures, d’attitudes, de paroles, de chants, de l’espace liturgique, bref de tout ce qui compose la célébration liturgique. Comment va-t-on en parler des liturgies avant et après elles ?
VI L’aujourd’hui d’une pastorale qui se fait liturgique
On a à faire ici au texte du pape François, et tout particulièrement à sa grande Exhortation de début de son pontificat Evangelii Gaudium, La joie de l’Évangile. Dans ce texte, il nous trace à sa manière, la même voie : c’est tout le peuple de Dieu qui doit se sentir concerné par l’annonce de l’Évangile, et ce, dans le monde actuel avec tous ses défis. C’est la raison pour laquelle, François nous invitait à une transformation missionnaire. Pour la vivre, il nous faut approfondir le kérygme, tel qu’il se manifeste en mémorial dans la vie commune, et ainsi parvenir à la paix et à la joie.
Retenons en particulier dans ce texte, l’attitude pastorale d’accueil, de service et la nécessité d’un cheminement commun. Encore une fois on retrouve finalement l’intuition de Mgr Coffy à penser l’Église comme sacrement. Il faut cheminer ensemble.
Dans Evangelii Gaudium, François nous donne quatre principes dans son avant-dernière partie, au chapitre 4, pour construire une paix sociale, une paix juste et fraternelle, qui nous fasse vivre ensemble, en peuple de Dieu. Ces quatre principes sont tout aussi intéressants pour penser la liturgie comme point d’appui, comme pierre d’angle à toute mission pour l’évangélisation :
– 1e principe : le temps est supérieur à l’espace
Les liturgies se déploient dans le temps. Pensons à la liturgie pascale qui se déploie sur trois jours. Peut-être qu’il faudrait y réfléchir davantage. Et puis rappelons-nous ces temps mystagogiques qui devraient se déployer avant et après la liturgie ;
– 2e principe : la réalité est plus importante que l’idée
Dans nos liturgies, ce qui compte, c’est ce que l’on y fait. Ce sont les paroles qu’on prononce, les gestes qu’on pose, les attitudes, les postures, les déplacements, les objets, les lieux qu’on habite. Cette réalité-là est plus importante que toutes les idées. En effet, on peut avoir des idées sur l’évangélisation, mais là concrètement, physiquement dans la liturgie, tout nous est donné ;
– 3e principe : le tout est supérieur à la partie
Ce principe dérive du premier. Dans nos liturgies, la signification de tel geste, de telle parole n’est pas ce qui compte. Dans la liturgie, c’est toute la célébration qui fait mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, nous confère son esprit et nous ordonne ainsi à la mission de l’Église.
– 4e principe : l’unité prévaut sur le conflit
En matière de liturgie, il faudra se le répéter. Au-delà de nos chapelles, de nos querelles, de nos sensibilités, d’écoles, l’unité prévaut sur le conflit.
Voilà quatre conseils avisés pour une pastorale qui se veut liturgique, adressés à celui pour lequel la liturgie est d’importance décisive, afin que l’évangélisation puisse poursuivre sa course.
Pour terminer avec le pape François…
C’est évidemment dans Desiderio desideravi qu’il nous nous trace au mieux le chemin emprunté. Il s’agit ni plus ni moins d’une mise en forme pour aujourd’hui, de ce que l’Église ne cesse de réfléchir depuis 60 ans !
La liturgie, nous dit-il, est l’aujourd’hui de l’histoire du salut où Dieu marque son désir pour nous, qui est premier par rapport au nôtre. Alors, il va de soi que la liturgie est immanquablement la pierre d’angle de la mission. Et dans Desiderio desideravi, le pape reprend Sacrosanctum Concilium 7, parce que la liturgie se fait rencontre avec le Christ. C’est ainsi qu’elle devient la source première et indispensable à laquelle les fidèles peuvent puiser l’authentique esprit chrétien, dont la mission est une part décisive. Mais pour cela, il faut que la liturgie soit vraie et qu’ainsi elle puisse nous émerveiller, dit le pape. D’où la nécessité d’une formation à la liturgie, d’une formation par la liturgie.
Philippe Barras, 9 avril 2025
(reprise de l’enregistrement de la conférence prononcée lors des Journées nationales 2025 de la PLS, non relue par le conférencier)