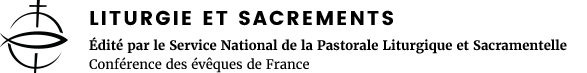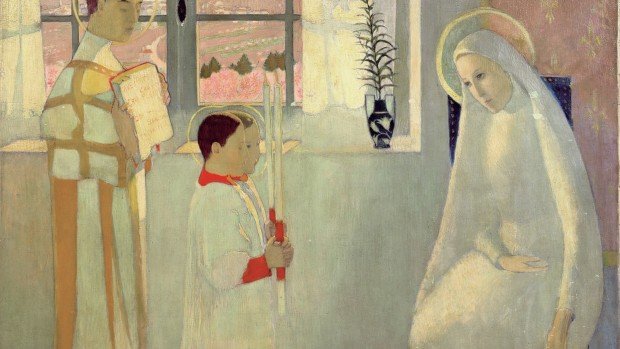Les yeux et l’esprit : l’expérience de L’Art dans les chapelles
Par Éric Suchère

Polly Apfelbaum à la chapelle St Jean le Sourn . LIFE IS NOT BLACK AND WHITE / La vie n’est pas tout blanc ou tout noir, 2017. Céramique émaillée, ficelle. Dimensions variables.
Lorsque l’on propose à des artistes contemporains de concevoir un projet artistique pour une chapelle consacrée, la plupart, sinon tous, réagissent avec précaution et humilité, conscients de la charge du lieu et de la nécessité d’aborder sa singularité avec encore plus d’attention qu’ils n’en auraient pour les murs blancs d’un espace commercial ou pour ceux des institutions dévolues à la monstration des pratiques artistiques.
On peut comprendre que ces bâtiments anciens, chargés d’histoire nécessitent une certaine précaution dans l’approche – d’autant plus que la plupart des édifices de L’art dans les chapelles sont inscrits ou classés. On peut, également, penser que nos traditions ou l’éducation nous ont transmis, que nous soyons croyants ou non, un certain respect pour ces lieux. On peut, enfin, imaginer que la spiritualité qui habite ces chapelles amène à les considérer d’une manière différente, autrement que comme des simples bâtiments – ne serait-ce que parce que certains les considèrent comme tels. La volonté de transgression est donc rare, sinon absente et il ne s’agit jamais de provoquer un heurt avec le lieu qui va accueillir leurs œuvres – même s’il peut arriver que certains artistes provoquent ce heurt malgré eux, n’ayant pas forcément connaissance de tous les arcanes de la symbolique chrétienne. La volonté de transgression, la provocation, la titillation, le grincement, l’ironie, le cynisme… tous ces modes que l’on peut retrouver naturellement dans des pratiques artistiques marquées d’une puissance critique par la modernité disparaissent dans un tel contexte – à moins que ce ne soit l’inconscient des différents directeurs artistiques qui ait empêché d’inviter des artistes capables de tels gestes.
Des différences de perception du rapport art et patrimoine
On ne peut, évidemment, catégoriser le public tant celui-ci peut être pluriel mais il me semble que deux attitudes sont envisageables dans la manière dont il reçoit – perçoit –, la présence de ces œuvres contemporaines non sacrées dans cette espace. On pourrait imaginer que la différence se ferait entre les croyants et les autres, mais ce n’est pas si sûr, même si cette distinction reste forte et qu’une personne croyante peut attendre une « certaine qualité » d’un objet placé dans un lieu qui est affecté, pour lui, d’une puissance symbolique. On pourrait imaginer que la différence se fait entre l’amateur d’art contemporain et l’amateur de patrimoine et cela serait sans doute plus juste. Non pas que l’un admettrait sans réserve les œuvres qu’il verrait et que l’autre les rejetterait sans partage, mais les attentes ne sont pas les mêmes et l’on peut admettre que les premiers consentiraient plus aisément à cette présence du temps contemporain dans un édifice ancien et que les seconds seraient peut-être plus circonspects, plus sur leurs gardes, devant un ajout – provisoire dans le cas de L’art dans les chapelles – perçu peut-être comme parasitaire à la qualité historique des lieux. Même s’il sait que les bâtiments purs sont rares et que de nombreux ajouts ont été faits au cours des siècles, ceux-ci ont été en quelque sorte validés par l’histoire et ont pris une patine que n’ont évidemment pas ces éléments récents. Il n’y a aucun fondement à cela et je ne vois pas en quoi l’adjonction de notre présent gâcherait la perception de notre passé – sinon dans une attitude qui vise à réfuter ce présent et à se réfugier dans le passé – mais cela importe peu comme, dans le domaine de la réception sensible rien n’est véritablement raisonnable.
La portée symbolique de l’art
En fait, la grande différence s’effectue dans le cadre d’un jugement de goût. Telle intervention paraîtra plus légitime parce qu’elle plaira et telle autre semblera déplacée pour celui qui ne la goûtera pas. On pourrait penser cela encore beaucoup plus simplement : le jugement de goût est, pour beaucoup, le facteur du sentiment de cohésion entre l’intervention artistique et le caractère patrimonial quelle que soit l’expertise du regardeur dans l’un ou l’autre domaine. Celui qui goûte peu les arts contemporains aura, donc, tout simplement, plus de mal à admettre cette présence et elle leur paraîtra illégitime sans que cette idée ne soit fondée – c’était le cas pour les œuvres de Gauthier Leroy à la chapelle Saint-Tugdual à Quistinic dont j’entends encore parler plusieurs années après qu’elles ont été exposées – et les explications, dans ce cas, ne servent à rien puisque le jugement est non fondé, sinon par le goût – il ne reste qu’à former le goût comme on le fait pour le vin, mais cela prend un certain temps.

Colin-Collin à la chapelle St-Tugdual, 2017
Un détour par l’histoire et par celle des fonctions des œuvres artistiques dans les édifices catholiques peut cependant nous aider à sortir de cette dichotomie assez peu féconde pour la réflexion et nous permettre de sortir de cette opposition artificielle dans la coprésence de l’art du passé et des pratiques contemporaines. Ce regard sur le passé peut, également, répondre à la question essentielle : pourquoi mettre des œuvres contemporaines non sacrées dans ces édifices ?
Grégoire le Grand (540-604), docteur de l’Église et pape, distingue trois fonctions à l’art dans les édifices religieux : l’instruction des laïques, la fonction mémorielle et la fonction compassionnelle. L’image est historia. Elle nous enseigne autant qu’elle nous rappelle le dogme – elle fonctionne comme un aide-mémoire – et, en même temps, nous permet littéralement d’accompagner la Passion. Dans le cas de ces trois fonctions, les œuvres contemporaines ne nous sont, effectivement, d’aucune utilité et elles peuvent même apparaître comme contraire à la fonction du lieu.
Au IXe siècle, Alcuin (732-804), archevêque d’York puis chef de l’école du Palais de Charlemagne et Théodulf d’Orléans (755-820), également membre de l’école palatine, ont rajouté, à ces trois fonctions, une fonction décorative ou ornementale. L’ornement (ornamentum) est à comprendre comme ce qui sied au lieu et permet l’accomplissement de la fonction liturgique en suscitant la contemplation. En cela, les œuvres d’art contemporaines conviennent au lieu puisque c’est, en partie, ce qu’elles proposent même si leur but est tout autre.
Ces quatre fonctions seront réaffirmées et l’abbé Suger (1080-1151), l’un des grands fondateurs de l’art gothique, mais il insistera sur la portée symbolique qui transcende toutes les autres. Cette portée symbolique « s’exprime par la faculté de s’élever à travers les choses visibles jusqu’à la contemplation des choses invisibles[1] ». Ainsi, sur une des portes de bronze de l’abbaye de Saint-Denis, l’on trouve cette inscription : « L’esprit engourdi s’élève vers le vrai à travers les choses matérielles, / Et plongé d’abord dans l’abîme, à la vue de la lumière, il ressurgit. » C’est, donc, par les choses matérielles, que nous atteignons les réalités invisibles[2]. L’image est matérielle mais elle transporte le regardeur, l’élève. Ainsi que l’écrit Suger, « Notre pauvre esprit est si faible que ce n’est qu’à travers les réalités sensibles qu’il s’élève jusqu’au vrai[3] ». Comme le souligne Jean-Michel Leniaud : « L’image religieuse ne se lit pas comme un simple récit, évangélique ou hagiographique ; son rôle ne s’en tient pas à l’expression d’un logos conceptuel, sinon il se résumerait à celui d’aide-mémoire[4] » et, reprenant Guillaume Durand, dit Guillaume de Mende (1230-1296) dans le Rationale divinorum officiorum (1286), « Chacune [image] déborde d’une douceur céleste lorsqu’elle rencontre un homme qui les examine avec attention et amour[5] ». Il faut l’union des deux pour entrer dans la compréhension de l’œuvre d’art, l’union donc, des yeux et de l’esprit. Si l’on oublie l’une de ces composantes, l’on passe à côté de l’œuvre. Si l’on privilégie son goût sans prêter attention au concept, l’œuvre reste inaccessible. Et Jean-Michel Lienaud de presque conclure : « En plein règne de Philippe le Bel, l’évêque de Mende enseigne les principes d’un savoir voir qui n’a rien perdu de son actualité quelle que soit la forme d’art dont il s’agit[6] ». L’œil se doit donc d’écouter et c’est ce que nous apprenne aussi les œuvres contemporaines qui ont, donc, toute leur place dans ces édifices pour qui sait et veut bien les accueillir et, ce, quelque soient les attentes des différents publics.
Écrivain né en 1967, Éric Suchère enseigne l’écriture à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne et est membre de l’AICA (Association internationale des critiques d’art). Il codirige avec Camille Saint-Jacques la collection « Beautés » et est le directeur artistique de la manifestation L’Art dans les chapelles (Morbihan). Il a publié plusieurs livres, dont Nulle part quelque (Argol, 2009), Brusque (Argol, 2011), Variable (Argol, 2014) et Fumées (Argol, 2017).
—
[1] Robert Dulau, « La reconnaissance des peintures murales françaises », dans Robert Dulau et Géraldine Albers, Peintures murales en France, XIIe – XVIe siècle, Paris, Citadelles & Mazenod, 2013, p. 20.
[2] L’abbé Suger reprend, en cela, la doctrine de Jean Damascène (676-749), défenseur des icônes.
[3] Cité par Robert Dulau dans Peintures murales en France, XIIe – XVIe siècle, op. cit., p. 33.
[4] Jean-Michel Leniaud, « Préface » dans Peintures murales en France, XIIe – XVIe siècle, op. cit., p. 9.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
Extrait du dossier L’Église et l’art contemporain, un dialogue fécond
Télécharger le dossier complet en PDF :