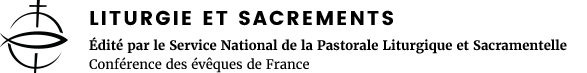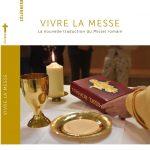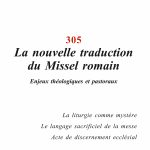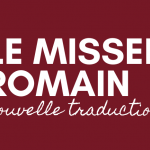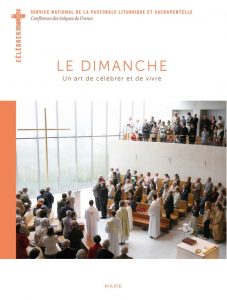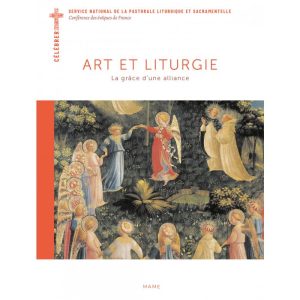Comment ce que nous vivons dans la liturgie fait devenir disciples-missionnaires ?
 La liturgie, ressource et repère pour l’évangélisation. Ce thème des Journées nationales 2025 de la PLS a conduit les participants à analyser beaucoup de situations occasionnelles Mais comment ce que nous vivons de manière ordinaire dans la liturgie nous fait-il aussi devenir disciples-missionnaires ? Le P. Gilles Drouin a proposé son regard de pasteur et de théologien.
La liturgie, ressource et repère pour l’évangélisation. Ce thème des Journées nationales 2025 de la PLS a conduit les participants à analyser beaucoup de situations occasionnelles Mais comment ce que nous vivons de manière ordinaire dans la liturgie nous fait-il aussi devenir disciples-missionnaires ? Le P. Gilles Drouin a proposé son regard de pasteur et de théologien.
Quand les organisateurs m’ont demandé d’intervenir dans vos journées, ils ont fortement insisté sur l’adjectif ordinaire dans la visée de la contribution commandée : « Comment ce que nous vivons de manière ordinaire dans la liturgie nous fait devenir disciples-missionnaires ? » Si je comprends bien les situations extraordinaires ont été traitées hier avec les trois forums consacrés aux initiatives missionnaires ; à ce que vous avez appelé les tiers lieux : les pèlerinages et les sanctuaires et les célébrations des baptêmes, mariages et enterrements. Il s’agirait donc pour moi de traiter de la dimension missionnaire de la liturgie ordinaire d’une vie paroissiale ordinaire. Ce qui me va plutôt bien.
En fait derrière cette insistance, n’y-a-t-il pas une intuition, ou une conviction selon laquelle la force missionnaire de la liturgie lui est intérieure, co-extensive et ne relève pas de la technique, de la performance. Ce serait par sa vertu propre que la liturgie serait ordinairement missionnaire et pas d’abord quand elle cherche à être extraordinaire, y compris pour être missionnaire ?
Avouons-le, on est tous tentés quand on aborde la question de la dimension missionnaire de la liturgie d’aller vite du côté de la technique, des techniques : comment faire pour que nos liturgies attirent davantage, en particulier les jeunes ? Ce sont des questions, qu’on n’aime guère entendre dans nos cercles un peu académiques mais qui sont omniprésentes quand on aborde la question avec les acteurs de terrain. Surtout dans une société fortement marquée par la performance, au sens technicien du terme. Or, depuis les origines du Mouvement Liturgique, – et Philippe Barras a dû vous le rappeler hier -, le monde des liturgistes est instinctivement réticent à ce qu’il qualifie assez vite d’instrumentalisation de la liturgie, quelles qu’en soient les visées. Missionnaires, catéchétiques mais aussi politique, moralisatrice etc. Et cette intuition n’est pas sans fondement puisqu’en arrière-plan de cette approche instrumentale il y a toujours plus ou moins une attitude technicienne qui vise à faire du programme liturgique consigné dans le Rituel un tutoriel dont l’exécution aboutit automatiquement, mécaniquement à un résultat. Ici, puisqu’on parle de mission, un résultat généralement quantifiable !
Le propos est à la limite de la caricature mais c’est évidemment pour souligner que cette manière de prendre la question se heurte au caractère absolument gracieux de l’action liturgique, surtout si nous la considérons selon les catégories théologiques du Mouvement Liturgique reprises par Vatican II d’action théandrique où c’est Dieu qui a l’initiative et qui agit en premier. Le pape François dans la Lettre apostolique Desiderio desideravi n’a pas de mots assez durs quand il adapte à la liturgie sa dénonciation du néo pélagianisme et du gnosticisme, en qualifiant de diabolique toute négation du caractère gracieux de l’action liturgique.
Les exemples abondent, notamment dans les communautés nouvelles que j’ai bien connues dans les années 90, alors que j’étais secrétaire général des JMJ. Soutenues par Jean Paul II, elles étaient alors en pleine gloire et beaucoup d’entre elles ont largement cédé à la fascination de l’efficacité, du nombre, et, souvent ont enrôlé la liturgie dans une entreprise qui relevait parfois plus du marketing, ou pire de la séduction que de la mission. Et l’on sait ce qu’il est advenu. La fécondité, qui ne relève pas de l’ordre strict de l’efficacité, ne se mesure pas dans l’immédiateté mais dans le temps, le temps long de la grâce.
N’empêche qu’il faut bien aborder la question, quelles que soient les chausse-trappes dont celle que je viens de développer n’est pas la moindre. Le Concile Vatican II, une boussole fiable pour reprendre le mot de Jean Paul II intègre la dimension missionnaire dès le tout début du grand traité sur la liturgie que constitue Sacrosanctum Concilium, au numéro 2, avant même que soient développés les principes structurants de la rénovation liturgique. C’est dire que la question est centrale. Je cite ce texte bien connu :
Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit, jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ, c’est d’une façon admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ, et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur les nations sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l’unité jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail et un seul pasteur.
Ce serait donc parce qu’elle construit l’Eglise que la liturgie agirait à la fois en formant des disciples-missionnaires (Le mot n’est pas employé mais l’idée est là) et par attraction, en levant un signal, un étendard sous lequel peu à peu ceux qui sont dehors se rassembleraient ! La Lettre apostolique Desiderio desideravi reprend cette idée d’attraction exercée dans la liturgie, moins par l’Eglise que par le Mystère lui-même. Pour François, les deux moteurs principaux de cette attraction exercée par la Liturgie sont le désir du Christ et l’émerveillement devant la puissante beauté du Mystère pascal qui constituent pour François
Sans céder, je l’espère à l’inclination très présente dans notre sainte Eglise de transformer périodiquement en mantras des expressions ou des idées qui nous ce faisant, nous dispensent de penser (Synodalité, mission, périphérie), il me semble que la notion de disciple missionnaire, présente dans le titre de ce qui m’est demandé rende bien compte de ce que je viens de tirer provisoirement de la Constitution et de la Lettre apostolique. Mais attention, si on suit le Concile ce sont certes les disciples « formés » par la liturgie qui sont missionnaires mais d’abord et surtout la communauté des disciples missionnaires, c’est à dire l’Eglise, ce point est essentiel. La lettre apostolique est, quant à elle, en cohérence avec l’idée selon laquelle pour être missionnaire il faut d’abord être disciple : le disciple est celui qui a répondu au désir premier du Christ et aussi celui qui s’est laissé toucher par la puissante beauté du Mystère du Christ que la liturgie épiphanise du même mouvement en le communiquant. Mais attention dans la logique interne de la Lettre, c’est d’abord le Christ qui est missionnaire dans la liturgie puisque c’est son désir de nous rencontrer qui est premier par rapport à notre propre désir de le rencontrer. Il est probable qu’une pneumatologie plus développée aurait permis de mieux exprimer les conséquences missionnaires du propos du pape, lesquels ne relèvent pas d’abord d’une théologie de la mission mais d’une théologie très christocentrée de la liturgie.
Mais je vais maintenant à dessein abandonner, temporairement, ces considérations théologiques pour prendre (ou reprendre) ma casquette de pasteur et essayer d’honorer tant la question ordinaire qui m’a été posée que ce que traduit la manière, un peu technicienne, de la poser que je citais, pour la dénoncer, au début de mon exposé. Que devons-nous faire ? Car en ces matières comme ailleurs il faut toujours entendre la voix du peuple saint, même si parfois le théologien doit prendre le recul de l’interprétation. Que devons-nous faire comme dans les Actes des Apôtres après la Pentecôte ?
Je partirai d’un constat qu’on pourra discuter mais que je pose sans chercher pour le moment de le justifier autrement que par l’expérience. Il est relativement facile, quand on est pasteur, avec sa communauté, de remplir une église, mais ça prend du temps…. Alors que pour la vider, il faut faire de vrais efforts mais alors ça va très vite !
Le paradoxe n’est qu’apparent, et il est en lien avec l’ordinaire de nos liturgies ordinaires que je n’oublie pas. Je crois fermement en effet, et il s’agit une fois encore du fruit d’une expérience qui commence à être longue, qu’une liturgie bien célébrée, de manière juste exerce de fait, sur la durée, une réelle capacité d’attraction, qui n’est pas sans lien avec celles que pointent avec un point de départ plus théologique les tout premiers numéros de la Constitution et de la Lettre apostolique. Il est difficile de qualifier ce que j’exprime faute de mieux en employant des expressions aux contours incertains : une liturgie bien célébrée, de manière juste. Ce qu’un Hameline appelait des concepts mous. Plus difficile que d’accumuler des techniques, de proposer des recettes pour attirer le chaland.
S’il est question de justesse, ou de justice, c’est dans le sens de la justice que Jésus évoque quand il répond à Jean Baptiste qui refuse de le baptiser, lui le seul juste : Laisse faire : il faut que s’accomplisse toute justice. La justice ou la justesse dont il s’agit dans nos liturgies, c’est me semble-t-il celui d’une humilité face à la grâce toujours première. Une humilité qui n’est surtout pas synonyme d’effacement, y compris dans l’action liturgique, mais une justesse à accueillir dans le jeu, au sens guardinien de l’articulation entre l’action de Dieu toujours première dans la liturgie et l’action de l’homme nécessaire, jamais secondaire mais toujours seconde.
Alors cette justesse, qui a un rapport avec l’humilité, elle se traduit par des choses très concrètes. Le pape en donne d’ailleurs quelques exemples hauts en couleurs à propos de la présidence liturgique dans la dernière partie de Desiderio desideravi.
Justice ou justesse, un ajustement qui laisse du jeu, humilité certes mais qui est aussi celle d’un travail bien fait. Le père Jounel aimait à dire qu’une liturgie était une œuvre artisanale. Il préférait, à juste titre à mon avis, cette comparaison à celle d’œuvre d’art. Une œuvre artisanale est une pièce unique inscrite dans une série, où chacune est différente, chacune a ses défauts mais chacune fait l’objet de l’engagement humble et compétent de l’artisan. Nous devons être de bons artisans, humbles mais compétents, de nos liturgies.
La compétence est par exemple, puisque je n’oublie pas mon idée de remplir une église, celle qu’exige la livraison d’une bonne homélie, solide et travaillée. Oh évidemment qu’une improvisation jouant sur l’affect aura du succès mais sur la durée, le travail humble de double écoute du texte et du Peuple est nécessaire et toujours payant ! La compétence de l’artisan vaut également dans un autre domaine sensible, celui du chant et de la musique, là aussi la virtuosité n’est pas la norme, mais la justesse et notamment le travail d’adaptation tellement mal en point au rite et au temps liturgique.
Je pourrais multiplier les exemples mais je crois profondément à l’importance de la compétence, au sens artisanal du terme pour rendre juste, ajustée la branche ascendante, celle de la réponse de l’action théandrique dans laquelle nous sommes tous embarqués quand nous célébrons la liturgie. Et cette compétence artisanale, aux antipodes du coup « missionnaire » isolé, a un impact en profondeur et dans la durée.
Mais il faut aller plus loin, parce que, comme artisans de l’action liturgique, nous sommes pris dans l’Opus Dei, dans la grand’œuvre de Dieu qui continue à sauver le monde. Et c’est là que la notion de disciple missionnaire va nous être utile. Nous ne pouvons pas nous suffire d’une compétence technicienne : l’ajustement doit également concerner l’articulation entre notre mode d’être, notre agir et le Mystère que nous célébrons. Et une fois encore je ne parle pas que des prêtres mais de tous les ministres et de tous ceux qui sont embarqués dans cette grande affaire. Le Concile ne dit-il pas que la Liturgie est l’exercice actuel de la rédemption, le mystère passé dans les mystères pour paraphraser Léon le Grand ? En liturgie, on n’est pas dans un mauvais théâtre ou dans un exercice d’exhortation morale. C’est une question de vie et de mort qui se joue dans chacune de nos liturgies, même les plus ordinaires. Les catéchumènes nous le rappellent chaque jour. Et je ne suis pas sûrs que tous, quel que soit leur mission dans l’assemblée célébrante, en soient vraiment convaincus. Alors, la cohérence entre notre manière d’être et le Mystère qui se joue dans nos liturgies est essentielle, pas d’abord pour une raison morale extérieure à la chose mais parce qu’il en va de la vérité de la chose. C’est là par exemple que la fraternité dans nos communautés, la réalité de la place faite aux plus pauvres, aux malades, aux handicapés dans nos liturgies est un juge de paix implacable. Et probablement aussi une condition essentielle de leur indoles missionnaire. Comment voulons-nous que nos communautés soient missionnaires si d’abord elles n’essaient pas d’ajuster leur manière de vivre, avec toutes leurs limites, avec toutes leurs fragilités au Mystère qu’elles célèbrent et annoncent ?
Il ne s’agit pas de pélagianisme, un piège redoutable sur ce chemin, mais simplement une prise au sérieux de ce qui est en jeu dans le Mystère qui se joue dans nos liturgies sur fond d’humble reconnaissance de notre inadéquation fondamentale.
Ce sont des choses très simples qu’en pasteur autant qu’en théologien je viens de développer :
L’ajustement dont il est question est un composé, instable et toujours à reprendre, d’humilité fondamentale, de compétence, de cohérence et de foi en ce qui est en jeu quand nous célébrons la liturgie. Cet ajustement, cette justesse de nos liturgies joue précisément sur les deux claviers évoqués par la Constitution dans son N° 2 :
– Elles forment des disciples heureux donc potentiellement missionnaires
– Elles développent naturellement une attractivité qui est celle du Christ lui-même à l’agir duquel elles sont transparentes.
Je crois que les jeunes générations sont finalement sinon équipées pour repérer les liturgies frelatées, qui fonctionnent sur la séduction, du moins les rejettent-elles sans hésiter quand elles en démasquent le fonctionnement car elles sont désormais vaccinées, davantage peut-être que ne l’était ma génération, face à l’arsenal de techniques développées par une société qui fonctionne de plus en plus sur des principes issus du monde de l’économie. Elles réclament ce qu’elles appellent faute de mieux de l’authenticité et sont allergiques à toute manipulation.
Alors oui je plaide modestement pour des liturgies simples, préparées avec soin et compétence, -ce que j’ai dit sur l’homélie, le chant et la musique pourrait s’étendre à de nombreux autres champs-, portées par des communautés fraternelles et c’est peut-être là que la question liturgique achoppe le plus en raison de son aptitude à épiphaniser l’Eglise. L’enjeu est de taille puisqu’il est de donner à voir et surtout à vivre des liturgies où les articulations entre ministères, ordonnés et laïcs, et fidèles, fonctionne de manière fluide, où les questions de genre, ou d’appartenance sociale ou culturelle ne se laissent pas capter par des questions politiques ou de sensibilité. Je suis peut-être irénique mais j’ai appris de mon long ministère de curé que la grâce de la messe dominicale (ordinaire) c’est de rassembler comme le dit Paul dans les galates des communautés où il n’y a ni jeunes, ni vieux, ni blancs ni noirs, ni chrétiens de gauches ni chrétiens de droite, ni riches ni pauvres, ni homosexuels ni hétérosexuels. Bien sûr que dans la communauté des galates il y avait des juifs et des grecs, des hommes et des femmes, des hommes libres et des esclaves, bien sûr que dans nos communautés il y a des blancs et des noirs, des jeunes et des vieux mais nous devons nous mettre à l’écoute de Paul qui était intraitable sur le fait que par-delà toutes ces grandes fractures de la société d’alors tous, hommes femmes, juifs, grecs, esclaves, hommes libres, tous ne faisaient plus qu’un dans le Christ Jésus. Je suis convaincu dans la foi et je sais d’expérience que ce type d’assemblée liturgique est puissamment missionnaire, par attraction et parce qu’elle engendre naturellement allais je dire, des disciples missionnaires.
Alors que devons-nous faire ? Cultiver la fraternité dans nos communautés. Mais attention pas en prenant en otage la liturgie pour forcer la fraternité, à la manière d’une idéologie. Prendre au sérieux ce que nous faisons quand nous célébrons la liturgie et probablement aussi croire vraiment à la puissance de nos rites. Préparer nos liturgies avec soin et compétence. Le tout dans une attitude d’humilité par rapport au Mystère que nous célébrons et aussi probablement de ce que le pape qualifie de discipline liturgique. Finalement comme pour remplir une église, c’est assez simple, il nous faut être d’humbles artisans, compétents, engagés et fraternels au service du Mystère que nous célébrons. Et par capillarité nos liturgies cristalliseront (au sens christologique du terme) le travail que l’Esprit entreprend bien en amont dans le cœur de ceux qui, un jour s’en approcheront.
Gilles DROUIN
ICP/THEOLOGICUM/Institut Supérieur de Liturgie
10 avril 2025
(la reprise de ce texte prononcé en écho aux remontées des forums conserve volontairement le caractère familier qui convenait à la situation)