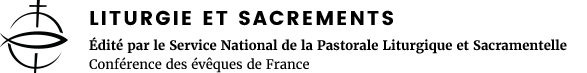L’art de l’Hymne
 Par le père Didier Rimaud, († 2003) prêtre jésuite, poète et compositeur français de chants chrétiens
Par le père Didier Rimaud, († 2003) prêtre jésuite, poète et compositeur français de chants chrétiens
Quand Jean-Sébastien Bach écrit sa dernière œuvre, l’Art de la Fugue, il ne disserte pas sur sa manière de composer : il accomplit la prouesse de réunir quatorze fugues à quatre voix sur un même sujet et son renversement. S’il enseigne, c’est en montrant ce qu’il sait faire.
L’art de l’hymne ? Comment honorer un tel titre ? Il faudrait, poète, être à l’hymne ce que Bach, compositeur de génie, est à la fugue. Nul ne peut prétendre à cela. On pourrait alors réunir ici, à défaut d’en être l’auteur, quelques poèmes liturgiques tellement exemplaires qu’ils parleraient d’eux-mêmes. Mais en réalité, suffirait-il encore de recourir aux grands anciens et de citer quelques hymnes d’Ambroise, de Prudence, de Grégoire de Nazianze, de Romanos le Mélode ou d’Ephrem de Nisibe ? Suffirait-il aussi de renvoyer au meilleur de la création française, inaugurée en 1950 par les recueils Les Deux Tables et Gloire au Seigneur, aboutissant aux nombreuses propositions de Prière du Temps Présent1 ? La simple lecture de ces modèles du passé et de ces créations modernes n’aiderait sans doute pas assez quiconque s’interroge aujourd’hui sur l’art de faire une hymne, comme on s’interroge sur l’art de faire du bon pain.
Les mots en attente
Comment écrire une hymne ? Y a-t-il un art spécifique d’écrire le texte d’un chant destiné à la prière du peuple chrétien, si telle est bien la définition que l’on peut donner de l’hymne liturgique ? Puisque le texte de l’hymne est un poème, sans doute va-t-il naître comme tout autre poème ? Y aurait-il une spécificité de l’art de l’hymne ? Avec cette question, je suis allé un long moment marcher dans une belle oliveraie en terrasse, comme pour interroger les oliviers dans la lumière d’un crépuscule du soir : comment faites-vous pour avoir ce feuillage ? Et comment se fait-il que vous donniez des olives ? Évidemment, ils ne m’ont rien répondu. Mais j’ai entendu bouger dans ma mémoire ce qu’écrivait Patrice de La Tour du Pin à la fin d’un de ses Psaumes2 :
« …Je fais mon poème comme un frêne ses feuilles
Pas la lumière, un frêne n’en fait pas. »
et le poète m’a dicté ma prière :
« Je t’en supplie, Seigneur, joue sur mes feuilles,
Avant de me reprendre tout entier chez toi. »
Qui saurait dire comment naît le poème ? Je peux avoir vu mille fois des fleurs de nénuphars sur des étangs sans qu’elles ne me disent rien ; et un jour, dans un jardin botanique d’Extrême-Orient, un lotus m’étonne et me fait écrire :
« La fleur de lotus
est si belle
au ras de l’eau,
qu’un bouclier
la protège
de son reflet. »
Je peux avoir perçu mille fois le cri nocturne de la chouette, comme s’il ne m’était pas adressé ; et un soir de Provence, en fermant les volets, son hululement me blesse :
« À l’orée de la nuit,
la chouette,
solitaire,
interpelle une étoile
qui ne lui répond pas. »
Je peux avoir des milliers de fois tendu les mains avec respect, main gauche posée sur main droite, comme pour former un trône royal, et avoir autant de fois répondu « Amen » à qui me donnait à manger le corps du Christ ; mais un jour, cet Amen routinier germe en moi, s’enracine et devient :
« Ne goûter qu’au seul corps qui ait le goût du pain,
Ne boire qu’à la coupe où l’on boit le seul sang,
Se greffer au seul cœur que la lance ait blessé. »
Ainsi peut naître l’hymne, quand se dépose quelque part en moi une semence verbale. J’accueille, je cueille, je recueille. Je ramasse, j’amasse. Je pose ensemble (je compose ?) les mots, tout comme des coquillages, des pierres, des bouts de bois ou des racines. En redescendant de l’oliveraie, l’autre soir, j’ai rencontré deux morceaux de genévrier dont j’ai su tout de suite qu’ils deviendraient un jour une image du Christ en croix et du serpent d’airain, comme une traduction de : « Ils contempleront celui qu’ils ont transpercé». Quelque part, ils attendent. Ainsi, les mots que je découvre et que je mets en réserve, en attente, dans le silence.
Oui, ainsi de l’hymne. Quelque chose m’est arrivé, qui m’a surpris. Qui m’a invité au détour, comme un buisson qui brûlerait sans faire de cendres. Par là, Dieu m’est advenu. Ou bien par là, je suis allé vers lui. J’ai crié, de douleur ou de joie, de honte ou de bonheur. Un cri d’abord sans voix. Peut-être un rugissement. Ensuite, il me faudra écrire le cri.
Et pourquoi l’écrire ? D’abord pour rien, pour personne, pour moi. Pour garder en moi le souvenir de ce qui me faisait crier. J’écris pour chercher le sens de ce qui m’est arrivé. Me dire, si possible, dans quel sens je suis mis en mouvement, ému ; à quel endroit j’ai été touché, blessé. Il y a une cicatrice. Toute écriture est une cicatrice, le souvenir d’une blessure, sa trace. À la fois pouvoir nommer cela, le saisir en lui donnant une forme, et puis m’en dessaisir en le projetant hors de moi, hors de ma portée, hors de mes prises : que je puisse donner ce qui m’a été donné.
J’écris aussi pour retrouver, et c’est parfois bien plus tard, celui qui est venu à moi à travers ce qui me faisait crier. Car il s’agit de traduire une rencontre. Je la traduis avec des mots. Mieux : je me traduis. Je traduis aussi l’autre de cette rencontre. Je nous traduis en poésie, comme on traduit en justice. Parce que je crois moi aussi (c’est une belle formule des éditeurs du Livre de la pauvreté et de la mort de Rainer-Maria Rilke) que « l’écriture et la poésie (sont) seules capables de contraindre Dieu à la révélation »3. C’est comme s’il fallait écrire pour provoquer Dieu à sortir de son silence. Ou pour ouvrir mes oreilles à son message « sans voix qui s’entende »4.
Mais je ne peux me contenter d’écrire l’hymne pour moi seul. Mon hymne est pour le chant. Écrire pour donner à chanter, pour mettre en musique, c’est autre chose qu’écrire pour mettre en mémoire. C’est écrire pour un acte vocal où l’écrit va disparaître. L’écrit disparaissant, le chant va prendre le relais du cri. Le chanteur va pouvoir rejoindre l’intérieur de celui qui a crié avant l’écriture de son cri. Celui qui chante « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »5 revêt les sentiments du Christ en croix criant vers son Père. Il rejoint les sentiments de celui qui, bien au-delà dans l’histoire, a crié avant jésus. Jésus reprend les mots de quelqu’un pour en faire son propre cri devant la mort, et interroger son Dieu. Désormais, tout homme a le droit, par lui, avec lui et en lui, de prier ainsi.
Écrire pour le chant, c’est écrire pour d’autres, mais non pas prétendre écrire le chant d’un autre. C’est offrir à l’autre l’écriture de mon cri pour qu’il puisse lui-même s’en saisir, en faire son chant et entendre par là, en lui, le cri qui a suscité en moi la nécessité d’écrire.
Écrire pour quelqu’un, comme écrire à quelqu’un, ce n’est pas d’abord me situer devant lui, comme en sa présence, pour savoir quoi lui dire et comment. C’est me situer devant le mystère qui m’habite, devant le mystère qui m’interroge avant que je sache quoi en dire. Me tenir, parfois longtemps, dans le silence, tant que ce mystère ne me parle pas. Audace des audaces : le modèle ici serait saint Jean, l’auteur de l’Apocalypse : « Ce que tu as vu, écris-le »6. Oui, il faudrait n’écrire que ce que Dieu a donné de voir. Et d’entendre.
Une réponse d’homme à la parole de Dieu
L’hymne ne devrait jamais être qu’une réponse d’homme à une parole de Dieu qui se fait entendre d’abord. Et Dieu se fait entendre en liturgie : « car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière »7.
Il faut alors avoir l’audace et l’humilité de tenter une réponse qui ne soit pas trop indigne de la Parole première. Mon hymne doit voisiner et tenir debout avec les plus célèbres poèmes de l’humanité, comme sont, par exemple, ceux d’Isaïe, de Job, de David, de Jérémie, de la Vierge Marie, de Jean et de Paul. N’est-ce pas auprès de ceux-là qu’il faut apprendre l’art de l’hymne ? Dieu qui, si souvent dans la Bible, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l’Ancien, a parlé par la voix de ses poètes, montre aux poètes d’aujourd’hui où trouver et comment donner au peuple les mots de sa prière.
Bien sûr, les mots de la prière chrétienne, ceux qui viennent de Dieu et que nous lui retournons (ce sont les psaumes avec les hymnes et cantiques de l’un et l’autre Testament) ont la première place. Comment mieux parler de Dieu, ou à Dieu, qu’avec les mots que lui-même nous donne ? Et les chrétiens d’aujourd’hui, avec Le Psautier8, ont heureusement retrouvé dans leur langue ces beaux chemins de prière. Mais, à côté de ces mots de Dieu, comme en écho, il y a place pour des mots d’hommes d’aujourd’hui. (…)
Article extrait de la revue Célébrer n°333, janvier 2005
—
- Liturgie des Heures en langue française. Éd. Cerf, Desclée, Desclée de Brouwer, Mame. 1980 / 1993.
- Psaumes de tous mes temps, Éd. Gallimard, 1974, p. 42.
- Rainer-Maria Rilke, Le Livre de la pauvreté et de la mort, Traduction d’Arthur Adamov, Éd. Actes Sud.
- Psaume 18, 4.
- Psaume 21.
- Apocalypse 1, 11.
- Constitution sur la sainte liturgie de Vatican II, n° 7.
- Version œcuménique, texte liturgique, Éd. du Cerf, 1977.