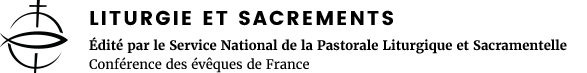Confirmer les adultes plus tard que le jour de leur baptême ?

1er juin 2008: Onction avec le saint chrême des confirmands lors des confirmations d’adultes à la basilique de Saint-Denis (93), France.
Les catholiques sont de plus en plus nombreux à recevoir la confirmation à l’âge adulte. Certains ont demandé à recevoir le baptême une fois adultes et la pratique est souvent d’attendre quelques mois pour leur proposer la confirmation. D’autres baptisés enfants n’ont pas souhaité – ou eu l’occasion – demander la confirmation à l’adolescence mais, pur xievers rajons, en ont eu le désir devenus adultestard. Or la confirmation est l’un des trois sacrements de l’initiation chrétienne et la tradition incite, à l’âge adulte.
Réflexions entre théologie et pastorale.
En principe, un adulte reçoit la confirmation aussitôt après son baptême…
On connaît les insistances du concile au sujet des sacrements de l’initiation. « Les trois sacrements de l’initiation chrétienne s’enchaînent pour conduire à leur parfaite stature les fidèles qui « exercent pour leur part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien » » [Praenotanda des divers rituels du baptême, n° 2, avec citation de Lumen gentium, 31]. La révision du rituel de la confirmation a été demandée par le Concile, puis entreprise, « pour manifester plus clairement le lien intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne » [Sacrosanctum concilium, 71]. Et si le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité prévoit la « possibilité » pour le prêtre de confirmer ceux-ci sitôt après leur baptême (n° 90 et 118) et requiert « toujours » leur participation à l’eucharistie ce même jour (n° 90 et 123), c’est afin « de rendre manifeste que les trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie sont les sacrements d’une unique initiation chrétienne, et non les sacrements d’étapes psychologiques » (90). Cela vaut a fortiori pour les adultes, comme le montre le rituel qui leur est propre : celui de 1974 déclare que l’« on fait normalement l’imposition des mains et la chrismation de la confirmation immédiatement après le baptême », sauf « pour de sérieuses raisons pastorales » (n° 6.07) ; le rituel révisé de 1997, au n° 176 (= RR 34), est plus ferme encore : « Selon l’usage le plus ancien, toujours observé dans la liturgie romaine elle-même, un adulte ne sera pas baptisé sans recevoir la confirmation aussitôt après son baptême, sauf si de graves raisons s’y opposent. » Une note précise : « Il est possible que, dans un cas particulier, l’Évêque (l’Ordinaire du lieu) juge qu’il y a des raisons vraiment sérieuses en ce sens. En pareil cas, on veillerait à ce que le lien avec le baptême soit manifesté, et le contexte pascal respecté. »
… mais, aujourd’hui, elle est souvent reportée pour diverses raison
Dans de nombreux diocèses en France, les évêques ont jugé qu’il existait « des raisons vraiment sérieuses » pour reporter la confirmation des adultes environ une année après leur baptême. La raison majeure invoquée en ce sens ne manque en effet pas de poids pastoral : il s’agit de la difficulté qu’éprouvent de nombreux néophytes à s’intégrer dans leur communauté d’Église locale, à s’insérer dans un groupe de réflexion et/ou de prière, à y trouver le type de responsabilité missionnaire qui leur convient. Tant que leur lieu d’Église était constitué prioritairement par le groupe de catéchuménat, groupe de petite dimension où l’interaction et l’implication étaient relativement fortes, ils se sentaient nourris et soutenus dans leur découverte du Christ grâce à la réflexion à partir de la Parole de Dieu, à la prière et au partage de leurs expériences. Vient cependant le moment où il leur faut quitter ce groupe généralement chaleureux. Le deuil qui est alors à faire est assez souvent difficile à vivre. Le risque est grand pour eux, comme le montre l’expérience, faute de pouvoir trouver chaussure à leur pied dans la paroisse, de prendre leurs dis- tances par rapport à l’Église et de voir s’effriter leur foi encore fragile. Une période d’une année après leur baptême, un baptême non encore « achevé » par la confirmation, paraît ainsi leur fournir ce « sas » dont ils ont besoin pour pouvoir « se faire » à la communauté chrétienne locale et y trouver leur pleine mesure. Le sacrement de la confirmation, porté par une théologie qui le met en rapport avec l’Église et la mission, paraît tout indiqué comme ultime étape de leur initiation, un an après leur baptême.
D’autres arguments, moins importants, sont avancés en faveur de ce report de la confirmation. Notons particulièrement celui-ci : préparer les catéchumènes au baptême, entend-on parfois, est déjà difficile ; les préparer également à l’eucharistie crée une difficulté supplémentaire ; s’il faut, en plus, les préparer à la confirmation, cela devient presque impossible ! Autant le premier argument a de la force, autant celui-ci ne tient pas, si du moins on comprend la confirmation dans son lien intrinsèque au baptême dont elle n’est rien d’autre que l’« achèvement». Le principe théologique à ce propos revient à dire que c’est à partir de sa célébration sitôt le baptême, durant donc la même célébration, que la confirmation est d’abord à comprendre, et non pas à partir de sa séparation d’avec ce dernier – si légitime que soit par ailleurs cette séparation. Cela veut dire que les adultes qui sont prêts pour le baptême le sont également pour la confirmation dès lors que celle-ci est comprise, ainsi qu’on le voit dans l’Antiquité chrétienne, comme un élément de l’ensemble « baptême ».
La séquence antique « baptême – confirmation – eucharistie » mise à mal
Ce qui pose question du point de vue théologique n’est d’ailleurs pas, du moins pas d’abord, le fait que la confirmation soit temporellement séparée du baptême en Occident, mais le fait qu’elle soit reçue après la première eucharistie. Comment, en effet, justifier théologiquement l’énoncé traditionnel selon lequel l’eucharistie constitue le sommet de l’initiation, puisqu’elle intègre pleinement au corps ecclésial du Christ par la réception de son corps eucharistique, alors que l’on n’a pas reçu la « marque de l’Esprit-Saint » ? N’est-ce pas, selon la tradition, l’Esprit qui fait l’Église du Christ ? Celle-ci n’appartient-elle pas au troisième article du Credo ? Les essais pour justifier théologiquement l’ordre « baptême – eucharistie – confirmation » n’emportent pas la conviction. Il n’y a pas à se scandaliser qu’une pratique, même sacramentelle, repose sur une théologie qui paraît boiteuse : les précédents sont nombreux dans la tradition à cet égard, qu’il s’agisse notamment de la pénitence, du mariage ou de l’ordination. Mais il convient de corriger ce qui peut l’être. À cet égard, il faut, nous semble-t-il, distinguer le cas des adultes (a) de celui des enfants et des jeunes (b).
Pour les adultes, revenir à la séquence « exemplaire » mais en intégrant une année « pédagogique » ?
a) Le retour à la séquence « exemplaire » baptême – confirmation – eucharistie paraît possible aujourd’hui, du moins dans le cas, théologiquement exemplaire lui aussi, des L’Église romaine éviterait ainsi de se voir reprocher par les Églises orientales de retirer par sa pratique ce qu’elle accorde pourtant si clairement dans sa théorie. Mais alors comment remédier à la difficulté pastorale signalée plus haut ? Car elle est suffisamment profonde et massive pour qu’il paraisse pastoralement impératif d’y remédier. On ne peut en tout cas se contenter de lâcher les néophytes « dans la nature ». C’est d’ailleurs pourquoi le groupe qui les a accompagnés jusqu’aux sacrements de l’initiation leur offre très fréquemment une année supplémentaire de cheminement. Cette année vise généralement un double objectif : la préparation des néophytes à la confirmation et leur insertion dans la communauté locale. On fait valoir la cohérence entre les deux : de par son rapport avec la Pentecôte, la confirmation, sacrement à forte dimension ecclésiale et missionnaire, n’est-elle pas tout indiquée pour permettre aux nouvellement baptisés de trouver leur place et leur rôle dans l’Église ?
Sans aucunement méconnaître la référence pentecostale de la confirmation, on peut cependant objecter que l’accentuation théologique de cette référence, et du même coup de la dimension ecclésiale et missionnaire de ce sacrement, est elle-même largement l’effet de la pastorale qui a conduit à le reporter assez loin du baptême et de l’eucharistie. Certes, la théologie, dans le domaine sacramentaire notamment, a fréquemment servi de justification de la pratique ; mais cela autorise-t-il à « utiliser » un sacrement à des fins pédagogiques, comme cela semble bien être le cas en l’occurrence ? Il semble en tout cas possible et réaliste de proposer autre chose.
– En premier lieu, on ne peut que souhaiter que se généralise l’adoption d’une année postbaptismale. Comme année « mystagogique » d’une part, elle doit permettre aux néophytes de s’approprier les « mystères » par lesquels ils ont été initiés, et ainsi d’approfondir leur foi et de consolider leur vie chrétienne. Comme année « pédagogique » d’autre part, elle doit leur fournir ce temps transitionnel d’insertion dans leur communauté d’Église dont ils ont tant besoin.
– En second lieu, on peut souhaiter, sans faire de mauvais « archéologisme », que quelque chose comme l’antienne « pascha annotina », la fête anniversaire de la réception des sacrements de l’initiation, ait lieu au terme de cette année, durant le temps pascal. Il s’agirait d’une journée de rencontre de tous les néophytes avec l’évêque. Une telle rencontre serait de nature spirituelle, telle une récollection. Pour les raisons que l’on va expliciter, cette journée serait structurée par la célébration du sacrement de la réconciliation : lectures de la Parole de Dieu, temps personnel de réflexion et de prière, moment de partage d’expériences entre néophytes, catéchèse et exhortation par l’évêque, temps de confession, et, avant l’eucharistie qui clôturerait la rencontre, absolution de chacun par l’évêque.
Pourquoi le sacrement de la réconciliation ? Parce qu’il est, traditionnellement, celui de la replongée « à sec » dans le baptême. Or c’est bien cela qui convient au bout d’un an d’expérience chrétienne : « baptisé, qu’as-tu fait de ton baptême ? Comment lui as-tu été fidèle ou non ? À quoi Dieu t’appelle-t-il ? » On pourrait donc imaginer que, au cours de cette journée, des plages de temps soient prévues pour donner aux néophytes la possibilité de faire le point sur le plan spirituel et de confesser leurs péchés à un prêtre ou à l’évêque ; mais on réserverait à ce dernier la parole et le geste (imposition des mains) d’absolution, laquelle serait donnée à chacun personnellement, par exemple au moment du rite pénitentiel qui ouvre l’eucharistie ; ce moment serait évidemment un peu développé. Cette imposition des mains « in paenitentiam » par l’évêque, différente bien sûr de celle de la confirmation, mais pas sans lien pneumatologique et ecclésiologique avec elle, trouverait là une belle ré-actualisation de son sens.
– Cette proposition offrirait au moins trois avantages : 1) On remédierait (autant qu’on le pourrait) à la difficulté pastorale signalée plus haut sans avoir à reporter pour cela la confirmation un an après le baptême. 2) On permettrait ce rapport à l’évêque – premier responsable du catéchuménat -, rapport déjà vécu lors de l’appel décisif et qu’il est souhaitable de manifester dans les sacrements eux- mêmes de l’initiation. Ce rapport s’effectuerait à nouveau, non plus certes dans l’initiation chrétienne elle-même, mais dans le cadre ou dans la dynamique directe de celle- ci, puisqu’il aurait lieu à l’époque approximative de son premier anniversaire ; on aurait alors affaire à une véritable « mémoire » de cette initiation, non seulement sous le mode de la catéchèse et de la parénèse, mais, plus encore, sous celui du sacrement : en l’occurrence, à travers le sacrement de la « reprise » du baptême qu’est la réconciliation. 3) On manifesterait bien du même coup la place que ce sacrement est appelé à trouver chez les néophytes tout au long de leur vie chrétienne.
Pour les enfants et les jeunes, maintenir l’actuelle séquence initiatique en raison des conditions culturelles d’aujourd’hui ?
b) En revanche, la confirmation conserverait pour le moment sa place habituelle pour les enfants et les jeunes. Car, vouloir à tout prix la replacer avant la première eucharistie reviendrait à détruire plus qu’à construire l’Église de Dieu. Il est clair en effet que la préparation de ce sacrement, le plus souvent au long d’une année, et sa célébration au moment de l’adolescence portent souvent de bons fruits spirituels et missionnaires dans la vie des jeunes. Dans les conditions culturelles et sociales actuelles, qui leur rendent particulièrement difficile de se positionner comme chrétiens, on peut regarder la proposition de « quelque chose » qui leur permette de prendre personnellement en compte l’initiation chrétienne reçue comme un impératif pastoral. On peut certes regretter, ici encore, que ce « quelque chose » soit la préparation et la célébration de la confirmation. Mais il ne saurait être question, à nos yeux, de remettre cela en cause tant que l’on n’a pas autre chose à proposer aux jeunes au moment de leur adolescence, et autre chose qui leur apparaisse comme suffisamment sérieux pour leur permettre de vivre, durant une année environ, qui est souvent pour eux une « année de grâce », le même type de cheminement spirituel que celui que leur offre l’actuelle confirmation. On ne peut exclure a priori que leur soit faite une proposition assez analogue à celle qui a été esquissée ci-dessus pour les néophytes adultes : rapport à l’évêque et sacrement de réconciliation comme reprise de leur baptême. S’il n’est pas du tout certain a priori que ce type de proposition serait aussi mobilisateur pour les jeunes que la confirmation comme sacrement qui boucle leur initiation chrétienne, il vaudrait cependant la peine de tenter l’expérience ici ou là.
c) L’écart entre les deux propositions pastorales que l’on vient de faire, selon que l’on s’adresse à des néophytes adultes ou à des jeunes, a sa cohérence théologique. La restauration pour les adultes de la séquence « baptême – confirmation – eucharistie » signifierait que l’on considère effectivement cette séquence comme théologiquement « exemplaire ». Or cette restauration semble aujourd’hui possible pour les raisons susdites ; en tout cas, elle ne paraît pas courir le risque d’aller à rencontre de leur construction spirituelle et missionnaire, ce qui ne semble pas être le cas pour les jeunes et les enfants. Pour ces derniers, la proposition de maintenir, au moins provisoirement, l’actuelle séquence initiatique est liée au principe éminemment théologique, ou plutôt évangélique, du « sacramenta propter homines » : un peu comme « le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 27), les sacrements sont pour le bien spirituel des fidèles. C’est précisément cet argument du « bien spirituel » qui justifie, selon le concile de Trente, le pouvoir de l’Église sur les modalités de proposition et de célébration des sacrements : « L’Église a toujours eu, dans la dispensation des sacrements, leur substance étant sauve, le pouvoir de décider ou de modifier ce qu’elle jugeait convenir à l’utilité spirituelle de ceux qui les reçoivent ou au respect des sacrements eux-mêmes. » L’application de ce principe, en ce qui concerne les jeunes et les enfants, à notre actuelle séquence de l’initiation chrétienne, se justifie pour deux raisons principales : d’une part, l’ajustement sur la tradition « exemplaire » risquerait de compromettre la finalité spirituelle qui vient d’être évoquée ; d’autre part, on a affaire, dans l’Église latine, à une tradition « dérivée » relativement longue, tradition que l’on peut juger comme quelque peu « boiteuse » du point de vue théologique, mais qui ne contredit pas la première, laquelle n’a pas été considérée comme normative dans cette même Église latine.
Tout cela rappelle que, si important qu’il soit, le recours à la « tradition » ne peut évidemment être le seul déterminant du discours théologique, même en sacramentaire : la « praxis ecclesiae », la « mission », le « bien spirituel » des fidèles en sont des paramètres majeurs. Ne pas en tenir suffisamment compte porterait atteinte à la nature même de la théologie, laquelle requiert nécessairement un moment herméneutique. C’est en tout cas une telle reprise herméneutique de la Tradition vivante que l’on a tentée dans cette brève note.
L.-M. CHAUVET.
(Ce texte reprend sans ses notes l’article publié par l’auteur dans La Maison-Dieu, 211, 1997/3, 55-64. Les sous-titres ont été ajoutés. Pour télécharger l’article original, voir le lien ci-contre).
Télécharger l’article complet en PDF :