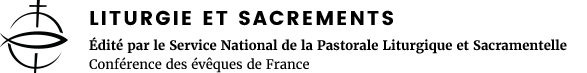La prière universelle, intercession de tous les fidèles pour la venue du Royaume

Quand on parle de la prière universelle, on désigne précisément la prière d’intercession que l’on fait à la messe, après avoir écouté la Parole, et avant d’entrer dans la grande prière eucharistique. On en trouve des réalisations similaires dans la Liturgie des Heures, par exemple, qui ne la propose cependant pas de manière identique puisqu’à Laudes la prière, en plus des intercessions, comprend aussi des louanges.
Par cette prière, le peuple de Dieu met en œuvre l’injonction du Nouveau Testament : « Je recommande donc, avant tout, que l’on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui détiennent l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité » (1 Timothée 2, 1-2). Les évangiles, particulièrement celui de Luc, recommandent vivement de « prier constamment et de ne pas se décourager » (Luc 18, 1-2). Et encore : « Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d’échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme » (Luc 21, 36). Alors comment mieux comprendre la prière universelle, son rôle ? Commençons par un brin d’histoire…
Une prière ancienne…
Dès les premiers témoignages sur la messe, celui de saint Justin par exemple, à Rome vers l’an 150, la prière universelle est attestée : « Nous faisons avec ferveur des prières communes pour nous, pour ceux que nous venons de baptiser, pour tous les autres en quelque lieu qu’ils soient, afin d’obtenir, avec la connaissance de la vérité, la grâce de pratiquer la vertu et de garder les commandements, et de mériter ainsi le salut éternel » (Saint Justin, 1e Apologie 65, 2).
Ultérieurement, de nombreux Pères de l’Église y font allusion. Saint Augustin et Prosper d’Aquitaine s’appuient même sur l’existence de cette prière pour défendre la rectitude de la foi contre ses contradicteurs, notamment les Pélagiens, négateurs de la grâce, en affirmant que « la prière est la preuve la plus évidente de la nécessité de la grâce » (Augustin, Ep.177, 4).
De cette époque nous sont parvenus quelques formulaires de prière universelle. Le plus vénérable, et le plus connu, est celui qui s’est maintenu depuis lors le vendredi saint ; formulaire très ample, qui fait suivre neuf (aujourd’hui dix) invitations à prier, et les oraisons correspondantes. On a aussi conservé quelques litanies, c’est-à-dire des prières bâties sur une alternance rapide de demandes et de répons, en une formulation très dynamique et populaire. Le fleuron en est la prière composée par le pape Gélase (492-496), que la Liturgie des Heures a reprise partiellement pour les intercessions du jeudi de la 4e semaine. La fin de la litanie des saints nous a aussi gardé des demandes qui ont pu être celles de l’ancienne prière universelle.
… supprimée et restaurée
Cependant la prière universelle a été supprimée. C’est en tout cas extrêmement probable, car on n’en trouve aucune trace dans les livres anciens, ancêtres de notre missel. Elle refit pourtant surface au moyen âge, dans ce qu’on appelait en France les « prières du prône », située à la fin du sermon.
Les deux faits sont intéressants à considérer. Sa suppression d’abord, car cette prière peut devenir fastidieuse, et ses demandes se transformer en « kyrielles » sans intérêt ; le fait ne manque pas de nous mettre en garde. Mais sa renaissance ne manque pas d’intérêt non plus, car le cri de l’humanité vers Dieu, notamment en cas de détresse, est un des traits de toute religion, sur toute la surface de la terre.
Le Mouvement liturgique a mis la restauration de la prière universelle à son programme. Plusieurs études avaient paru, avant le Concile, souhaitant que la messe intègre à nouveau cette forme de prière(1). Ce vœu fut accompli, puisque la Constitution sur la liturgie l’exprime avec détermination en son n° 53.
« La “prière commune” ou “prière des fidèles” sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du peuple on fasse des supplications pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’autorité publique, pour ceux qui sont accablés par diverses nécessités, et pour tous les hommes et le salut du monde entier. »
La prière universelle ? Une « prière des fidèles » !
C’est une prière de demande ; le texte conciliaire, citant l’épître à Timothée, parle de supplication ! Et qui est convié à supplier ? La Présentation générale du Missel romain, à la suite du concile, dit : « Dans la prière universelle, ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de Dieu reçue dans la foi et, exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu des prières pour le salut de tous » (n° 69)
Le sujet en est donc bien le peuple de Dieu. Cependant, comme toute prière liturgique, la prière universelle est structurée ; elle commence par une invitation du président de l’assemblée, qui la conclut aussi par une oraison ; entre les deux, des intentions de prière sont proposées, suivies le plus souvent d’un refrain.
Comment comprendre cette structure, et ses acteurs ? Risquons un schéma :
invitatoire : « Après avoir écouté la Parole de Dieu, prions, frères et sœurs, … »
intentions / prières, avec refrain ou silence
Amen
Le début est similaire, sinon qu’à la prière universelle il est habituellement un peu plus développé que le simple « Prions le Seigneur » ; l’essentiel, c’est que les deux formes de prière commencent par inviter l’assemblée à prier. Mais la prière proprement dite ne se réduit pas au texte de l’oraison ; elle se réalise, dans l’oraison d’ouverture de la messe, par un temps de prière silencieuse de toute l’assemblée, qui est ensuite reprise, « collectée » par le prêtre qui énonce la prière à haute voix, au nom de toute l’Église.
Dans la prière universelle, par contre, la forme silencieuse de la prière est remplacée par les « intentions », qui offrent à la prière de l’assemblée un objet : « Prions pour que notre assemblée entende la parole des Béatitudes », ou des bénéficiaires : « Prions pour ceux dont la foi est vacillante. »
Qui donc prie ? Tout le peuple de Dieu, comme l’indique le concile, qui utilise aussi une autre expression pour désigner la prière universelle : la prière des fidèles. Lorsqu’on a entendu ces mots, il y a trente ans, on s’est précipité sur cette prière, heureux de trouver enfin dans la messe une prière « pour nous » ; et dans combien de cas la préparation de la messe ne se réduit-elle pas à « préparer les intentions » ? Malheureusement, cette réaction montre que notre idée de l’Église était bien misérable, puisque nous avions identifié « fidèles » à laïcs, distincts du prêtre. Et, se réjouissant d’avoir enfin une prière « à soi », on « abandonnait » toutes les autres au prêtre ! En fait, dans cette expression, fidèles est pris au grand sens de baptisés, ceux qui ont professé la foi, laïcs et prêtres tout ensemble, et par distinction des catéchumènes. Le contraire de fidèles est infidèles ou « pas encore fidèles », et non pas prêtres !
On peut ainsi retrouver que toutes les prières liturgiques sont des prières des fidèles, c’est-à- dire de toute l’Église, des prières dans lesquelles les membres de l’Église exercent cependant chacun leur rôle propre, le président de l’assemblée y invitant, et rassemblant comme en un faisceau, grâce au texte de l’oraison, la prière silencieuse de tous les chrétiens présents. Les oraisons, selon le schéma présenté ci-dessus, ne sont pas la propriété du prêtre, puisqu’il commence par inviter toute l’assemblée à prier. Et si le n° 69 de la PGMR précise que le peuple de Dieu exerce dans la prière universelle sa fonction sacerdotale, c’est de façon plus particulière, mais évidemment pas de manière exclusive. La prière eucharistique elle-même est une prière de toute l’Église ; tous répondent d’ailleurs « Cela est juste et bon » au projet énoncé par le prêtre « Rendons grâce au Seigneur notre Dieu », ce qui pourrait se traduire : « Faisons (ensemble) l’eucharistie. »
Comment vivre cette prière ?
Regardons de plus près ce qu’on appelle « les intentions ». En fait, il y en a de deux types :
– certaines sont des invitations à prier, adressées à l’assemblée (« Prions pour… ») ; on peut considérer qu’elles prolongent l’invitatoire du prêtre ; ce sont, au sens strict, des « intentions de prière », qui en donnent les orientations ;
– d’autres sont adressées à Dieu (« Nous te prions pour ceux qui désespèrent ») ; ce ne sont pas à proprement parler des « intentions », mais des prières que toute l’assemblée adresse à Dieu ; les demandes sont formulées pour que tous les fidèles coulent leur prière en ces mots. Elles s’expriment déjà à la manière de l’oraison conclusive.
Quand donc l’assemblée est-elle en acte de prière ? Dans le cas des « intentions », la prière s’exprime par le refrain (« Seigneur, écoute notre prière ») et le silence qui suit l’intention ; le n° 71 de la PGMR prévoit explicitement cette manière de procéder. Dans l’autre cas, la demande étant rédigée sous forme de prière, l’assemblée doit prendre une autre attitude intérieure, non plus seulement celle d’écouter l’intention qu’on lui propose, mais de prier déjà à l’aide des mots qu’on lui présente ; le refrain ne fait alors que prolonger le mouvement de la prière déjà commencée, et on comprend, que le silence est encore mieux venu lorsqu’on utilise cette deuxième forme.
Quel est donc le rôle de la personne qui lit le formulaire de la prière universelle ? Ce n’est pas du tout le rôle d’un lecteur de la Parole de Dieu, qui proclame à l’assemblée une page de saint Paul. Ici, ou bien la personne invite l’assemblée à prier, ou bien elle exprime la prière de l’assemblée elle-même ; on comprend que l’attitude de la personne, et son ton de voix, devront être différents dans l’un et l’autre cas. Il y a cependant une ressemblance avec la lecture biblique ; comme le lecteur proclame à l’assemblée une Parole qui s’adresse à tous, c’est-à-dire à lui-même également, la personne qui lit une intention doit aussi se l’adresser à elle-même ; si elle lit une prière, elle devra le faire en priant intérieurement.
Une école de prière pour « que ton Règne vienne »
La Présentation générale du Missel romain indique en son numéro 70 pour qui et pour quoi prier « habituellement » tout en soulignant la possibilité d’’appliquer le schéma proposé « plus exactement » à une « occasion particulière ». Il ne faut donc pas être trop systématique, mais, en réponse « à la parole de Dieu reçue dans la foi » (n° 69), assurer l’ouverture vraiment universelle de la prière.
Il est intéressant à cet égard de repérer la différence entre les intercessions de la prière universelle et celles que l’on trouve à la fin de la prière eucharistique. En principe, ces dernières nomment d’abord ceux avec lesquels l’assemblée se trouve en communion pour célébrer l’eucharistie, notamment l’évêque de Rome et celui du lieu. Puis, elle intercède principalement pour les chrétiens, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, qui participent d’une certaine manière à l’eucharistie célébrée, afin qu’ils en bénéficient, qu’ils soient pris eux aussi dans le mouvement de communion auquel elle tend. De soi donc, les intercessions de la prière eucharistique sont moins universelles ; elles n’ont pas pour but de s’ouvrir à tous les besoins du monde, même si la prière eucharistique IV prie aussi pour « tous ceux qui te cherchent avec droiture ».
Puisque la prière universelle rejoint à sa manière la demande du Notre Père que son Règne vienne rejoindre tous les hommes, est-il souhaitable qu’il y ait des intentions spontanées ? En pratique, la chose dépend en grande mesure du lieu dans lequel on se trouve et de la taille de l’assemblée. Si les conditions le permettent, pourquoi pas ? En ce sens, les indications de la Liturgie des Heures sont intéressantes, puisqu’à la fin de chaque série d’intentions elles signalent la possibilité d’ajouter des intentions libres. On tiendra compte de ce que recommande la Présentation générale du Missel romain : « les demandes doivent être sobres, composées avec une sage liberté et en peu de mots et qu’elles expriment la supplication de toute la communauté » (n° 71), et donc pas seulement le reflet des demandes particulières de fidèles plus habiles que d’autres à prendre la parole.
On conclura en souhaitant que la prière universelle soit et devienne de plus en plus une école de prière. En deux sens. D’abord un apprentissage de la formulation de la prière : juste, non partisane, recevable par une assemblée, sans provocation mais évangéliquement engagée… ce qui n’est pas si simple ! Mais aussi un écolage de la prière personnelle ; qu’à force d’entendre la prière liturgique – oraisons, prière universelle et prière eucharistique -, la prière personnelle des chrétiens soit plus nourrie et plus évangélique, plus riche et plus joyeuse.
(Version abrégée et actualisée d’un article dePaul De Clerck, non relue par l’auteur)
(1) En France, c’est le père J.-B. Molin qui a le plus œuvré à cette fin ; voir : « Comment redonner pleine valeur aux prières du prône ? », dans Paroisse et liturgie 42, 1960. Voir aussi P.-M. Gy, « Signification pastorale des prières du prône », dans La Maison-Dieu 30, 1952.
Télécharger l’article complet en PDF :
La prière universelle, intercession de tous les fidèles pour la venue du Royaume