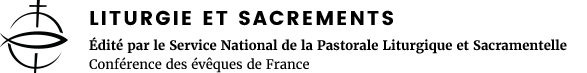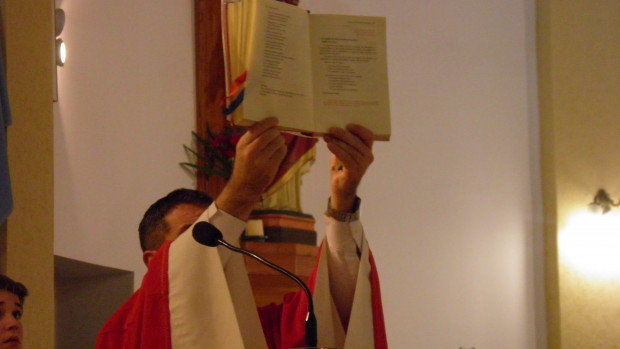Religion
Du latin religio : « attention scrupuleuse », « respect sacré ». La religion consiste originellement à recueillir (relegere) les usages et les coutumes de la communauté humaine à laquelle on appartient. Les rites représentent l’objet essentiel de ce respect des pratiques communautaires, car ils concernent le sacré.
L’usage courant du mot « religion » désigne l’ensemble des actes et des comportements qui maintiennent l’homme en relation avec le divin ; contrairement au sens premier du mot, qui s’attache aux rites, on tend actuellement à individualiser la religion ou à l’intellectualiser. En fait, l’activité rituelle est l’expression centrale et privilégiée de la vie religieuse : si, en effet, la religion inclut une croyance et une morale, ce n’est que dans la liturgie qu’elle trouve son exercice intégral, non seulement individuel et intérieur, mais communautaire et extérieur.
Les doctrines et les règles de vie sont toutes relatives aux rites sacrés (cf. Vatican II, Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, n° 2). La liturgie est la profession de foi chrétienne la plus complète, cependant que les exigences morales du christianisme doivent être comprises comme préparation et conséquence de la pratique liturgique.
Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits réservés