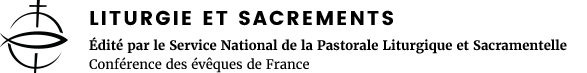Le culte eucharistique en dehors de la Messe

Détail du tabernacle, oeuvre de l’artiste contemporain Edouard ROPARS, de la Maison d’Eglise Saint-Paul-de-La Plaine. Saint Denis (93) France.
Par Robert Cabié, Professeur honoraire à l’institut catholique de Toulouse.
Un peu d’histoire
Dans les premiers siècles de l’Église, on conservait du pain eucharistique, après la célébration, pour l’apporter aux mourants. Le concile de Nicée de 325 parlait déjà d’une « règle ancienne interdisant de priver du dernier et très nécessaire viatique celui qui est près de la mort. » En ces temps où la messe n’était célébrée que le dimanche, il arrivait que des fidèles emportent chez eux le corps du Christ, pour qu’il soit chaque jour leur première nourriture. Il s’agit donc toujours de la communion. La coutume n’existait pas encore d’une « adoration du Saint-Sacrement ». C’est ce que vivent toujours aujourd’hui un bon nombre d’Églises d’Orient : on y entoure le pain consacré de gestes d’adoration, quand on le prend ou le transporte pour communier, mais on ne cherche pas à le placer de telle manière qu’il soit proposé à l’adoration des fidèles.
C’est au XIe siècle que, en certains endroits, notamment dans les abbayes clunisiennes, au lieu de garder la « sainte réserve » à la sacristie ou dans un coin de l’église, on la met en évidence sur un autel ou dans un autre lieu bien visible. On commence alors à y entretenir une lampe allumée et à parler de « tabernacle », terme qui, dans l’Ancien Testament, désignait le sanctuaire du Temple de Jérusalem. C’était faire un acte de foi en la présence du Seigneur, à l’encontre des idées déclarées hérétiques de Bérenger de Tours (+1088).
Cette dévotion se répandit d’autant plus facilement que l’on ne communiait plus que très rarement et, au siècle suivant, s’est développée dans le peuple la conviction que voir l’hostie et la regarder longuement procurait autant de grâces que de la recevoir.
Pour satisfaire cette requête de la piété populaire, on introduisit à la messe le rite de l’élévation et on voulut le prolonger, en dehors de la célébration, en plaçant l’hostie dans un reliquaire (origine des monstrances ou ostensoirs) qui pouvait être exposé et contemplé à la manière dont on vénérait les restes des saints.
La fête du Corps du Christ ou Fête-Dieu, instituée à Liège en 1252 et confirmée douze ans plus tard par le pape Urbain IV, avec les processions solennelles auxquelles elle donnait lieu, encouragea cette pratique, tout en s’efforçant de la cadrer. Plusieurs ordonnances épiscopales, en effet, mettront en garde contre des abus, qui se manifesteront plus nettement encore à l’époque de la Contre-Réforme, risquant de faire passer au second plan l’action que constitue l’offrande sacramentelle du sacrifice du Christ, au profit d’une chosification de l’eucharistie, la messe étant considérée surtout comme le moyen de se procurer cette hostie qu’on pourra adorer.
Saint Pie X rétablit l’équilibre en faveur de la communion, en en facilitant l’accès aux fidèles, même dès leur jeune âge, par le décret Quam singulari de 1910, et le Concile Vatican II remet en valeur la participation active des chrétiens à l’action eucharistique : « qu’ils se laissent instruire par la parole de Dieu, refassent leurs forces à la table du Corps du Seigneur, rendent grâce à Dieu et qu’offrant la victime sans tache … ils apprennent à s’offrir eux-mêmes. » (Constitution sur la Liturgie, n° 48)
Ce qui fait dire à l’Instruction de 1967 :
On veillera à ce que le culte du Saint-Sacrement apparaisse clairement, au moyen des signes, dans la relation qui l’unit à la messe …
– Eucharisticum mysterium, n°60
Par ailleurs, on remarque que toutes les facultés accordées aux laïcs par des documents officiels, pour le service de l’eucharistie, concernent uniquement la communion.
Une présence dynamique … une présence qui demeure
Ce que l’Esprit Saint rend présent, par la consécration, c’est le Christ accomplissant son sacrifice, donnant sa vie et nous entraînant dans son aventure pascale. C’est pourquoi toute Prière eucharistique s’adresse au Père ; Jésus est, pour ainsi dire, de notre côté, et c’est « par lui, avec lui et en lui » que nous présentons à Dieu notre action de grâce et notre offrande. Il ne s’agit pas d’une présence statique devant nous, comme celle d’une chose, si vénérable soit-elle, mais d’un mouvement qui s’accomplit dans la communion où, recevant le corps et le sang du Seigneur, nous devenons nous-mêmes « dans le Christ une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu ». Ce n’est pas pour rien que le signe sacramentel est une nourriture : « Prenez et mangez… Prenez et buvez … ».
Mais la présence du Christ ne se réduit pas au moment où le pain et le vin eucharistiques sont donnés à manger et à boire. Elle demeure après la messe ; c’est là, dès l’origine, la foi de l’Église, puisqu’elle a toujours voulu garder le corps du Christ, au moins pour l’apporter aux mourants. Si dans la célébration, c’est au Père que nous nous adressons, avec le Fils, la spiritualité évangélique a fait naître aussi le désir de dialoguer avec le Seigneur Jésus, de rechercher une intimité plus profonde avec lui, de contempler l’humanité du Sauveur dans sa proximité avec nous. C’est cette légitime aspiration qui s’est traduite depuis bien longtemps, en Orient, par la vénération de l’icône du Sauveur et qui a donné lieu, en Occident, à l’adoration du Saint-Sacrement. Aussi comme le précise le Missel Romain (Présentation générale, n° 216) est-il important que la sainte réserve soit conservée dans un lieu qui favorise le recueillement et permette cette oraison silencieuse qui, à toute heure du jour ou même de la nuit, prolonge la prière liturgique.
Une présence dans l’absence … et dans l’attente …
Ce qui demeure après la messe, c’est d’abord et avant tout la grâce sacramentelle dans le cœur des fidèles, ces fruits de l’eucharistie, implorés par l’épiclèse et abondamment présentés dans les prières après la communion (postcommunions) : forces nouvelles pour les combats de la vie et lutte contre le péché ; grâces de pardon, de paix, de justice et de liberté ; courage pour être témoins de l’évangile en annonçant la Bonne Nouvelle non seulement en paroles mais en actes ; unité des membres du corps du Christ et croissance de l’Église ; amour de tous les hommes ; partage de nos ressources de tous ordres ; vigilance dans l’attente du retour du Christ ; et même santé du corps, comme de l’âme.
Notre recueillement devant le Saint-Sacrement et notre adoration ne peuvent qu’être au service de ce travail de l’Esprit dans nos existences et ne sauraient avoir d’autre but. Certains chrétiens voudraient que le Saint-Sacrement soit toujours à leur portée dans une proximité sécurisante, ou que la communion fasse d’eux, en quelque sorte, des tabernacles vivants ; mais il y aura toujours une distance entre l’hostie qui est à notre disposition et le Christ que nous ne pouvons en aucune manière posséder ou soumettre à nos aspirations. La volonté de Dieu n’est pas de combler nos attentes, mais bien plutôt de creuser en nous un désir, de nous ouvrir à une espérance. Il s’agit d’un compagnonnage avec Jésus, qui laisse toute sa place à la foi, avec ses clartés et ses nuits, et qui permet les lentes maturations de l’Évangile dans nos vies, « jusqu’à ce qu’Il vienne ».
Une présence qu’on adore « en esprit et en vérité »
Ces réflexions historiques et théologiques nous introduisent dans le Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe1, qu’elles nous aident à comprendre et à accueillir :
La fin première de la conservation de l’eucharistie en dehors de la messe est l’administration du viatique ; les fins secondaires sont la distribution de la communion et l’adoration de notre Seigneur Jésus Christ présent dans le sacrement. Car la conservation des saintes espèces pour les malades a amené la louable coutume d’adorer la nourriture céleste conservée dans les églises.
– Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe, n°5
Cela nous rappelle que le tabernacle ne dit pas tout de la présence eucharistique. Il serait impensable de conserver des hosties dans une église fermée où personne n’entrerait jamais, afin de pouvoir dire que le Seigneur serait là, au cœur d’un village ou d’un quartier. Cela pouvait se concevoir pour les temples païens de l’Antiquité, renfermant la statue ou les symboles d’un dieu. Le sacrement est tout autre chose ; il est fait pour une rencontre avec des hommes qui s’en nourrissent et qui l’adorent. C’est pourquoi il est important que soit aménagé dans les églises un lieu accueillant, où l’on puisse facilement, une fois célébrés les saints Mystères, se recueillir dans le silence, pour entrer dans l’attitude de Marie de Béthanie qui, « assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. »
Quant aux expositions du Saint-Sacrement, qui sont une forme publique et plus solennelle de l’adoration, l’Instruction Eucharisticum mystérium, veut « qu’elle se fasse à la fin de la messe dans laquelle a été consacrée l’hostie à exposer » ; c’est toujours pour souligner son lien avec l’action eucharistique elle-même. Il n’est pas sans intérêt de noter que le Rituel, dans le passage que nous avons cité, employait le terme de « nourriture », même à propos de l’adoration. C’est ce qu’il applique, de manière plus explicite, au cas que nous envisageons maintenant :
Dans l’agencement de l’exposition, on évitera avec soin tout ce qui pourrait, de quelque façon, voiler le désir du Christ qui a institué l’eucharistie avant tout pour être une nourriture, un remède, un réconfort. (n°82)
On n’aurait sans doute pas la même attitude intérieure, si l’on se trouvait devant un morceau de pain – ce dont il s’agit en vérité –, plutôt qu’en présence d’une hostie qui, ronde, blanche, sans épaisseur, a quelque chose d’immatériel et n’offre aucun obstacle aux rêves les plus beaux, à ce qui est sans aucune mesure avec les réalités banales de la vie quotidienne. Au Congrès eucharistique de Lourdes, en 1981, on avait remplacé l’ostensoir par une belle coupe en cristal pleine de pains azymes. Je ne donne pas cela comme une recette à reproduire. La seule chose qui compte est de ne pas oublier que Jésus a choisi, comme sacrement de sa Pâque, le signe d’un repas. Adorer sa présence, c’est savourer l’amour de son cœur, qui donne un avant-goût de la table du ciel.
Article extrait de la revue Célébrer n°329, juin-juillet 2004, p 25-26 et 43-44
—
1. Éditions CLD, 1983.
Télécharger l’article complet en PDF :