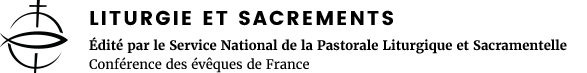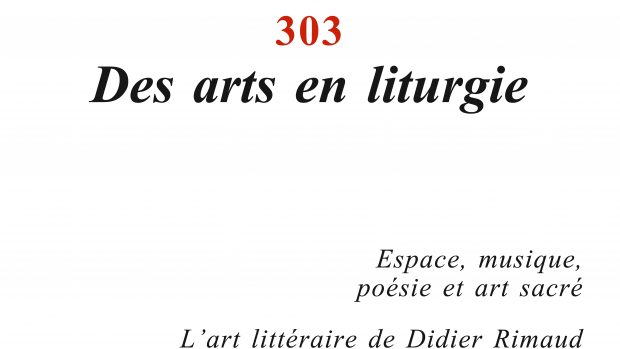Les instrumentistes et les instruments dans la liturgie
Texte national d’orientations pastorales, liturgiques et musicales
INTRODUCTION
Alléluia !
Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
Alléluia[[« Psaume » 150, in AELF, Le « Psautier » (version œcuménique, texte liturgique), Paris, Cerf, 1998, p. 272.]] !
Dans ces six versets du psaume 150, divers instruments sont rassemblés pour servir à la louange de Dieu, dans un cadre liturgique. Le cor, premier nommé, est utilisé pour sonner l’ouverture des rassemblements jubilaires ; il symbolise tous les instruments de la famille des cuivres. Puis, plus discrètes, les cordes « pincées » de la harpe et de la cithare invitent à la danse, rythmée par le tambour. Viennent ensuite les cordes « frottées » et les flûtes, et enfin les cymbales sonores et triomphantes. Avec tous ces instruments, « tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia ! » Aucun instrument n’est oublié : des plus discrets aux plus sonores, tous ont leur place dans le concert de l’univers louant le Dieu tout-puissant.
Au cours de l’histoire de l’Église, les orientations concernant l’admission des instruments dans la liturgie ont varié. Aujourd’hui, le Concile de Vatican II affirme :
« On estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.
Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale compétente, (…), il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent véritablement l’édification des fidèles[[CONCILE VATICAN II, Constitution sur la sainte liturgie (CSL), 4 décembre 1963, n° 120. Les traductions françaises des textes officiels du magistère sont extraites du site internet du Saint-Siège.]]. »
L’instruction Musicam sacram sur le chant et la musique dans la liturgie précise :
« Les instruments de musique peuvent avoir une grande utilité dans les célébrations sacrées, soit qu’ils accompagnent le chant, soit qu’ils jouent seuls. (…) Pour admettre des instruments et pour s’en servir, on tiendra compte du génie et des coutumes de chaque peuple. Les instruments qui, d’après le sens commun et l’usage courant, ne conviennent qu’à la musique profane seront exclus de toute action liturgique ainsi que des exercices sacrés de piété[[SACREE CONGREGATION DES RITES, instruction Musicam sacram (MS), 5 mars 1967, nos 62 et 63. Voir aussi la Présentation générale du missel romain (PGMR) de 2002, n° 393 : « [Les Conférence des évêques] ont également à juger quelles formes musicales, quelles mélodies, quels instruments de musique peuvent être admis pour le culte divin, pour qu’ils puissent vraiment être appropriés ou adaptés à un usage sacré. » Si l’Église invite ici à un certain discernement pour l’admission et l’utilisation des instruments dans la liturgie, il est toutefois peut-être plus difficile aujourd’hui de définir et de caractériser le génie musical d’un peuple, car l’éventail des langages musicaux est extrêmement ouvert et l’interculturalité très présente dans certaines communautés paroissiales.]]. »
Enfin, comme le rappelle la Charte des organistes liturgiques, au sujet de tout musicien d’Église,
« dans le dialogue permanent entre Dieu et les hommes, dont la liturgie est le lieu, l’homme répond de manière active et, entre autres, par l’expression musicale et le chant. En effet, la musique et le chant permettent d’atteindre un langage sacré et les paroles rituelles ne trouvent leur forme parfaite que dans l’art musical. D’autres arts, architecture, statuaire, peinture, vitraux, posent dans l’espace leur présence statique. Mais dans le plus modeste des édifices, la musique sacrée escorte et conforte l’action liturgique tout au long de son déroulement. Donc le musicien d’Église est chargé de favoriser la rencontre du peuple rassemblé avec Dieu. Il ne fait pas qu’apporter une décoration, il ne sacrifie pas le service de la liturgie à sa propre expression mais permet au chant sacré de trouver sa plénitude. C’est dire la haute responsabilité du musicien d’Église qui exerce une véritable « fonction ministérielle dans le service divin ». Il est, à sa façon, serviteur du culte divin puisque « la musique sacrée a, en effet, pour but premier, que Dieu soit glorifié, et les hommes sanctifiés[[« Rituel » de bénédiction d’un orgue, n° 1057.]] » [[Charte des organistes liturgiques, n° 1 : voir n. 1 plus haut.]]. »
C’est dans ce cadre que le département Musique du SNPLS, en collaboration avec les « correspondants provinciaux » de musique liturgique, propose ce texte national d’orientations pastorales, musicales et liturgiques, validé par la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle (CELPS). Quels instruments peuvent prendre place dans la liturgie ? Quel est le rôle de ces instrumentistes dans la liturgie ? Quelles sont les qualités requises ? Comment coordonner un ensemble instrumental ? Etc. Autant de questions auxquelles ce document voudrait répondre, en complément de la « charte des organistes liturgiques », afin de mieux préciser la place et la mission des instrumentistes autres que les organistes, dans la liturgie (1ère partie), ainsi que la façon dont, en pratique, il est recommandé d’utiliser les divers instruments dans une célébration.
I. INSTRUMENTS ET INSTRUMENTISTES EN LITURGIE
Tout d’abord, il semble bon de rappeler que la présence d’instrumentistes dans la liturgie n’est le privilège ni d’une classe d’âge ni d’un style de célébration. Pourtant, assez fréquemment, des jeunes sont sollicités. Derrière cet état de fait peut se cacher parfois la tentation de les « instrumentaliser ». Le rôle d’instrumentiste pour un jeune n’a donc pas pour objectif de l’« occuper » pendant les célébrations, mais d’assurer un vrai ministère liturgique.
1. L’instrumentiste, au service de la prière de l’assemblée
1.1 Qu’il soit là au titre de sa seule compétence musicale, ou également au titre de son baptême, l’instrumentiste, par l’accompagnement du chant et par son jeu soliste, est au service de la prière de l’assemblée. Il ne joue pas pour apporter à la célébration un simple ornement, ni pour remplir des silences, ni pour se mettre en valeur, mais pour aider l’assemblée à exercer ses prérogatives baptismales de louange et de supplication.
« L’emploi d’instruments dans l’accompagnement des chants peut être bon pour soutenir les voix ; il pourra rendre plus aisée la participation et plus profonde l’unité d’une assemblée. Mais le son des instruments ne devra jamais couvrir les voix ni rendre le texte difficile à comprendre. Tout instrument doit se taire lorsque le prêtre ou un ministre prononce à haute voix un texte relevant de sa fonction propre[[MS, n° 64.]]. »
1.2 Mais la musique de l’instrumentiste n’est pas seulement au service de la prière de l’assemblée ; elle peut être aussi la forme même de sa prière personnelle dans l’action liturgique.
Bien plus, ce qui es dit du chant dans la 4ème préface commune du Missel romain, peut-être dit aussi de la musique instrumentale, pour ceux qui l’écoutent comme pour ceux qui la jouent : « Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant c’est Toi qui nous inspire de Te rendre grâce ; nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es mais ils nous rapprochent de Toi. »
2. L’instrumentiste dans l’action liturgique
2.1 Par la dignité de son attitude et le sérieux de son action, – encore plus s’il est visible depuis l’assemblée -, l’instrumentiste aura le souci d’être en cohérence avec le mystère célébré. La musique qu’il joue fait partie intégrante de la liturgie :
« La musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels[[CSL, n° 112.]]. »
2.2 Une participation active de l’instrumentiste à toute la célébration (pas seulement dans la musique, mais aussi dans les gestes et les attitudes, les parties dialoguées, etc.) est aussi fortement souhaitable.
3. Les qualités requises
3.1 Jeunes ou adultes, les instrumentistes exerceront leur talent de la même manière : leur formation les a préparés à jouer en public avec des partitions écrites et travaillées. C’est avec ce même sérieux qu’ils interviendront dans la liturgie.
3.2 Sollicités pour une improvisation, ils n’oublieront pas que la meilleure improvisation est celle qui a été la mieux préparée. C’est donc un art qui se travaille !
3.3 Ayant conscience de leur niveau musical, ils auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes, en soignant la qualité de leur jeu : justesse, timbre, phrasé, nuances, etc.
3.4 La capacité d’écoute et l’aptitude à s’intégrer dans un groupe sont aussi des qualités indispensables.
3.5 En lien étroit avec le chant du chœur, du chantre ou de l’assemblée, ils seront attentifs à respirer, phraser, nuancer, en suivant les voix et non plus le métronome.
3.6 Surtout, il est nécessaire et même indispensable d’avoir répété préalablement avec les autres pour trouver sa juste place dans la célébration.
4. L’ensemble instrumental et son responsable
4.1 Le responsable de la liturgie pensera à solliciter les talents locaux. Là où c’est possible, on favorisera les relations avec les institutions d’enseignement instrumental.
4.2 Dès que plusieurs instrumentistes sont réunis, il est indispensable qu’une personne compétente les coordonne, les dirige si nécessaire, et veille à choisir les partitions selon le niveau des musiciens. Si les parties instrumentales n’existent pas ou ne sont pas adaptées, on s’adressera à une personne compétente pour les composer ou les arranger.
4.3 Le langage musical des chants a une incidence sur l’ensemble instrumental. On n’accompagnera pas avec les mêmes instruments des chants de styles différents : classique, byzantin, negro-spiritual, gospel, choral, modal, etc.
4.4 De même que la présence d’un chantre, d’un petit chœur, d’un chœur d’enfants, d’un grand chœur offre des possibilités d’alternances équilibrées, de même la participation d’instrumentiste(s) à une célébration implique une mise en œuvre préparée, réfléchie, soignée et équilibrée.
4.5 La personne responsable de l’ensemble instrumental assurera non seulement la coordination musicale, mais elle sera aussi particulièrement attentive à l’action liturgique : chaque intervention musicale commence et se termine au moment prévu en s’intégrant harmonieusement au rite célébré. Cela nécessite vigilance et anticipation.
4.6 La personne responsable de l’ensemble instrumental veillera aussi à la formation liturgique des instrumentistes, afin qu’ils puissent eux-mêmes comprendre ce qu’ils exécutent en lien avec l’action liturgique[[Voir aussi plus bas n. 12.]].
4.7 La personne responsable de l’ensemble instrumental sera également attentive à faciliter au sein du groupe, par son attitude, la prière et l’intériorité au cours de la liturgie.
5. Les interventions solistes des instruments.
5.1 Un instrument soliste peut être privilégié selon son propre répertoire soit pour accompagner l’action liturgique, soit pour prolonger la Parole entendue. En effet, la musique instrumentale devient chrétienne « par référence à la Parole révélée qui confesse Jésus Christ. (…) [Par conséquent], la musique sans parole trouve sens dans la liturgie en référence à la totalité de la célébration (préparation à la Parole ou son prolongement méditatif)[[UNION FEDERALE FRANÇAISE DE MUSIQUE SACREE (UFFMS), L’orgue et les instruments dans la liturgie (aide-mémoire), Paris, UFFMS, 1973.]]. »
5.2 Les compositeurs n’oublieront pas de proposer des préludes, interludes ou postludes adaptés à la durée variable des rites. On peut en trouver dans certaines revues de musique liturgique.
5.3 Toutefois, on se rappellera que les interventions musicales sont soumises aux actions liturgiques, à leur durée, à leur sens rituel (procession, acclamation, méditation, etc.), mais aussi aux imprévus : il faut alors être prêt, en cas de nécessité, à raccourcir, voire supprimer, une pièce musicale, et donc être prêt à renoncer éventuellement à « son » intervention instrumentale, pour le bien commun de la liturgie et l’équilibre de la célébration.
6. L’arrangeur-orchestrateur
6.1 Les partitions d’origine contiennent parfois des contrechants, voire des orchestrations, comme les chants de Taizé ; elles sont à utiliser en priorité.
Pour les partitions du recueil Chants notés de l’Assemblée[[Chants notés de l’Assemblée (CNA), Paris, Bayard, 2001. Le CNA est le recueil de chants promus par les évêques francophones pour les paroisses.]], les accompagnements pour orgue parus dans le cd-rom[[Chants notés de l’Assemblée. L’intégralité des accompagnements simples pour orgue, Paris, Bayard, 2008.]] constitueront la base de tout arrangement.
6.2 S’il existe une harmonisation vocale, on en tiendra compte pour l’écriture des parties instrumentales.
6.3 Si l’on a besoin d’une orchestration particulière pour un chant donné, on ne craindra pas de faire appel au service diocésain de musique liturgique pour solliciter le compositeur (ou ses ayants droits, s’il est décédé), afin qu’il la réalise lui-même[Pour les questions juridiques, voir plus particulièrement les questions 6 et 10 de l’[annexe.]].
Si cela n’est pas possible, il faut que l’arrangeur du groupe instrumental ait de solides notions d’analyse, d’écriture et d’orchestration.
7. Emplacement des instruments dans l’espace liturgique
« L´orgue et les autres instruments de musique légitimement approuvés seront installés dans un endroit approprié pour quils puissent soutenir le chant aussi bien du peuple que de la chorale et, s’ils jouent seuls, qu´ils puissent être bien entendus par tous[[Présentation générale du « missel » romain (PGMR) de 2002, n° 313.]]. »
7.1 La place des instrumentistes – comme celle des choristes – dépend, en partie, de l’aménagement de l’église et de l’espace dont on dispose. Mais on n’oubliera pas que, dans l’action liturgique, celui qui est au centre, c’est le Christ. Il est donc évident que la place de la chorale ou de l’ensemble instrumental n’est pas au centre du lieu de la célébration ni derrière ou juste à côté de l’autel, mais, selon la disposition des lieux, l’architecture et l’acoustique, plutôt dans une chapelle latérale, transept, etc. Les instrumentistes n’ont pas à être nécessairement visibles (tant qu’ils sont entendus).
7.2 Quand des instrumentistes jouent avec l’orgue, leur place est, si possible, près de l’organiste (lorsque celui-ci est en bas), ce qui facilitera la coordination et la synchronisation[[Voir aussi plus bas, le § 6 de la 2ème partie.]]. Un petit groupe d’instrumentistes pourra également s’installer près du chantre (animateur d’assemblée).
8. La question de l’acoustique
8.1 Le volume sonore de l’accompagnement instrumental prendra en compte l’acoustique du lieu de la célébration, la dimension de l’assemblée, la présence d’un soliste, d’une chorale.
8.2 Le travail de préparation sur l’acoustique s’effectuera en collaboration avec, le cas échéant, le chef de chœur et/ou de l’ensemble instrumental et les responsables du chant de l’assemblée.
8.3 Des répétitions communes seront nécessaires notamment pour la recherche d’un équilibre sonore juste, ainsi dans les alternances refrain/couplets ou soliste/chœur/assemblée.
9. De l’usage de l’amplification
9.1 On sera également très attentif à la question de l’amplification sonore. Il est toujours préférable de choisir les instruments dont le volume sonore naturel est adapté au lieu et à l’assemblée, plutôt que d’amplifier exagérément un violon, une guitare ou une cithare, etc. Si l’amplification est inévitable, il ne faut pas qu’elle dénature le son des instruments ni qu’elle couvre le chant de l’assemblée ou celui du soliste.
9.2 Dans tous les cas, on fera appel à une personne formée à la sonorisation et à la liturgie pour amplifier correctement un ensemble instrumental. Pendant la célébration, il est préférable que cette personne ne joue pas elle-même : elle pourra ainsi aller écouter de loin, et ajuster les réglages si nécessaire.
10. Orchestration et rite
10.1 Ce qui doit guider avant tout dans le choix des instruments, c’est l’adéquation de la musique au rite célébré : le chant d’entrée peut faire appel à l’ensemble des instruments alors qu’un moment de méditation sera accompagné plus discrètement. Certains instruments pourront introduire un chant, d’autres le soutenir. La question qu’il faut se poser, à partir des musiciens disponibles, est non pas « qui faire jouer ? », mais « que demande le rite et quel est son caractère ? » (louange, intercession, méditation, etc.).
10.2 Attention au volume sonore qui ne doit pas « écraser » le chant de l’assemblée : quand celle-ci ne s’entend plus, elle ne chante pas.
10.3 La qualité d’un accompagnement reflète la variété des mises en œuvre ; l’accompagnement doit être réparti entre les différents instruments dont on dispose, tout en étant attentif à ne pas être trop présent, en variant le jeu instrumental. Les instruments mélodiques (flûte, hautbois, saxophone, violon, violoncelle, etc.) pourront jouer des préludes et interludes courts en exploitant la mélodie principale. L’alternance chant/instruments favorise l’écoute mutuelle.
10.4 Il en sera de même dans le choix des pièces interprétées au cours de la célébration, leur durée devant s’adapter au mieux à la durée du rite lui-même.
10.5 Il conviendra de distinguer les instruments polyphoniques qui se suffisent à eux seuls (claviers, guitare, accordéon, harpe) des instruments monodiques qui ne jouent qu’une seule note.
10.6 On sera attentif au timbre des instruments et à l’orchestration en fonction du moment liturgique : ainsi, une trompette pourra convenir au chant d’entrée ou au Sanctus, mais pas au Kyrie. Les claviers, les percussions et le groupe au complet pourront accompagner l’assemblée pendant le processionnal d’entrée, les différentes acclamations ou le chant d’envoi, tandis que pour le psaume, l’accompagnement pourra être réalisé par des instruments harmoniques (guitare, harpe, claviers), alors que la mélodie de l’antienne sera exposée par un instrument monodique.
10.7 Enfin, une progression est nécessaire : on ne fait pas jouer tous les instruments dès le premier refrain.
11. Instruments et temps liturgiques
Les mystères du Seigneur se déploient tout au long de l’année liturgique avec leur caractère et leur spiritualité propres. L’Avent et le Carême sont des temps de préparation vécus avec sobriété pour ouvrir avec un éclat particulier sur la joie et la solennité des fêtes de Noël et de Pâques.
C’est pourquoi,
« pendant l’Avent, on se servira de l’orgue et des autres instruments de musique avec la discrétion qui convient au caractère de ce temps, et sans anticiper sur la joie complète de la Nativité du Seigneur.
Pendant le Carême, l’orgue et les autres instruments ne sont autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du quatrième dimanche […], des solennités et des fêtes[[PGMR, n° 313.]]. »
12. Les instruments et le silence
« Le silence sacré fait partie de la célébration : il doit aussi être observé en son temps. Sa nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à prier, chacun se recueille ; après une lecture ou l’homélie, on médite brièvement ce qu’on a entendu ; après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure.
Dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence dans l’église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites[[PGMR, n° 45. Voir aussi : CSL, n° 30 et MS, n° 17.]]. »
Il n’est pas nécessaire de combler tous les silences par de la musique, en particulier après l’homélie ou après la communion.
La musique peut cependant avoir un rôle pour favoriser la prière et la méditation, et pour éveiller l’assemblée à l’écoute du silence.
13. Formation musicale et liturgique
13.1 Le désir de progresser pour mieux servir doit animer tout instrumentiste liturgique. Une relecture régulière permet de prendre du recul et d’améliorer ses pratiques.
13.2 Par ailleurs, il est du ressort des responsables diocésains et coordinateurs provinciaux de musique liturgique, en partenariat, le cas échéant, avec les responsables de la pastorale des jeunes, de proposer des sessions et des stages où les instrumentistes et leurs responsables pourront recevoir une formation liturgique qui les aide à mieux comprendre que la musique n’est pas une fin en soi mais qu’elle doit être au service du rite et de l’action liturgique, et qu’ainsi leurs propositions musicales soient vraiment en adéquation avec la liturgie.
14. Musicien et communion ecclésiale
Qu’il soit instrumentiste ou chanteur, le musicien n’oubliera pas qu’il est membre d’une assemblée et au service de la prière. Sa posture n’est pas celle du concertiste. L’action musicale ne lui appartient pas exclusivement. Cela exige de sa part une compétence nécessaire en musique et en liturgie, ainsi qu’une disponibilité vigilante dans le respect des textes, des personnes, des communautés. Une juste intégration des instruments dans la liturgie contribue à manifester la beauté de l’Église dans la complémentarité de ses voix et la communion de ses membres.
II. QUELQUES REPERES PRATIQUES ET MUSICAUX POUR L’UTILISATION D’UN OU PLUSIEURS INSTRUMENTS EN LITURGIE
En premier lieu, les instrumentistes s’accorderont soigneusement[[Sur des points plus techniques concernant l’accord avec ou sans orgue, voir plus bas, nn. 4 et 6.]]. Ils auront aussi préparé à l’avance et avec soin leurs partitions, dans l’ordre de la célébration (éventuellement dans un classeur pour éviter tout désagrément provoqué par la chute des partitions ou du pupitre).
1. Un instrument monodique
La fonction d’un tel instrument n’est pas nécessairement d’accompagner le chant en jouant la mélodie que chante l’assemblée mais aussi de dialoguer avec elle, par exemple en proposant de brefs interludes ou des contrechants. Cet instrument peut aussi prolonger l’homélie par une mélodie simple, écrite ou improvisée, ou encore habiter musicalement un moment de méditation.
2. Un instrument à percussion
La famille des percussions est très fournie et le choix des timbres est vaste. Certains instruments, plus sonores et plus percussifs, nécessiteront de la part de l’instrumentiste une vigilance au cours de ses interventions. Un lieu réverbérant comme l’est souvent une église rend difficile l’usage des percussions. Dans une telle acoustique[[Attention, l’acoustique d’un lieu peut varier en fonction du nombre de personnes présentes.]], le discernement du musicien et sa connaissance de la liturgie lui permettront de trouver la juste expression de son instrument.
Quand le percussionniste accompagne, il veille à ne pas couvrir le chant tout en lui apportant son soutien ; car la voix de l’assemblée doit rester première en liturgie.
Bien pensé, un solo de percussions peut s’intégrer dans une célébration grâce à la richesse de ses timbres.
3. Un instrument polyphonique
(clavier autre que l’orgue, guitare, harpe, cithare, etc.)
Ce type d’instruments peut accompagner le chant de l’assemblée ou du soliste.
On sera attentif à l’équilibre sonore : une guitare ou une cithare à elles seules ne rempliront pas un grand édifice[[Pour les questions d’amplification, se référer au § 9 de la 1ère partie.]].
4. Ensemble instrumental sans orgue
On associera des instruments dont les timbres se marient bien entre eux, en évitant que deux instruments différents jouent à l’unisson (ex : flûte et violon, hautbois et clarinette, trompette et violon, etc.). Les instruments baroques, accordés au diapason ancien – c’est le cas de bien des orgues – ne sont pas compatibles avec les instruments accordés au diapason moderne.
On sera attentif aux équilibres entre les timbres et les tessitures des instruments. Ainsi, une flûte dans le grave sera absorbée par une trompette dans l’aigu, alors que l’inverse peut bien sonner.
Les timbres des instruments sont aussi caractérisés que les jeux d’un orgue. Une même mélodie ne peut être jouée indifféremment au violon, à la flûte ou au hautbois : bien que dans la même tessiture, leur rendu sonore ne sera pas identique[[La flûte sonne bien dans l’aigu, le hautbois est bien présent dans le grave. Le violon est plus homogène sur l’ensemble de sa tessiture.]]. Si, dans le cas de l’orgue, l’instrumentiste peut choisir ses registrations, dans le cas d’un ensemble de musiciens, une personne ayant recul et expérience équilibrera l’orchestration.
Pour répartir les instruments, voici une formule « tronc commun » possible, avec par exemple :
Partie A (1ère voix) = violon ou flûte ou hautbois ou clarinette[[Les clarinettes, les saxophones, les trompettes, le cor, instruments transpositeurs, nécessitent des partitions appropriées.
Par exemple, une clarinette en si bémol fait entendre un si bémol quand le clarinettiste lit un do sur la partition.]] ou trompette.
Partie B (2ème voix) = les mêmes dans une deuxième partie.
Partie C (3ème voix) = violon alto ou saxophone alto ou cor.
Partie D (4ème voix) = violoncelle ou saxophone ténor ou trombone ou basson
Partie E (basse continue) = partition chiffrée pour instruments polyphoniques.
5. Orgue avec un instrument monodique
(flûte, hautbois, clarinette, saxophone, basson, violon, violoncelle, trompette, cor, etc.).
Dans la mesure du possible, l’instrumentiste se place à proximité de l’organiste.
Prélude, interlude, postlude ou contre-chant conviennent à tout instrument – grave ou aigu – avec ou sans l’orgue.
Il n’est pas nécessaire aux instruments aigus de jouer systématiquement le chant de l’assemblée. Mais les instruments à tessiture grave (violoncelle, basson, etc.) pourront doubler la partie de basse.
6. Orgue avec ensemble instrumental
Ici se pose la question du rapport entre l’organiste et les instrumentistes. Il y a nécessité de l’associer au travail des autres musiciens pour ses compétences musicales et liturgiques, et de définir avec lui sa place d’instrumentiste parmi les autres.
En fonction du diapason et du tempérament[[Le tempérament est la manière d’accorder un instrument à clavier qui, selon les cas, empêche de jouer dans les tonalités de plus de trois ou quatre altérations.]] de l’orgue, l’organiste dira s’il lui est possible ou non de jouer avec un ensemble instrumental.
Pour une bonne synchronisation, il est indispensable que les instrumentistes soient en lien direct avec l’organiste, soit physiquement, soit par des moyens techniques appropriés. Quand ce n’est pas possible, ils joueront en alternance.
Par ailleurs, l’organiste et les instrumentistes veilleront à jouer des harmonies compatibles.
7. Orgue et percussion
En liturgie, cette combinaison ne donne que très rarement des résultats satisfaisants, il vaut mieux chercher d’autres formations instrumentales.
8. Orgue et instrument polyphonique
Certaines combinaisons instrumentales peuvent être heureuses comme harpe ou piano et orgue. En revanche, la réunion d’une guitare ou une cithare doublant les harmonies de l’orgue n’a pas vraiment d’utilité pour soutenir le chant de l’assemblée. Dans ce cas, il faut privilégier le jeu en alternance.
CONCLUSION
L’intervention d’instrumentistes dans la liturgie peut être d’un grand profit tant pour l’assemblée que pour les musiciens eux-mêmes.
La mission des responsables d’un ensemble instrumental intervenant dans l’action liturgique est d’aider chaque instrumentiste à comprendre le sens de son intervention, et de rechercher la meilleure intégration de la musique au rite célébré.
« Il est tout à fait souhaitable que les organistes et autres instrumentistes ne soient pas seulement experts dans le jeu de l’instrument qui leur est confié ; mais ils doivent connaître et pénétrer intimement l’esprit de la liturgie pour qu’en exerçant leur fonction de manière exacte, ils enrichissent la célébration selon la vraie nature de chacun de ses éléments et favorisent la participation des fidèles[[MS, n° 67.]]. »
C’est alors un grand bonheur d’entendre des instruments dans leur diversité et bien intégrés à l’action liturgique.
SNPLS, mai 2011.
Télécharger l’annexe juridique
Pour aller plus loin :
• Les principaux documents du magistère : Constitution sur la Sainte Liturgie (1963) ; Musicam sacram (1967); Présentation générale du Missel romain (2002).
• Le Référentiel de compétences des musiciens d’Église professionnels .
• La Charte des organistes liturgiques.
• La Charte des chanteurs liturgiques.
• La Charte des chœurs d’enfants.
• Le Vademecum du compositeur liturgique, annexe 2, sur les données juridiques (notamment la question 6 sur le droit moral et la question 10 sur l’arrangement d’une œuvre préexistante), reproduite ici en annexe.
• Voir aussi des manuels comme : J. Gelineau (dir.), Dans vos assemblées, Desclée, 1998 ; L.-M. Renier, Exultet, Bayard, 2002.