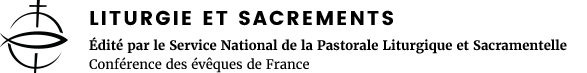Discours du Pape Benoît XVI au monde de la culture (2008)
Ce discours a été prononcé par le pape Benoît XVI au Collège des Bernardins à Paris, le vendredi 12 septembre 2008. Sa visite à Paris s’inscrivait dans le cadre d’un voyage apostolique en France à l’occasion du 150ème anniversaire des apparitions de Lourdes du 12 au 15 septembre 2008.
Monsieur le Cardinal,
Madame le Ministre de la Culture,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Chancelier de l’Institut,
Chers amis,
Merci, Monsieur le Cardinal, pour vos aimables paroles. Nous nous trouvons dans un lieu historique, lieu édifié par les fils de saint Bernard de Clairvaux et que votre grand prédécesseur, le regretté Cardinal Jean-Marie Lustiger, a voulu comme un centre de dialogue de la Sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels et artistiques de votre société. Je salue particulièrement Madame le Ministre de la Culture qui représente le gouvernement, ainsi que Monsieur Giscard d’Estaing et Monsieur Chirac. J’adresse également mes salutations aux ministres présents, aux représentants de l’UNESCO, à Monsieur le Maire de Paris et à toutes les autres autorités. Je ne veux pas oublier mes collègues de l’Institut de France qui savent ma considération et je désire remercier le Prince de Broglie de ses paroles cordiales. Nous nous reverrons demain matin. Je remercie les délégués de la communauté musulmane française d’avoir accepté de participer à cette rencontre ; je leur adresse mes vœux les meilleurs en ce temps du ramadan. Mes salutations chaleureuses vont maintenant tout naturellement vers l’ensemble du monde multiforme de la culture que vous représentez si dignement, chers invités.
J’aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. J’ai mentionné en ouverture que le lieu où nous nous trouvons était emblématique. Il est lié à la culture monastique. De jeunes moines ont ici vécu pour s’initier profondément à leur vocation et pour bien vivre leur mission. Ce lieu, évoque-t-il pour nous encore quelque chose ou n’y rencontrons-nous qu’un monde désormais révolu ? Pour pouvoir répondre, nous devons réfléchir un instant sur la nature même du monachisme occidental. De quoi s’agissait-il alors ? En considérant les fruits historiques du monachisme, nous pouvons dire qu’au cours de la grande fracture culturelle, provoquée par la migration des peuples et par la formation des nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l’antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Comment cela s’est-il passé ? Quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux ? Quels étaient leurs désirs ? Comment ont-elles vécu ?
Avant toute chose, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que leur volonté n’était pas de créer une culture nouvelle ni de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu, quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la Vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui, seul, est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l’« eschatologie ». Mais cela ne doit pas être compris au sens chronologique du terme – comme s’ils vivaient les yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort – mais au sens existentiel : derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. Quaerere Deum : comme ils étaient chrétiens, il ne s’agissait pas d’une aventure dans un désert sans chemin, d’une recherche dans l’obscurité absolue. Dieu lui-même a placé des bornes milliaires, mieux, il a aplani la voie, et leur tâche consistait à la trouver et à la suivre. Cette voie était sa Parole qui, dans les livres des Saintes Écritures, était offerte aux hommes. La recherche de Dieu requiert donc, intrinsèquement, une culture de la parole, ou, comme le disait Dom Jean Leclercq : eschatologie et grammaire sont dans le monachisme occidental indissociables l’une de l’autre (cf. L’amour des lettres et le désir de Dieu, p.14). Le désir de Dieu comprend l’amour des lettres, l’amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. Puisque dans la parole biblique Dieu est en chemin vers nous et nous vers Lui, ils devaient apprendre à pénétrer le secret de la langue, à la comprendre dans sa structure et dans ses usages. Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu, les sciences profanes, qui nous indiquent les chemins vers la langue, devenaient importantes. La bibliothèque faisait, à ce titre, partie intégrante du monastère tout comme l’école. Ces deux lieux ouvraient concrètement un chemin vers la parole. Saint Benoît appelle le monastère une dominici servitii schola, une école du service du Seigneur. L’école et la bibliothèque assuraient la formation de la raison et l’eruditio, sur la base de laquelle l’homme apprend à percevoir au milieu des paroles, la Parole.
Pour avoir une vision d’ensemble de cette culture de la parole liée à la recherche de Dieu, nous devons faire un pas supplémentaire. La Parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et qui est elle-même ce chemin, est une Parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue certes jusqu’au fond d’elle-même chaque personne en particulier (cf. Ac 2, 37). Grégoire le Grand décrit cela comme une douleur forte et inattendue qui secoue notre âme somnolente et nous réveille pour nous rendre attentifs à la réalité essentielle, à Dieu (cf. Leclercq, ibid., p. 35). Mais elle nous rend aussi attentifs les uns aux autres. La Parole ne conduit pas uniquement sur la voie d’une mystique individuelle, mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent dans la foi. C’est pourquoi il faut non seulement réfléchir sur la Parole, mais également la lire de façon juste. Tout comme à l’école rabbinique, chez les moines, la lecture accomplie par l’un d’eux est également un acte corporel. « Le plus souvent, quand legere et lectio sont employés sans spécification, ils désignent une activité qui, comme le chant et l’écriture, occupe tout le corps et tout l’esprit », dit à ce propos Dom Leclercq (ibid., p. 21).
Il y a encore un autre pas à faire. La Parole de Dieu elle-même nous introduit dans un dialogue avec Lui. Le Dieu qui parle dans la Bible nous enseigne comment nous pouvons Lui parler. En particulier, dans le Livre des Psaumes, il nous donne les mots avec lesquelles nous pouvons nous adresser à Lui. Dans ce dialogue, nous Lui présentons notre vie, avec ses hauts et ses bas, et nous la transformons en un mouvement vers Lui. Les Psaumes contiennent en plusieurs endroits des instructions sur la façon dont ils doivent être chantés et accompagnés par des instruments musicaux. Pour prier sur la base de la Parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. Deux chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques qui les placent sur les lèvres des Anges : le Gloria qui est chanté une première fois par les Anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus qui, selon Isaïe 6, est l’acclamation des Séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la Liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. À ce sujet, écoutons encore une fois Jean Leclercq : « Les moines devaient trouver des accents qui traduisent le consentement de l’homme racheté aux mystères qu’il célèbre : les quelques chapiteaux de Cluny qui nous aient été conservés montrent les symboles christologiques des divers tons du chant » (cf. ibid., p. 229).
Pour saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du Psaume : Coram angelis psallam Tibi, Domine – en présence des anges, je veux te chanter, Seigneur (cf. 138, 1). Se trouve ici exprimée la conscience de chanter, dans la prière communautaire, en présence de toute la cour céleste, et donc d’être soumis à la mesure suprême : prier et chanter pour s’unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l’harmonie du cosmos, de la musique des sphères. À partir de là, on peut comprendre la sévérité d’une méditation de saint Bernard de Clairvaux qui utilise une expression de la tradition platonicienne, transmise par saint Augustin, pour juger le mauvais chant des moines qui, à ses yeux, n’était en rien un incident secondaire. Il qualifie la cacophonie d’un chant mal exécuté comme une chute dans la regio dissimilitudinis, dans la ‘région de la dissimilitude’. Saint Augustin avait tiré cette expression de la philosophie platonicienne pour caractériser l’état de son âme avant sa conversion (cf. Confessions, VII, 10.16) : l’homme qui est créé à l’image de Dieu tombe, en conséquence de son abandon de Dieu, dans la ‘région de la dissimilitude’, dans un éloignement de Dieu où il ne Le reflète plus et où il devient ainsi non seulement dissemblable à Dieu, mais aussi à sa véritable nature d’homme. Saint Bernard se montre ici évidemment sévère en recourant à cette expression, qui indique la chute de l’homme loin de lui-même, pour qualifier les chants mal exécutés par les moines, mais il montre à quel point il prend la chose au sérieux. Il indique ici que la culture du chant est une culture de l’être et que les moines, par leurs prières et leurs chants, doivent correspondre à la grandeur de la Parole qui leur est confiée, à son impératif de réelle beauté. De cette exigence capitale de parler avec Dieu et de Le chanter avec les mots qu’Il a Lui-même donnés, est née la grande musique occidentale. Ce n’était pas là l’œuvre d’une « créativité » personnelle où l’individu, prenant comme critère essentiel la représentation de son propre moi, s’érige un monument à lui-même. Il s’agissait plutôt de reconnaître attentivement avec les « oreilles du cœur » les lois constitutives de l’harmonie musicale de la création, les formes essentielles de la musique émise par le Créateur dans le monde et en l’homme, et d’inventer une musique digne de Dieu qui soit, en même temps, authentiquement digne de l’homme et qui proclame hautement cette dignité.
Enfin, pour s’efforcer de saisir cette culture monastique occidentale de la parole, qui s’est développée à partir de la quête intérieure de Dieu, il faut au moins faire une brève allusion à la particularité du Livre ou des Livres par lesquels cette Parole est parvenue jusqu’aux moines. Vue sous un aspect purement historique ou littéraire, la Bible n’est pas simplement un livre, mais un recueil de textes littéraires dont la rédaction s’étend sur plus d’un millénaire et dont les différents livres ne sont pas facilement repérables comme constituant un corpus unifié. Au contraire, des tensions visibles existent entre eux. C’est déjà le cas dans la Bible d’Israël, que nous, chrétiens, appelons l’Ancien Testament. Ça l’est plus encore quand nous, chrétiens, lions le Nouveau Testament et ses écrits à la Bible d’Israël en l’interprétant comme chemin vers le Christ. Avec raison, dans le Nouveau Testament, la Bible n’est pas de façon habituelle appelée « l’Écriture » mais « les Écritures » qui, cependant, seront ensuite considérées dans leur ensemble comme l’unique Parole de Dieu qui nous est adressée. Ce pluriel souligne déjà clairement que la Parole de Dieu nous parvient seulement à travers la parole humaine, à travers des paroles humaines, c’est-à-dire que Dieu nous parle seulement dans l’humanité des hommes, à travers leurs paroles et leur histoire. Cela signifie, ensuite, que l’aspect divin de la Parole et des paroles n’est pas immédiatement perceptible. Pour le dire de façon moderne : l’unité des livres bibliques et le caractère divin de leurs paroles ne sont pas saisissables d’un point de vue purement historique. L’élément historique se présente dans le multiple et l’humain. Ce qui explique la formulation d’un distique médiéval qui, à première vue, apparaît déconcertant : Littera gesta docet – quid credas allegoria…(cf. Augustin de Dacie, Rotulus pugillaris, I). La lettre enseigne les faits ; l’allégorie ce qu’il faut croire, c’est-à-dire l’interprétation christologique et pneumatique.
Nous pouvons exprimer tout cela d’une manière plus simple : l’Écriture a besoin de l’interprétation, et elle a besoin de la communauté où elle s’est formée et où elle est vécue. En elle seulement, elle a son unité et, en elle, se révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous une autre forme : il existe des dimensions du sens de la Parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette Parole qui crée l’histoire. À travers la perception croissante de la pluralité de ses sens, la Parole n’est pas dévalorisée, mais elle apparaît, au contraire, dans toute sa grandeur et sa dignité. C’est pourquoi le « Catéchisme de l’Église catholique » peut affirmer avec raison que le christianisme n’est pas au sens classique seulement une religion du livre (cf. n. 108). Le christianisme perçoit dans les paroles la Parole, le Logos lui-même, qui déploie son mystère à travers cette multiplicité et la réalité d’une histoire humaine. Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque génération. Selon sa nature, elle exclut tout ce qu’on appelle aujourd’hui « fondamentalisme ». La Parole de Dieu, en effet, n’est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l’atteindre, il faut un dépassement et un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l’ensemble des textes et, à partir de là, doit devenir également un processus vital. Ce n’est que dans l’unité dynamique de leur ensemble que les nombreux livres ne forment qu’un Livre. La Parole de Dieu et Son action dans le monde se révèlent seulement dans la parole et dans l’histoire humaines.
Le caractère crucial de ce thème est éclairé par les écrits de saint Paul. Il a exprimé de manière radicale ce que signifie le dépassement de la lettre et sa compréhension holistique, dans la phrase : « La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie » (2 Co 3, 6). Et encore : « Là où est l’Esprit…, là est la liberté » (2 Co 3, 17). Toutefois, la grandeur et l’ampleur de cette perception de la Parole biblique ne peut se comprendre que si l’on écoute saint Paul jusqu’au bout, en apprenant que cet Esprit libérateur a un nom et que, de ce fait, la liberté a une mesure intérieure : « Le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté » (2 Co 3, 17). L’Esprit qui rend libre ne se laisse pas réduire à l’idée ou à la vision personnelle de celui qui interprète. L’Esprit est Christ, et le Christ est le Seigneur qui nous montre le chemin. Avec cette parole sur l’Esprit et sur la liberté, un vaste horizon s’ouvre, mais en même temps, une limite claire est mise à l’arbitraire et à la subjectivité, limite qui oblige fortement l’individu tout comme la communauté et noue un lien supérieur à celui de la lettre du texte : le lien de l’intelligence et de l’amour. Cette tension entre le lien et la liberté, qui va bien au-delà du problème littéraire de l’interprétation de l’Écriture, a déterminé aussi la pensée et l’œuvre du monachisme et a profondément modelé la culture occidentale. Cette tension se présente à nouveau à notre génération comme un défi face aux deux pôles que sont, d’un côté, l’arbitraire subjectif, et de l’autre, le fanatisme fondamentaliste. Si la culture européenne d’aujourd’hui comprenait désormais la liberté comme l’absence totale de liens, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l’arbitraire. L’absence de liens et l’arbitraire ne sont pas la liberté, mais sa destruction.
En considérant « l’école du service du Seigneur » – comme Benoît appelait le monachisme -, nous avons jusque là porté notre attention prioritairement sur son orientation vers la parole, vers l’« ora ». Et, de fait, c’est à partir de là que se détermine l’ensemble de la vie monastique. Mais notre réflexion resterait incomplète, si nous ne fixions pas aussi notre regard, au moins brièvement, sur la deuxième composante du monachisme, désignée par le terme « labora ». Dans le monde grec, le travail physique était considéré comme l’œuvre des esclaves. Le sage, l’homme vraiment libre, se consacrait uniquement aux choses de l’esprit ; il abandonnait le travail physique, considéré comme une réalité inférieure, à ces hommes qui n’étaient pas supposés atteindre cette existence supérieure, celle de l’esprit. La tradition juive était très différente : tous les grands rabbins exerçaient parallèlement un métier artisanal. Paul, comme rabbi puis comme héraut de l’Évangile aux Gentils, était un fabricant de tentes et il gagnait sa vie par le travail de ses mains. Il n’était pas une exception, mais il se situait dans la tradition commune du rabbinisme. Le monachisme chrétien a accueilli cette tradition : le travail manuel en est un élément constitutif. Dans sa Regula, saint Benoît ne parle pas au sens strict de l’école, même si l’enseignement et l’apprentissage – comme nous l’avons vu – étaient acquis dans les faits ; en revanche, il parle explicitement, dans un chapitre de sa Règle, du travail (cf. chap. 48). Augustin avait fait de même en consacrant au travail des moines un livre particulier. Les chrétiens, s’inscrivant dans la tradition pratiquée depuis longtemps par le judaïsme, devaient, en outre, se sentir interpelés par la parole de Jésus dans l’Évangile de Jean, où il défendait son action le jour du shabbat : « Mon Père (…) est toujours à l’œuvre, et moi aussi je suis à l’œuvre » (5, 17). Le monde gréco-romain ne connaissait aucun Dieu Créateur. La divinité suprême selon leur vision ne pouvait pas, pour ainsi dire, se salir les mains par la création de la matière. « L’ordonnancement » du monde était le fait du démiurge, une divinité subordonnée. Le Dieu de la Bible est bien différent : Lui, l’Un, le Dieu vivant et vrai, est également le Créateur. Dieu travaille, il continue d’œuvrer dans et sur l’histoire des hommes. Et dans le Christ, il entre comme Personne dans l’enfantement laborieux de l’histoire. « Mon Père est toujours à l’œuvre et moi aussi je suis à l’œuvre ». Dieu Lui-même est le Créateur du monde, et la création n’est pas encore achevée. Dieu travaille, ergázetai ! C’est ainsi que le travail des hommes devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu qui rend l’homme participant à l’œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Sans cette culture du travail qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le développement de l’Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. L’originalité de cet ethos devrait cependant faire comprendre que le travail et la détermination de l’histoire par l’homme sont une collaboration avec le Créateur, qui ont en Lui leur mesure. Là où cette mesure vient à manquer et là où l’homme s’élève lui-même au rang de créateur déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction.
Nous sommes partis de l’observation que, dans l’effondrement de l’ordre ancien et des antiques certitudes, l’attitude de fond des moines était le quaerere Deum – se mettre à la recherche de Dieu. C’est là, pourrions-nous dire, l’attitude vraiment philosophique : regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. Celui qui devenait moine, s’engageait sur un chemin élevé et long, il était néanmoins déjà en possession de la direction : la Parole de la Bible dans laquelle il écoutait Dieu parler. Dès lors, il devait s’efforcer de Le comprendre pour pouvoir aller à Lui. Ainsi, le cheminement des moines, tout en restant impossible à évaluer dans sa progression, s’effectuait au cœur de la Parole reçue. La quête des moines comprend déjà en soi, dans une certaine mesure, sa résolution. Pour que cette recherche soit possible, il est nécessaire qu’il existe dans un premier temps un mouvement intérieur qui suscite non seulement la volonté de chercher, mais qui rende aussi crédible le fait que dans cette Parole se trouve un chemin de vie, un chemin de vie sur lequel Dieu va à la rencontre de l’homme pour lui permettre de venir à Sa rencontre. En d’autres termes, l’annonce de la Parole est nécessaire. Elle s’adresse à l’homme et forge en lui une conviction qui peut devenir vie. Afin que s’ouvre un chemin au cœur de la parole biblique en tant que Parole de Dieu, cette même Parole doit d’abord être annoncée ouvertement. L’expression classique de la nécessité pour la foi chrétienne de se rendre communicable aux autres se résume dans une phrase de la Première Lettre de Pierre, que la théologie médiévale regardait comme le fondement biblique du travail des théologiens : « Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte (logos) de l’espérance qui est en vous » (3, 15). (Le Logos, la raison de l’espérance doit devenir apo-logie, doit devenir réponse). De fait, les chrétiens de l’Église naissante ne considéraient pas leur annonce missionnaire comme une propagande qui devait servir à augmenter l’importance de leur groupe, mais comme une nécessité intrinsèque qui dérivait de la nature de leur foi. Le Dieu en qui ils croyaient était le Dieu de tous, le Dieu Un et Vrai qui s’était fait connaître au cours de l’histoire d’Israël et, finalement, à travers son Fils, apportant ainsi la réponse qui concernait tous les hommes et, qu’au plus profond d’eux-mêmes, tous attendent. L’universalité de Dieu et l’universalité de la raison ouverte à Lui constituaient pour eux la motivation et, à la fois, le devoir de l’annonce. Pour eux, la foi ne dépendait pas des habitudes culturelles, qui sont diverses selon les peuples, mais relevait du domaine de la vérité qui concerne, de manière égale, tous les hommes.
Le schéma fondamental de l’annonce chrétienne ad extra – aux hommes qui, par leurs questionnements, sont en recherche – se dessine dans le discours de saint Paul à l’Aréopage. N’oublions pas qu’à cette époque, l’Aréopage n’était pas une sorte d’académie où les esprits les plus savants se rencontraient pour discuter sur les sujets les plus élevés, mais un tribunal qui était compétent en matière de religion et qui devait s’opposer à l’intrusion de religions étrangères. C’est précisément ce dont on accuse Paul : « On dirait un prêcheur de divinités étrangères » (Ac 17, 18). Ce à quoi Paul réplique : « J’ai trouvé chez vous un autel portant cette inscription : « Au dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, je viens vous l’annoncer » (cf. 17, 23). Paul n’annonce pas des dieux inconnus. Il annonce Celui que les hommes ignorent et pourtant connaissent : l’Inconnu-Connu. C’est Celui qu’ils cherchent, et dont, au fond, ils ont connaissance et qui est cependant l’Inconnu et l’Inconnaissable. Au plus profond, la pensée et le sentiment humains savent de quelque manière que Dieu doit exister et qu’à l’origine de toutes choses, il doit y avoir non pas l’irrationalité, mais la Raison créatrice, non pas le hasard aveugle, mais la liberté. Toutefois, bien que tous les hommes le sachent d’une certaine façon – comme Paul le souligne dans la Lettre aux Romains (1, 21) – cette connaissance demeure ambigüe : un Dieu seulement pensé et élaboré par l’esprit humain n’est pas le vrai Dieu. Si Lui ne se montre pas, quoi que nous fassions, nous ne parvenons pas pleinement jusqu’à Lui. La nouveauté de l’annonce chrétienne c’est la possibilité de dire maintenant à tous les peuples : Il s’est montré, Lui personnellement. Et à présent, le chemin qui mène à Lui est ouvert. La nouveauté de l’annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait : Dieu s’est révélé. Ce n’est pas un fait nu mais un fait qui, lui-même, est Logos – présence de la Raison éternelle dans notre chair. Verbum caro factum est (Jn 1, 14) : il en est vraiment ainsi en réalité, à présent, le Logos est là, le Logos est présent au milieu de nous. C’est un fait rationnel. Cependant, l’humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l’accueillir. Il faut l’humilité de l’homme pour répondre à l’humilité de Dieu.
Sous de nombreux aspects, la situation actuelle est différente de celle que Paul a rencontrée à Athènes, mais, tout en étant différente, elle est aussi, en de nombreux points, très analogue. Nos villes ne sont plus remplies d’autels et d’images représentant de multiples divinités. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand Inconnu. Malgré tout, comme jadis où derrière les nombreuses représentations des dieux était cachée et présente la question du Dieu inconnu, de même, aujourd’hui, l’actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui Le concerne. Quaerere Deum – chercher Dieu et se laisser trouver par Lui : cela n’est pas moins nécessaire aujourd’hui que par le passé. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable.
Merci beaucoup.
© Copyright 2008 – Libreria Editrice Vaticana
Source : www.vatican.va