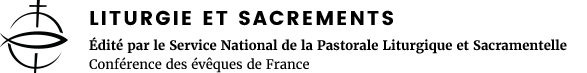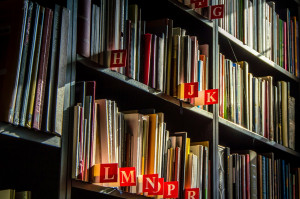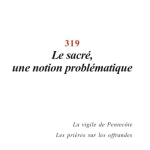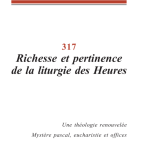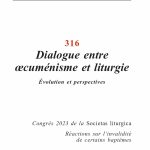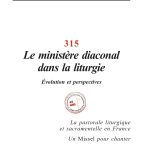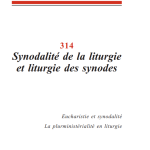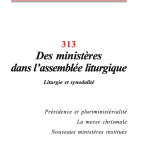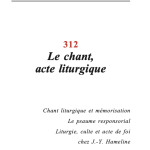La Maison-Dieu n° 322 : Corps ecclésial, corps eucharistique, corps politique
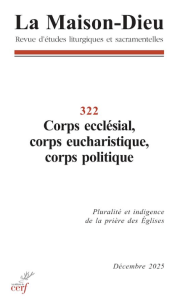 Cette livraison de La Maison-Dieu est née d’un séminaire doctoral intitulé « Liturgie et politique », puis « Corps propre, corps ecclésial, corps eucharistique, corps politique », co-animé de 2021 à 2024 par Gilles Drouin et Sylvain Brison dans le cadre de la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris. Ce séminaire s’est avéré particulièrement fécond puisque des articles du numéro 321 sur le rapport des ministères au corps ecclésial émanaient déjà de participants à ces trois années de recherche commune entre liturgistes et des dogmaticiens.
Cette livraison de La Maison-Dieu est née d’un séminaire doctoral intitulé « Liturgie et politique », puis « Corps propre, corps ecclésial, corps eucharistique, corps politique », co-animé de 2021 à 2024 par Gilles Drouin et Sylvain Brison dans le cadre de la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Paris. Ce séminaire s’est avéré particulièrement fécond puisque des articles du numéro 321 sur le rapport des ministères au corps ecclésial émanaient déjà de participants à ces trois années de recherche commune entre liturgistes et des dogmaticiens.
Liminaire (extraits)
Le dossier de ce numéro est introduit par une importante contribution de Luc Forestier, qui n’émargeait pas au séminaire précité, mais qui nous livre avec son appropriation du concept de coïncidence/dé-coïncidence une clef d’interprétation magistrale des quatre termes que ledit séminaire tentait de penser, ensemble mais sans confusion ni séparation – conformément à la posture chalcédonienne, aussi nécessaire qu’instable, – corps propre, corps ecclésial, corps eucharistique, corps politique… du Christ. Articulant avec brio une approche philosophique, exégétique, liturgique, christologique et ecclésiologique de la notion de coïncidence, l’ecclésiologue met en lumière la tentation de faire coïncider les différentes appréhensions de la métaphore paulinienne du corps du Christ, dans une approche systématique qui, en catholicisme romain, tendrait à assimiler le corps du Christ à son acception ecclésiale. L’auteur ne cite pas le grand Bossuet, tellement révélateur de ce déséquilibre quand il affirme que l’Église, c’est le Christ répandu dans le temps et dans l’espace !
La suite du dossier égrène à l’envi des exemples de coïncidences entre le corps du Christ, dans sa dimension ecclésiale puissamment médiatisée par la liturgie, et sa version politique.
Le théologien orthodoxe Christophe D’Aloisio met en lumière, dans un article lucide et courageux, la tentation d’assimilation du corps ecclésial du Christ à sa dimension politique, nationale ou pire, ethnique. Mais précisément, c’est parce que la liturgie byzantine – dans son grand œuvre d’assomption eschatologique de l’histoire et du cosmos –, prend au sérieux la capacité qu’a la liturgie eucharistique d’assumer le temps et les espaces, et donc la culture des hommes, que paradoxalement elle court ce risque de faire coïncider les dimensions ecclésiale et politique de l’unique Corps du Christ, et pas uniquement en raison de conditionnements canoniques, ou ecclésiologiques.
Dans un tout autre contexte, le théologien gabonais Jean-Davy Ndangha Mbome Ndong pointe la même tentation, celle d’une Église qui cède à ce qu’il qualifie de politique du ventre allégrement maniée par de nombreux pouvoirs politiques, moyennant l’obtention pour l’Église de quelques privilèges. Mais du même mouvement, le théologien montre comment la liturgie, si elle peut défigurer le corps du Christ en épiphanisant une coïncidence incestueuse avec le corps politique, possède des ressources de contestation, et donc de dé-coïncidence par rapport à cette même tentation.
Charles Antonyswamy développe, dans le contexte qui est le sien – l’Inde – dont la vie sociale demeure lourdement structurée et défigurée par le système des castes, la capacité propre à la liturgie eucharistique de fissurer un système bloqué par de solides réseaux de coïncidences. Il le fait à partir des quatre verbes structurants de l’action eucharistique : prendre, bénir, rompre, donner. De corps dits pollués, l’eucharistie a cette capacité de faire des corps bénis, parce qu’ils sont pris dans l’action liturgique, et donc élus. D’un corps social et parfois même ecclésial, fracturé, elle a pour visée de faire un corps rompu… pour l’unité. De corps monopolisés, elle suscite la naissance de corps partagés. Il est de bon ton d’évoquer le potentiel critique de l’Évangile et, à sa suite, de la liturgie chrétienne, dans les sphères sociale et politique. Le théologien indien met en lumière certains des ressorts profonds de cette capacité de subversion, dans un geste qui dépasse largement le contexte particulier dans lequel il l’a élaboré.
Fidèle à son approche de théologienne de la liturgie, Hélène Bricout adopte une approche diachronique pour montrer, à partir du constat de la plasticité du maniement liturgique de la figure de la royauté du Christ, comment la liturgie oscille entre coïncidence et dé-coïncidence de ses acceptions politique et évangélique. Tantôt mobilisée au service d’une monarchie sacrale, puis reconfigurée au service d’une compréhension sociale et politique de la royauté ecclésiale du Christ – et par là-même enrôlée dans la noble cause de la résistance spirituelle aux totalitarismes –, la figure du Christ-Roi finit par être dépolitisée et « eschatologisée » par la réforme liturgique de Vatican II.
.
| Dans un Varia foisonnant reprenant un mémoire de licence canonique soutenu à l’Institut supérieur de liturgie de Paris avec pour titre « les Églises en prière pluralité et indigence », Bénédicte Ducatel livre une méditation sur le caractère à la fois pluriel par son objet et sa forme ; indigent, c’est-à-dire en perpétuel décalage par rapport à son destinataire ; et limité, en raison de la condition du destinateur de la prière chrétienne. Un modèle de dé-coïncidence qui oriente vers une compréhension indissociablement incarnée et eschatologique de l’unique Église du Christ.
Enfin la rubrique « Expressions » revient sur l’assemblée célébrante, une élaboration théologique essentielle du Mouvement liturgique passablement éclipsée par la participation active, laquelle ne peut pourtant se comprendre sans elle. Le récent Congrès de la Societas Liturgica qui s’est tenu à Paris pendant l’été 2025 et dont une chronique se fait l’écho dans ce numéro de La Maison-Dieu, a montré, souvent en creux, l’importance de reprendre, en théologiens, la question de l’assemblée passablement délaissée depuis les grandes heures du Mouvement liturgique ; une mise en jachère qui explique en partie pourquoi il est si difficile de proposer des espaces liturgiques véritablement héritiers des grandes intuitions du Mouvement liturgique. |
Sommaire du n° 322 de LMD
L’Église Corps du Christ, ou la nécessité d’une « dé-coïncidence », Luc FORESTIER
La métaphore paulinienne de l’Église « Corps du Christ » est susceptible de diverses interprétations, voire de dérives lorsque l’Église se confond avec le Christ. L’idée de « dé-coïncidence », travaillée en particulier par François Jullien, permet d’en critiquer les représentations, en réaffirmant la nécessaire altérité entre les deux. Elle permet alors d’interroger la justesse des représentations de pratiques ecclésiales dont deux sont ici analysées : la vénération du suaire de Turin et l’adoration eucharistique. L’analyse exégétique de Jürgen Moltmann conduit à écarter certains modèles d’interprétation favorisant la mainmise de l’Église sur le Christ, et à élaborer une « grammaire biblique » de l’altérité entre le Christ et l’Église.
FEUILLETER L’ARTICLE « L’Église Corps du Christ, ou la nécessité d’une “dé-coïncidence” »
Vous n’êtes pas du monde, mais vous en êtes pétris. La liturgie comme fait d’ecclésiologie politique, Christophe D’ALOISIO
L’article propose une analyse ecclésiologique et politique de l’articulation entre mission, liturgie et engagement dans le monde, à partir de l’expérience de l’Église orthodoxe. Il met en lumière la réciprocité constitutive entre mission et liturgie : la première est témoignage du kérygme, la seconde en est l’expression eucharistique, toutes deux assumant le monde et ses acteurs dans la communion ecclésiale. L’étude interroge l’héritage constantinien et les logiques étatiques qui ont façonné durablement la vie liturgique, en particulier dans les contextes marqués par le nationalisme ecclésial. À travers une critique des usages politiques de la liturgie dans le christianisme orthodoxe, l’auteur ouvre la perspective d’un renouveau ecclésiologique fondé sur une conscience critique, une relecture du lien entre corps ecclésial et corps politique, et une fidélité au kérygme évangélique en vue d’une communion universelle affranchie des idéologies de domination.
La liturgie, contestation et construction du corps social et politique, Jean Davy NDANGHA MBOME NDONG
Comme d’autres continents et d’autres époques, l’Église en Afrique n’échappe pas au risque de se compromettre avec des régimes politiques divers ; la liturgie est un des lieux où une telle compromission se manifeste, comme le montrent plusieurs exemples présentés. Les textes conciliaires, mais aussi l’Écriture fournissent des repères pour interroger la justesse de ce rapport qui s’exprime sous la forme d’une « tension dynamique » entre neutralité politique et service du bien commun. La liturgie, parce qu’elle célèbre un mystère de salut, articule l’écoute de la parole évangélique, les exigences de justice et de dignité humaines, et la promotion d’un « vivre-ensemble ». Elle se trouve en posture critique et/ou collaborative avec les régimes politiques et les sociétés civiles ; elle est dès lors éminemment « politique ».
Corps béni, rompu et donné : une réimagination eucharistique de la société indienne, Charles ANTHONYSWAMY
L’article explore la structure quadripartite de l’action eucharistique – prendre, bénir, rompre, donner – comme matrice apte à déconstruire l’ordre corporel imposé par le système des castes dans la société et l’Église indiennes. En mobilisant la totalité des corps, la liturgie eucharistique ouvre un espace de reconfiguration ecclésiale fondé sur la communion, la kénose et l’inclusion. Une lecture théologico-politique des récits lucaniens de repas, mise en dialogue avec la théologie dalit, met en lumière la portée transformatrice de cette praxis liturgique. Le corps eucharistique devient ainsi un contre-modèle aux logiques de pureté, de fragmentation et d’hégémonisation : il permet le passage des corps dits « pollués » aux corps bénis, des corps fracturés aux corps rompus dans la communion, et des corps accaparés aux corps donnés dans le partage. En appelant l’Église à se constituer elle-même comme un corps « pris, béni, rompu et donné », l’article propose une ecclésiologie de la pluralité radicale et une théologie publique incarnée dans le contexte indien.
Célébrer la royauté du Christ, la liturgie à haute densité politique, Hélène BRICOUT
La liturgie possède par nature une inévitable dimension politique, mais celle-ci peut se manifester diversement. L’article étudie plus particulièrement la célébration de la royauté du Christ à l’époque carolingienne, au siècle de saint Louis et au XXe siècle avec l’institution et la réforme de la fête du Christ Roi (de l’univers) pour en relever les motivations, les caractères ainsi que le risque d’un excès de politisation.
Varia
Pluralité et indigence de la prière des Églises : un chemin d’unité, Bénédicte DUCATEL
La participation à la prière communautaire des autres confessions chrétiennes nous affronte à la différence des manières de prier, qui cependant s’appuient sur des éléments communs, en particulier l’expression du mystère pascal sous différentes formes culturelles. Mais toutes éprouvent leur finitude, leur « indigence » devant le mystère insondable de Dieu. La connaissance de la prière de l’autre peut enrichir, nourrir et convertir la nôtre. En nous faisant expérimenter, dans la diversité des formes de la prière, une recherche commune de Dieu, elle anticipe l’unité que nous recherchons.
Expression
Assemblée célébrante : un complément indispensable pour (re)penser la participation active, Laurent de VILLEROCHÉ
Question pratique
« Raccompagner le Saint-Sacrement » après la communion : une nouvelle procession dans la messe romaine…, Gilles DROUIN
Chronique
« La liturgie dans la cité : d’un corps social au corps ecclésial ». 71e semaine d’études liturgiques Saint-Serge (Paris, du 1er au 4 juillet 2025), André HAQUIN