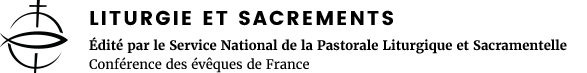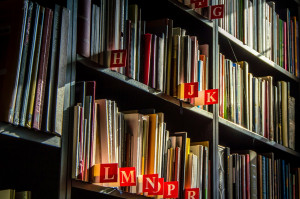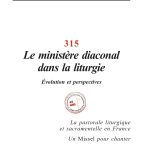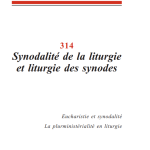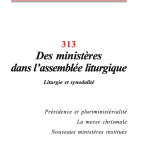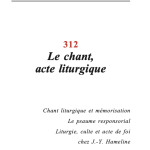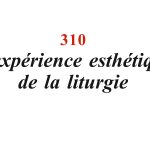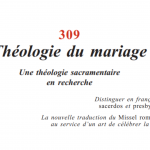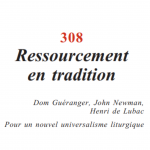La Maison-Dieu n° 316 : Dialogue entre œcuménisme et liturgie
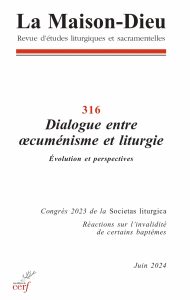 Quelles sont les avancées et les difficultés de l’œcuménisme, telles qu’on les perçoit du côté de la liturgie ? Ce numéro 316 de La Maison-Dieu publie des éléments du dernier congrès international de la Societas liturgica sur le thème « Liturgie et œcuménisme » (août 2023). Sans rechercher une théologie liturgique propre à faire l’unanimité au sein des Églises chrétiennes, ce congrès a voulu plus concrètement évaluer notre capacité à célébrer ensemble et comprendre les théologies respectives à l’œuvre en vue de pouvoir progresser.
Quelles sont les avancées et les difficultés de l’œcuménisme, telles qu’on les perçoit du côté de la liturgie ? Ce numéro 316 de La Maison-Dieu publie des éléments du dernier congrès international de la Societas liturgica sur le thème « Liturgie et œcuménisme » (août 2023). Sans rechercher une théologie liturgique propre à faire l’unanimité au sein des Églises chrétiennes, ce congrès a voulu plus concrètement évaluer notre capacité à célébrer ensemble et comprendre les théologies respectives à l’œuvre en vue de pouvoir progresser.
Ce congrès international de la Societas liturgica sur « Liturgie et œcuménisme » s’est déroulé au Collège St-Patrick de Maynooth en Irlande, du 7 au 10 aout 2023, Comme le précise Ron Anderson dans sa conférence inaugurale, ce thème est fondamental pour la Societas qui se veut un lieu d’études liturgiques dans la diversité des confessions chrétiennes, et qui est œcuménique depuis sa fondation même. Comme la revue le fait régulièrement, La Maison-Dieu a voulu consacrer son dossier à plusieurs interventions du congrès, tout comme elle le fera sans doute pour le prochain qui aura lieu fin juillet 2025 à Paris sur le thème « Théologie de l’assemblée et espace liturgique ».
La conférence inaugurale du professeur Ron Anderson ouvre ce dossier sur « Dialogue entre œcuménisme et liturgie. Évolution et perspectives ». Il pose la problématique du travail d’exploration à mener, en s’interrogeant notamment sur ce que peut signifier croire ensemble et célébrer différemment, ou inversement, célébrer ensemble et croire différemment. L’article suivant reprend la conférence du professeur Ivana Noble qui développe avec précision la recherche d’unité à laquelle nous sommes convoqués aujourd’hui, à la condition d’accueillir ce qu’apporte chaque Église comme un don gratuit désintéressé, de renoncer à une « possession » de nos propres traditions et de nous engager dans une dialectique non synthétique.
Le dossier se prolonge avec deux contributions où le dialogue entre œcuménisme et liturgie se joue concrètement. En premier lieu, le professeur Elochukwu Uzukwu l’aborde dans le contexte africain, d’abord en Amérique du Nord depuis l’arrivée des esclaves au xviiie siècle jusqu’au développement des mouvements pentecôtistes, puis en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, dans la rencontre des autochtones avec des missionnaires des différentes Églises. Ce sont ensuite les professeurs Nicolas Cochand, Isaia Gazzola, Job Getcha, qui font part de leur expérience peu banale d’un cours à trois voix – protestante, catholique et orthodoxe – au sein de l’Institut catholique de Paris, pour aborder la théologie de la liturgie et des sacrements. Le dossier se termine avec la contribution particulièrement suggestive de Frédérique Poulet qui, pour développer le dialogue théologique, prône le développement du consensus différencié, non seulement en théologie dogmatique mais aussi en théologie de la liturgie.
Après le dossier, ce numéro 316 propose un premier Varia dans lequel le théologien nord-américain Bruce Morrill s’interroge sur les effets auprès des fidèles des États-Unis et des médias, de la déclaration romaine (en 2020) d’invalidité de baptêmes célébrés antérieurement dans lesquels la parole sacramentelle avait été sensiblement modifiée. L’analyse de la controverse engendrée montre ce qui s’y joue en termes de normativité, et finalement de pouvoir. Le second Varia proposé ici présente le travail effectué à l’Institut supérieur de liturgie par Pierre Bonfils sur les écrits de Maître Eckhart, portant sur la théologie de l’eucharistie. Il montre combien la théologie médiévale, bien comprise dans son contexte, est en capacité d’éclairer nos recherches contemporaines.
Enfin les Chroniques et Recensions rapportent les grands traits de trois colloques récents, et présentent quelques ouvrages.
Sommaire
« Réunis ensemble, liés ensemble » : liturgie et œcuménisme, E. Byron (Ron) Anderson
Président en exercice de la Societas liturgica lors de son congrès en 2023 sur le thème « Liturgie et œcuménisme », l’auteur rappelle combien l’association est marquée, depuis son origine, par la question œcuménique. Comme le fut déjà avant-elle, et le demeure largement, sa publication : Studia Liturgica. Il développe son propos en problématisant le rapport entre liturgie et œcuménisme sous trois aspects :
– Dans le premier « Croire ensemble et prier différemment », l’auteur s’appuie notamment sur des sermons de John Wesley pour montrer qu’on ne peut se contenter d’une simple reconnaissance de la diversité liturgique ; il pointe l’enjeu d’une unité visible dans la prière sans laquelle la diversité, même réconciliée, risque d’accentuer encore la division.
– Le deuxième aspect « Croire différemment et prier ensemble » correspond à ce qui se pratique le plus souvent, notamment dans des réunions œcuméniques, avec l’accueil des membres d’autres Églises dans une célébration confessionnelle particulière et, mieux encore, avec des célébrations interconfessionnelles, certes non institutionalisées mais dont la portée symbolique demeure forte.
– Enfin, l’auteur développe dans le troisième aspect « Croire ensemble et prier ensemble » sa conviction que, dans un monde privilégiant la différenciation identitaire, il est nécessaire de poser des actes concrets d’unité sans devoir attendre pour cela le banquet eschatologique : « une foi commune, une prière commune et une expérience commune de la grâce de Dieu nous conduisent toujours plus vers l’unité qui nous est donnée en Jésus Christ ».
Le partage des dons liturgiques, théologiques et œcuméniques : une recherche de méthode, Ivana Noble
Dans cet article l’auteure interroge la dynamique œcuménique, dans la liturgie et ailleurs, en tant qu’échange et partage des dons propres à chaque Église soumis au principe de réalité avec les obstacles et difficultés éventuelles. S’appuyant sur les pensées du philosophe Jean-Luc Marion et du théologien Louis-Marie Chauvet, elle insiste sur « les principes de partage non-causal et non-utilitaire des dons », ainsi que sur l’enjeu d’une « non-possession » de ceux-ci, empruntés à Mère Maria Skobtsova. Si l’œcuménisme consiste en un partage de dons réciproques, accueillis avec bienveillance mais qui peuvent aussi être des fardeaux, cela requiert un certain ascétisme, voire même un souci de purification pour que ce partage reste sain. Il en va de nos relations entre Églises comme de notre relation à Dieu. L’auteure propose, pour cela, d’apprendre et de développer davantage le discernement, s’appuyant sur les expériences antérieures, pour laisser émerger une dialectique non synthétique. Cette dernière apparaît comme une méthode nécessaire en théologie œcuménique pour éviter les méta-constructions « qui empêchent les gens de voir ce qu’il y a à voir ».
Liturgie et œcuménisme, contextes et défis : un aperçu du contexte africain, Elochukwu Uzukwu
Cet essai tente de jeter un regard positif, sur les défis de la liturgie et de l’œcuménisme en contexte africain. L’accent est mis sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Le récit étant délibérément orienté vers l’action africaine, l’histoire de la performance liturgique œcuménique commence avec des esclaves catholiques kongo-angolais sollicitant la sainte communion auprès de théologiens anglicans, en Caroline du Sud, au début du xviiie siècle. En Afrique de l’Est et de l’Ouest, le développement colonial chrétien, source de divisions, fut à la fois propagé et contenu grâce à l’initiative de dirigeants africains guidés par l’Esprit Saint. Le témoignage des martyrs ougandais et la fusion liturgique des confessions chrétiennes dans le modèle de célébration charismatique ou pentecôtiste sont des exemples de l’action de l’Esprit Saint conduisant la communauté vers l’unité.
Formés œcuméniquement par la liturgie, Nicolas Cochand, Isaïa Gazzola, Job Getcha
Trois enseignants (protestant, catholique et orthodoxe) chargés de cours dans le cadre de l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO) à Paris, témoignent de leur expérience d’enseignement œcuménique de la liturgie. Commençant par un historique de cette expérience de près de vingt ans, ils donnent ensuite des éléments de méthodologie, pour souligner enfin les apports qu’on peut en retirer. Ils concluent qu’une approche œcuménique de la liturgie permet de porter un regard critique sur sa propre tradition, de mieux la comprendre en la situant dans une perspective plus large, mais en percevant aussi les spécificités et richesses des autres traditions.
La conversion à l’œcuménisme ou l’œcuménisme de la conversion ?, Frédérique Poulet
S’appuyant sur la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification de la Fédération luthérienne mondiale et de l’Église catholique, l’auteure emprunte la méthode du consensus différencié propre à la théologie dogmatique pour appréhender la question œcuménique en théologie de la liturgie. Elle souligne combien, historiquement, la prière fut première dans la démarche œcuménique, et rappelle avec Congar que l’œcuménisme spirituel prime sur l’œcuménisme théologique sans pour autant abandonner ce dernier. L’œcuménisme nécessite la conversion des Églises pour s’engager dans des célébrations communes possibles, pour développer le dialogue théologique sur ce qui nous est commun et ce qui nous différencie, et pour cheminer vers l’unité eschatologique, tout en renonçant à l’idéologie unitaire qui voudrait que toute célébration commune soit précédée d’une unité doctrinale et ecclésiale.
Varia
Discipliner le rite romain du baptême : une analyse de l’idéologie et des réactions aux déclarations d’invalidité, Bruce Morrill
Au cours des quatre dernières années, l’Église catholique des États-Unis a été confrontée à des conséquences dramatiques résultant de la mise en œuvre incorrecte du rite officiel du baptême – dont certaines cérémonies remontent à plus d’un quart de siècle. Les récentes directives du Vatican en la matière, ainsi que leur interprétation et leur mise en œuvre par les évêques et le clergé locaux, ont généré une nouvelle série de confusions et de contestations qui, d’un part témoignent de la polarisation des fidèles catholiques, et en même temps contribuent à l’aggraver.
Cette récente controverse peut servir d’étude de cas dans le cadre d’un conflit de pouvoir qui dure depuis des décennies au sein de l’Église autour de la fonction ministérielle (épiscopale, presbytérale, diaconale), de la parole et du sacrement, de l’identité et de la dignité de la personne baptisée, de l’identité et de la fonction du prêtre. L’auteur présente les scénarios problématiques tels qu’ils sont rapportés par les agences de presse séculières et ecclésiales afin de les analyser selon des critères théologiques, canoniques, socio-scientifiques et pastoraux.
L’importance de la communion eucharistique selon Maître Eckhart, Pierre Bonfils, Isaïa Gazzola
Bien que la théologie sacramentaire ne soit pas un axe central dans l’œuvre de Maître Eckhart, on peut trouver dans les écrits du théologien de Thuringe plusieurs éléments qui précisent sa théologie de l’eucharistie, à la suite de Thomas d’Aquin et de sa Somme Théologique, aptes à nourrir notre réflexion du temps présent. Cet article inventorie ces éléments et les situe dans la pensée de l’auteur et le contexte théologique de l’époque. Il montre comment, Eckhart nous conduit à travers un prisme ontologique et surtout noétique, à une analyse théologique et métaphysique de l’eucharistie où dominent les concepts d’union à Dieu et de divinisation, et la promotion d’une pastorale sacramentelle centrée sur l’importance de la réception de l’eucharistie, tout en soulignant l’impérieuse nécessité d’une préparation afin de recevoir cet « incroyable » présent du Christ.