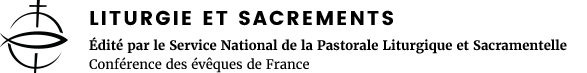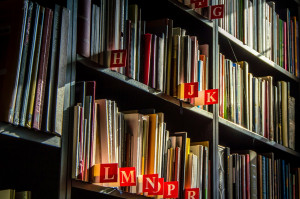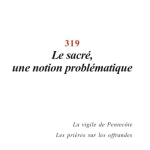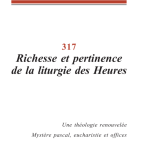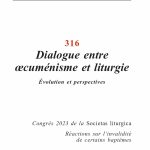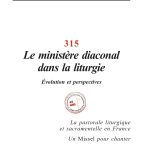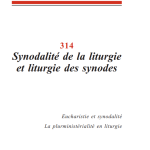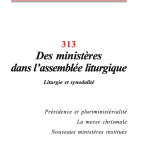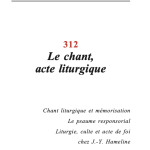La Maison-Dieu n° 321 : Ministères et corps ecclésial, le rôle de l’imaginaire
 La place, l’importance, les conditions, les fondements des ministères liturgiques constituent un ensemble de questions d’une permanente actualité. Thématique incontournable de la discipline ecclésiologique, en dialogue avec la liturgie qui dispose leur exercice dans le culte. Le dossier de ce numéro 321 de la revue La Maison-Dieu fait le point. Une partie des articles provient d’un séminaire de recherche doctoral qui s’est tenu à Paris au Theologicum de l’ICP de 2021 à 2024.
La place, l’importance, les conditions, les fondements des ministères liturgiques constituent un ensemble de questions d’une permanente actualité. Thématique incontournable de la discipline ecclésiologique, en dialogue avec la liturgie qui dispose leur exercice dans le culte. Le dossier de ce numéro 321 de la revue La Maison-Dieu fait le point. Une partie des articles provient d’un séminaire de recherche doctoral qui s’est tenu à Paris au Theologicum de l’ICP de 2021 à 2024.
Liminaire (extraits)
Les ministères suivent et interrogent, et parfois suscitent l’évolution de l’Église. Quelques exemples suffisent à s’en souvenir : la réintroduction du diaconat permanent après le Concile a obligé à imaginer la forme d’action des diacres aussi bien dans l’Église et la société que dans les célébrations ; les femmes ont été admises à la lecture de la Parole, d’abord en-dehors du chœur, ensuite à l’ambon – ce qui traduit une évolution des représentations de l’espace liturgique mais aussi des fonctions que les femmes peuvent y accomplir ; les avatars du service de l’autel traduisent les hésitations des communautés entre prise au sérieux du sacerdoce commun et revendication de fonctions genrées…
La crise provoquée par la prise de conscience des abus a suscité une interrogation à différents niveaux sur les figures des ministères dans l’Église et dans la liturgie, leur formation, leurs modes de fonctionnement, les relations qu’elles induisent dans le corps ecclésial. Antérieurement, et encore récemment, la revue a consacré plusieurs numéros à la réflexion sur les ministères, communs ou particuliers : sur le diaconat (Le ministère du diacre dans la liturgie, n. 249, 2007 ; Le ministère diaconal dans la liturgie, n. 315, 2024) ; sur le presbytérat (L’expérience du prêtre célébrant, n. 230, 2002 ; Eucharistie dominicale, eucharistie quotidienne, n. 242, 2005) ; sur les ministères laïcs et/ou plus largement les ministères liturgiques (Laïcs en pastorale liturgique, n. 194, 1993 ; Des ministères dans l’assemblée liturgique, n. 313, 2023). Bien des articles répartis dans les diverses livraisons de la revue traitent aussi de ces questions ; citons seulement à titre d’exemple, à propos de l’offrande de l’eucharistie, « Offrir avec le peuple, offrir pour le peuple ? Une question liturgique post-tridentine », de Gilles Drouin, LMD 291 ; « Le sacrifice de toute l’Église. Avatars et interprétations de l’Orate fratres en vue d’un discernement théologique et pastoral », de Christophe Lazowski, LMD 311 ; « L’apport des prières sur les offrandes pour la participation des fidèles », par Emmanuel Rochigneux, LMD 319, 2025.
Le présent numéro entend contribuer à la réflexion – qui n’es pas propre à la France – en mobilisant les concepts d’imaginaire et de représentation pour rendre compte des relations à l’œuvre dans le corps célébrant. En effet, dans de nombreuses situations dont certaines seront analysées dans ce dossier, les ressources classiques de la théologie de la liturgie s’avèrent inaptes à rendre compte de cas cliniques dans lesquels la pratique semble évoluer de manière hétérogène au regard de ce que vise le programme rituel des livres liturgiques. Il faut creuser plus profond, dans la strate des mentalités culturelles plus encore que théologiques, pour l’expliquer. Les catégories d’imaginaire ou de représentations permettent d’identifier aussi bien des strates théologiques antérieures à la réforme qui continuent à informer la pratique, que les modèles politiques, sociaux ou médiatiques qui transforment (ou déforment) l’ethos célébratoire de la liturgie réformée. En effet, comme pour d’autres réalités culturelles comme l’identité nationale (« nos ancêtres les Gaulois »), le théâtre ou la gastronomie, il n’est pas rare que des modèles de représentation antérieurs ou extérieurs imprègnent les représentations actuelles, et transparaissent dans les postures, les gestes, les vêtements, les modes de communication verbale et non-verbale d’un acteur liturgique. [… Ainsi], en Desiderio desideravi 54, le pape François a ainsi présenté quelques versions typées du prêtre présidant l’assemblée qui traduisent de telles influences, mais il ne serait pas difficile d’en trouver d’autres.
Le premier temps propose trois lieux d’observation des représentations d’offices ministériels : le prédicateur, par Emmanuel Dumont, le président liturgique, par Quentin Collin, le chantre et/ou l’animateur de chant par François-Xavier Ledoux ; et un vecteur corporel de représentation, les mains du prêtre, par Julien Sauvé. Ces lieux permettent d’identifier et de questionner des représentations variables et parfois multiples, se succédant ou se superposant. Ils mettent en lumière la ténacité de représentations anciennes et parfois fantasmées. On peut parler d’un « imaginaire » personnel et/ou collectif dans la mesure où ces représentations, plus ou moins détachées de leur site d’origine (par ex. : le prêtre d’ancien régime ou du XIXe siècle, l’animateur télé), s’appliquent à un personnage ou une situation nouvelle ou autre (les ministres dans la liturgie de Vatican II). Les marqueurs (vêtement, ton de voix, regard, choix des textes euchologiques et bien d’autres signes) en sont des indices significatifs.
Le second temps approfondit, un peu plus à distance, les appuis fondamentaux de ces représentations. Parce que le prêtre est ou a été souvent présenté comme celui qui représente le Christ (cf. Dennis Ferrara, « In persona Christi. Valeur et limites d’une formule », LMD 215, 1998 ; et, dans le même numéro, l’explication de cette formule par Louis-Marie Chauvet), Roselyne Dupont-Roc expose en une « note » concise le sens du terme utilisé pour désigner l’« autorité » du Christ, exousia. Poursuivant l’examen du Nouveau Testament, Nicolas Cochand présente la diversité des figures du service dans les premières communautés chrétiennes, par-delà les compréhensions ultérieures, fussent-elles théologiques, qui les habillent de nouvelles représentations.
L’article de Sébastien Beffa sur « les excès de l’ontologisation du sacerdoce » analyse le processus d’une telle transformation dans le temps long de l’histoire de la théologie et des mentalités : comme pour d’autres aspects de la théologie et de la vie de l’Église, le Moyen Âge constitue un véritable changement d’époque et de représentations, dont lui et la période post-tridentine ont, en certains cas, creusé davantage les ornières. Il importe alors d’être conscient des changements théologiques et de vérifier leur justesse à l’aune des outils de travail et de pensée actuels. Paul Degoul pose la question en termes de tension entre deux manières d’envisager le juste positionnement rituel envers Dieu et envers autrui, à partir de la manière dont Blaise Pascal en rend compte par le terme de « figuration ». Soulignant l’altérité de la « présence » du Christ, « signifiée » des espèces du pain et du vin consacré, il débusque les formes d’idolâtrie auxquelles peut donner lieu une représentation inadéquate du ministère du prêtre.
Concrètement, Éric Mbock présente un cas intéressant de convergence entre des systèmes de représentation imaginaires étrangers l’un à l’autre : figure du prêtre traditionnel africain et figure du prêtre du xixe siècle apporté par les missionnaires se retrouvent dans l’image de « l’homme du sacré », mis à part du peuple par son statut, ses fonctions, ses privilèges, révélant une forme d’ontologisation de sa personne qui conditionne les relations entre prêtre et laïcs – ou entre président et assemblée.
Une partie des articles de ce numéro provient d’un séminaire de recherche doctoral qui s’est tenu de 2021 à 2024 sous la direction de Gilles Drouin et de Sylvain Brison, intitulé « Liturgie et politique », puis « Corps propre, corps ecclésial, corps eucharistique, corps politique ». Ce premier ensemble appelle un second volet qui fera l’objet du numéro 322 de La Maison-Dieu sur le rapport entre liturgie et politique. Mais il fallait d’abord mettre à jour quelques éléments d’analyse sur le rapport des ministères au corps ecclésial.
|
L’article proposé en varia dans ce numéro poursuit une série d’articles consacrés à la musique et au chant liturgique. Philippe Robert y a déjà contribué en 2020 avec « le chant d’offertoire » (n. 302), puis avec « L’évolution des chants processionnaux en français » (n. 307, 2022). Cette fois-ci, il s’agit de « L’ordinaire de la messe », dont le même auteur caractérise le rapport de chaque pièce avec le rite dans lequel elle s’inscrit. Il apparaît que l’unité de sens composé par le chant et le rite forme un système cohérent qui prévaut sur une unité musicale qui n’a pas lieu d’être. Voilà qui peut éclairer le choix des animateurs, chantres et autres musiciens pour une juste mise en œuvre des rites. Nous devons à Patrick Prétot l’« Expression » de ce numéro, en réalité sur trois expressions, qui font écho au présent dossier : que dit-on lorsque l’on emploie les expressions alter Christus, ipse Christus, in persona Christi capitis, et quels sont les risques de leur emploi ? Gilles Drouin nous fournit une nouvelle « Question pratique », portant sur la liturgie du mariage. Il examine ici le sens de la demande, aujourd’hui très en vogue, de chanter le Veni creator avant l’échange des consentements. Le même auteur relit, en chronique, les célébrations de réouverture de Notre-Dame sous l’angle de la performativité d’une « noble simplicité » mise au service de l’intelligibilité du rite. Enfin, André Haquin rend compte d’un colloque tenu à l’Institut catholique de Paris, à l’occasion des 1700 ans du concile de Nicée. |
Sommaire du N°321 de LMD
Ministères et corps ecclésial : Des lieux d’observation
L’homélie : donner corps à la Parole pour l’assemblée, Emmanuel DUMONT
L’homélie est un moment central du temps de la Parole, où des idées sont transmises, mais où la Parole, incarnée, engage aussi les corps. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la prédication : tantôt instruments de l’orateur, tantôt témoins de sa vie intérieure, ils participent pleinement à la liturgie. Le corps influence l’interprétation de l’Écriture et favorise la rencontre avec l’assemblée. Divers imaginaires se sont construits autour de ces fonctions. Les performance studies offrent des outils précieux pour mettre en lumière les dimensions incarnées et dialogales de l’acte de prêcher
La présidence liturgique, service d’une assemblée sacerdotale, Quentin COLLIN
À partir des intuitions du Mouvement liturgique, relues à la lumière du concile Vatican II et de la Lettre apostolique Desiderio desideravi, cet article souligne que la présidence est un ministère ordonné à la participation active de l’assemblée, sujet célébrant de la liturgie. Loin de toute conception autoréférentielle ou réduite à un rôle de coordination, la présidence est envisagée comme un service ecclésial au cœur d’une liturgie fondamentalement communautaire. En s’appuyant sur les fondements théologiques du ministère présidentiel, l’auteur en expose les conditions et les enjeux pour une pratique ajustée à la nature du rite et à la vocation du Peuple sacerdotal. La présidence apparaît ainsi comme l’un des lieux privilégiés où se manifeste concrètement l’ecclésiologie de communion portée par le concile Vatican II.
Le chantre et/ou l’animateur de chant ? François-Xavier LEDOUX
La figure du chantre dans la liturgie a une longue histoire qui en montre les variations. Complétant ou remplaçant la schola cantorum, elle a connu une nouvelle étape de son évolution à l’époque conciliaire, alors que la participation active – en particulier par le chant – était redécouverte comme un principe majeur de la théologie de la liturgie. Entre modèles donnés par la société et impératifs nouveaux, le rôle du chantre s’est cherché jusqu’à se stabiliser dans une forme dont on peut aujourd’hui encore interroger la pertinence.
Les mains du prêtre… et leur « pouvoir » ? Un imaginaire encadré par la liturgie, Julien SAUVE
À partir d’une expression de Bérulle selon laquelle le prêtre a « pouvoir sur Dieu », l’article rappelle comment se sont élaborées et modifiées les représentations du sacerdoce ministériel au cours de l’histoire. Bien que la réforme liturgique ait requalifié les rites d’ordination et le ministère du prêtre, et malgré les indications vigilantes du Missel et de la Présentation générale du Missel romain, ces représentations persistent aujourd’hui dans l’imaginaire collectif, en particulier celles qui portent sur les mains du prêtre.
Ministères et corps ecclésial : Des aspects fondamentaux
Note sur le terme exousia dans le Nouveau Testament, Roselyne DUPONT-ROC
Le mot exousia dans la bible (traduit le plus souvent par « autorité » ou « pouvoir ») est d’abord un terme profane dont le sens, bien défini, permet de comprendre son usage dans les écrits néo-testamentaires et de l’utiliser avec justesse quand on l’applique à des réalités ecclésiales.
Quels imaginaires ministériels (projetons-nous) dans le Nouveau Testament ?, Nicolas COCHAND
Les textes du Nouveau Testament ne proposent pas de vision unifiée des fonctions dans l’Église, mais plutôt d’une pluralité en fonction des besoins des communautés ecclésiales naissantes. Les différentes hypothèses élaborées pour rendre compte de l’existence de « ministères » invitent à se garder de rétroprojections, sur l’époque néotestamentaire, de modèles ultérieurs.
Les excès de l’ontologisation du sacerdoce, Sébastien BEFFA
Sociologiquement, l’ontologisation du sacerdoce est analysée comme une cause de nombreux maux actuels de l’Église. Cette ontologisation repose sur la théologie : l’ordination sacerdotale confère une grâce spéciale et un caractère indélébile au prêtre qui lui permet d’agir in persona Christi capitis, notamment dans la présidence de l’eucharistie et la prononciation des paroles du mémorial. Pour mieux comprendre les représentations de cette ontologisation comme « mise à part » du prêtre, l’article travaille sur la généalogie de sa théologie et de ses imaginaires : l’inversion médiévale de la notion de corpus verum et de corpus mysticum qui a conduit à décaler le pouvoir du prêtre sur la transformation des espèces eucharistiques ; la réception du concile de Trente en France par l’« École française de spiritualité » où penser la présence du Christ dans l’eucharistie et la messe comme sacrifice a conduit à concevoir une présence permanente du Christ chez le prêtre même ; les représentations liturgiques et architecturales qui extériorisent cette conception. En rendant compte du changement de perspective dans la conception du ministère presbytéral à la suite du « tournant ecclésiologique » de Vatican II, l’article propose des pistes de réflexion sur le caractère performatif des représentations à travers trois lieux : l’histoire de la liturgie, la théologie politique et l’expérience liturgique.
FEUILLETER L’ARTICLE « LES EXCÈS DE L’ONTOLOGISATION DU SACERDOCE »
Idolâtrie et figuration. Deux catégories pour repenser la relation à Dieu selon Blaise Pascal, Paul DEGOUL
Prenant acte du fait que tout rite, ancien ou contemporain, court le risque de dériver vers l’idolâtrie ou l’idéologie politique, l’auteur cherche à identifier les conditions d’un juste équilibre entre les dimensions horizontale et verticale de la mise en œuvre des rites de la messe. L’opuscule de François Cassingena-Trevedy, Te igitur, permet de poser un diagnostic, et Blaise Pascal fournit la clé herméneutique de la figuration pour comprendre comment articuler adéquatement le rite et la réalité qu’il figure.
L’imaginaire de la relation entre le prêtre et l’assemblée dans la liturgie vécue au Nord-Cameroun, Éric MBOCK
Les figures du prêtre, au Cameroun comme en d’autres pays d’Afrique, combinent celles qui proviennent des représentations de l’époque des missions, et sont essentiellement tridentines, et celles qui proviennent du fonds traditionnel local antérieur à l’évangélisation. On observe cependant que ces origines différentes se retrouvent dans la représentation du prêtre comme « homme du sacré » investi d’un pouvoir spécial qui le distingue des autres fidèles. Il est d’autant plus important de veiller à ce que la mise en œuvre des rites liturgiques n’entretienne pas ces images et permette au contraire une meilleure réception de la théologie conciliaire.
Varia
L’ordinaire de la messe, Philippe ROBERT
L’ordinaire de la messe, composé de Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, est souvent considéré comme un ensemble musical cohérent. L’histoire montre qu’il n’en est rien, mais que chaque pièce est au service du rite précis dont il fait partie. Le rappel de l’histoire de ces compositions, particulièrement après Vatican II, est l’occasion de mieux faire apparaître leur fonction rituelle.
Expression
Alter Christus. À propos du ministère presbytéral dans la liturgie, Patrick PRETOT
Question pratique
Le Veni Creator avant l’échange des consentements : les enjeux d’une pratique en développement, Gilles DROUIN
Chroniques
Les liturgies de réouverture de Notre-Dame : la force de la noble simplicité, Gilles DROUIN
Colloque de l’Institut supérieur d’études œcuméniques (ISEO) : « Nicée (325-2025) : Dire la foi aujourd’hui » (ICP, Paris, 20-21 mars 2025), André HAQUIN