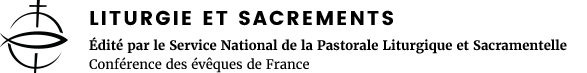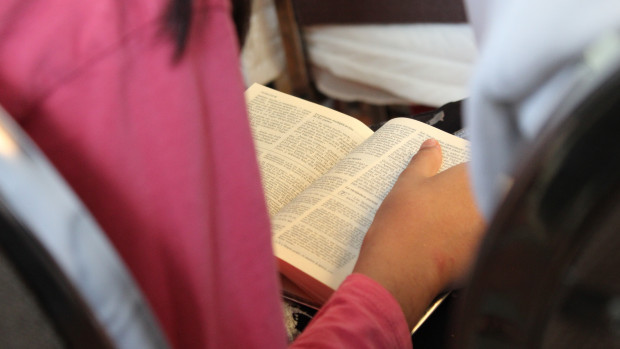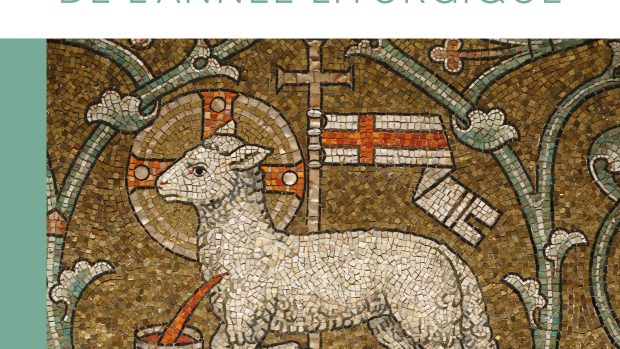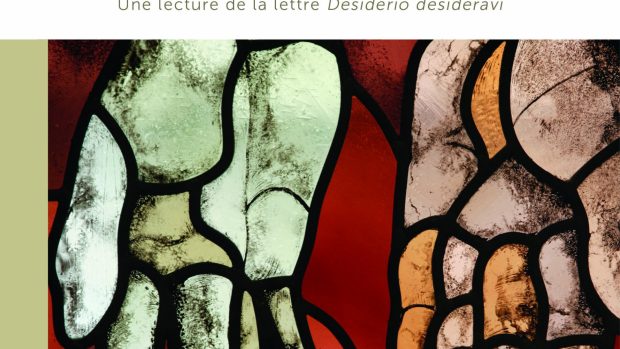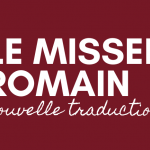À la dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l´Église lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu´il a transmis à ses disciples pour qu´ils le fassent en mémoire de lui.
En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples, en disant : « Prenez, mangez, buvez ; ceci est mon Corps ; ceci est la coupe de mon Sang. Vous ferez cela en mémoire de moi ».
– PGMR, 72
La liturgie eucharistique est chronologiquement le troisième temps fort de la messe, elle fait suite à la liturgie de la Parole.
-
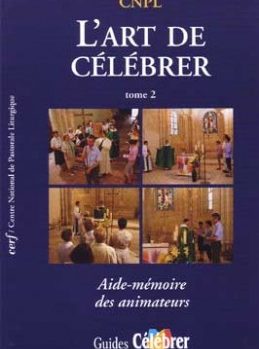
La liturgie Eucharistique : son déroulement selon la PGMR
Dans les diocèses, la pastorale des funérailles s’est développée. Cette pastorale a généré de nombreuses études et documents que nous pouvons rappeler :
La liturgie eucharistique dans la Présentation Générale du Missel Romain

Réf. PGMR 72-79
72 À la dernière Cène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l´Église lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu´il a transmis à ses disciples pour qu´ils le fassent en mémoire de lui.
En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples, en disant : « Prenez, mangez, buvez ; ceci est mon Corps ; ceci est la coupe de mon Sang. Vous ferez cela en mémoire de moi ». Aussi l´Église a-t-elle organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui correspondent à ces paroles et à ces actes du Christ. De fait :
a) Dans la préparation des dons, on apporte à l’autel le pain et le vin avec l´eau, c´est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses mains.
b) Dans la Prière eucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute l’œuvre du salut, et les dons offerts deviennent le Corps et le Sang du Christ.
c) Par la fraction du pain et par la communion, les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d’un seul pain le Corps du Seigneur et d’une seule coupe le Sang du Seigneur, de la même manière que les Apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même.
La préparation des dons
73 Au commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l´autel les dons qui deviendront le Corps et le Sang du Christ.
D’abord on prépare l´autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique[1], en y plaçant le corporal, le purificatoire, le Missel et le calice, à moins que celui-ci ne soit préparé à la crédence.
Puis on apporte les offrandes : faire présenter le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander ; le prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit favorable, pour les déposer sur l´autel. Même si les fidèles n´apportent plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l´apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle.
De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou de l´Église, peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis dans l´église ; on les dépose à un endroit approprié, hors de la table eucharistique.
74 La procession qui apporte les dons est accompagnée par le chant d’offertoire qui se prolonge au moins jusqu´à ce que les dons aient été déposés sur l´autel. Les normes qui concernent la manière d´exécuter ce chant sont les mêmes que pour le chant d´entrée. Le chant peut toujours accompagner les rites de l’offertoire, même lorsqu’il n’y a pas de procession des dons.
75 Le pain et le vin sont déposés par le prêtre sur l’autel, geste qu’il accompagne des formules établies ; le prêtre peut encenser les dons placés sur l´autel, puis la croix et l´autel lui-même, pour signifier que l’oblation de l´Église et sa prière montent comme l´encens devant la face de Dieu. Puis, le diacre ou un autre ministre encense le prêtre, à cause de son ministère sacré, et le peuple, en raison de sa dignité baptismale.
76 Ensuite le prêtre se lave les mains sur le côté de l’autel, rite qui exprime le désir de purification intérieure.
La prière sur les offrandes
77 Lorsqu’on a déposé les offrandes et terminé les rites d´accompagnement, on conclut la préparation des dons et on se prépare à la Prière eucharistique par l´invitation à prier avec le prêtre et par la prière sur les offrandes.
À la messe, on dit une seule prière sur les offrandes, qui se termine par la conclusion brève : Per Christum Dominum nostrum ; Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ; si cependant elle fait mention du Fils à la fin, ce sera : Qui vivit et regnat in saecula saeculorum ; Lui qui règnes pour les siècles des siècles.
Le peuple s’unit à la prière et la fait sienne par l’acclamation Amen.
La prière eucharistique
78 C´est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration : la Prière eucharistique, prière d´action de grâce et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l´action de grâce, et il se l´associe dans la prière qu´il adresse à Dieu le Père par Jésus Christ dans l’Esprit Saint, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que toute l´assemblée des fidèles s´unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l´offrande du sacrifice. La Prière eucharistique exige que tous l’écoutent avec respect et en silence.
79 On peut distinguer comme suit les principaux éléments qui forment la prière eucharistique :
L'action de grâce
a) L´action de grâce (qui s´exprime surtout dans la Préface) : le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l´œuvre de salut ou pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps.
L'acclamation
b) L’acclamation : toute l´assemblée, s´unissant aux puissances d’en haut, chante le Sanctus. Cette acclamation, qui fait partie de la Prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre.
L'épiclèse
c) L’épiclèse : par des invocations particulières, l´Église implore la puissance de l’Esprit Saint, pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c´est-à-dire deviennent le Corps et le Sang du Christ, et pour que la victime sans tache, qui sera reçue dans la communion, profite au salut de ceux qui vont y participer.
Le récit de l'Institution et la consécration
d) Le récit de l’Institution et la consécration : par les paroles et les actions du Christ s´accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué à la dernière Cène lorsqu’il offrit son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux Apôtres et leur laissa l´ordre de perpétuer ce mystère.
L'anamnèse
e) L´anamnèse : en accomplissant l’ordre reçu du Christ Seigneur par l´intermédiaire des Apôtres, l´Église fait mémoire du Christ lui-même, célébrant principalement le mémorial de sa Passion bienheureuse, de sa glorieuse Résurrection, et de son ascension dans le ciel.
L'offrande
f) L’offrande : au cœur de cette mémoire, l´Église, surtout celle qui est actuellement ici rassemblée, offre au Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L’Église veut que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tache, mais encore qu´ils apprennent à s´offrir eux-mêmes et soient parfaitement réunis, de jour en jour, par la médiation du Christ, dans l´unité avec Dieu et entre eux, pour qu´à la fin Dieu soit tout en tous.
Les intercessions
g) Les intercessions : on y exprime que l´Eucharistie est célébrée en union avec toute l´Église, celle du ciel comme celle de la terre, et que l´offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenus par le Corps et le Sang du Christ.
La doxologie finale
h) La doxologie finale : elle exprime la glorification de Dieu ; elle est ratifiée et conclue par l’acclamation du peuple : Amen.
Les rites de communion
Réf. PGMR 80-89
80 Puisque la célébration eucharistique est le banquet pascal, il convient que, selon l´ordre du Seigneur, son Corps et son Sang soient reçus par les fidèles bien préparés comme une nourriture spirituelle. C’est à cela que tendent la fraction et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la Communion.
L'raison dominicale (Notre Père)
81 Dans l’oraison dominicale, on demande le pain quotidien qui, pour les chrétiens, évoque surtout le pain eucharistique, et on y implore la purification des péchés, pour que les choses saintes soient vraiment données aux saints. Le prêtre prononce l’invitation à la prière, tous les fidèles disent celle-ci avec le prêtre, et le prêtre seul ajoute l´embolisme que le peuple conclut par la doxologie. L’embolisme, qui développe la dernière demande de l’oraison dominicale, demande pour toute la communauté des fidèles la libération de l’emprise du mal.
L´invitation, la prière proprement dite, l’embolisme et la doxologie par laquelle le peuple conclut cet ensemble, sont chantés ou dits à haute voix.
Le rite de paix
82 Vient ensuite le rite de la paix : l’Église implore la paix et l´unité pour elle-même et toute la famille humaine, et les fidèles expriment leur communion dans l’Église ainsi que leur amour mutuel avant de communier au sacrement.
En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, la façon de faire sera décidée par les Conférences des évêques, selon la mentalité et les us et coutumes de chaque peuple. Il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et uniquement à ceux qui l’entourent.
La fraction du pain
83 Le prêtre rompt le pain eucharistique, aidé, le cas échéant, par le diacre ou un concélébrant. Le geste de la fraction, accompli par le Christ à la dernière Cène et qui a donné son nom à toute l’action eucharistique à l´âge apostolique, signifie que les multiples fidèles, dans la communion à l´unique pain de vie, qui est le Christ, mort et ressuscité pour le salut du monde, deviennent un seul corps (1 Co 10, 17). La fraction commence après le rite de la paix, et se fait avec le respect qui s’impose, en évitant de le prolonger sans nécessité ou de lui donner trop d’importance. Ce rite est réservé au prêtre et au diacre.
Le prêtre rompt le pain et met dans le calice une parcelle de l’hostie pour signifier l’unité du Corps et du Sang du Seigneur dans l’œuvre du salut, c’est-à-dire le Corps du Christ Jésus vivant et glorieux. L’invocation Agnus Dei (Agneau de Dieu) est ordinairement chantée par la chorale ou le chantre, et le peuple y répond ou bien elle est dite à haute voix. Cette invocation accompagne la fraction du pain et peut donc être répétée autant de fois qu´il est nécessaire jusqu’à ce que le rite soit achevé. La dernière fois, elle est conclue par les mots : Dona nobis pacem ; Donne-nous la paix.
La communion
84 Le prêtre, par une prière à voix basse, se prépare à recevoir avec fruit le Corps et le Sang du Christ. Les fidèles font de même par une prière silencieuse.
Puis le prêtre montre aux fidèles le pain eucharistique, au-dessus de la patène ou du calice, et les invite au banquet du Christ ; en même temps que les fidèles, il fait un acte d´humilité, en reprenant les paroles évangéliques indiquées.
85 Il est très souhaitable que les fidèles, comme le prêtre est tenu de le faire lui-même, reçoivent le Corps du Seigneur avec des hosties consacrées au cours de cette même célébration et […] qu´ils participent au calice, afin que par ces signes mêmes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au sacrifice actuellement célébré.
86 Pendant que le prêtre consomme le Sacrement, on commence le chant de Communion pour exprimer par l´unité des voix l´union spirituelle entre les communiants, montrer la joie du cœur et mettre davantage en lumière le caractère « communautaire » de la procession qui conduit à la réception de l’Eucharistie. Le chant se prolonge pendant que les fidèles communient. Mais il s’arrêtera au moment opportun s’il y a une hymne après la communion.
On veillera à ce que les choristes aussi puissent communier commodément.
87 Pour le chant de communion, on peut prendre soit l’antienne du Graduale romanum, avec ou sans psaume, soit l´antienne avec son psaume du Graduale simplex, ou un autre chant approprié approuvé par la Conférence des évêques. Le chant est exécuté soit par la chorale seule, soit par la chorale ou le chantre avec le peuple.
S´il n´y a pas de chant, l´antienne proposée dans le Missel peut être dite soit par les fidèles, soit par quelques-uns d´entre eux, soit par un lecteur ou, à défaut, par le prêtre, après avoir lui-même communié et avant qu’il ne distribue la communion aux fidèles.
88 Lorsque la distribution de la Communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si cela est opportun, prient en silence pendant un certain temps. Si on le décide ainsi, toute l´assemblée pourra aussi exécuter une hymne, un psaume, ou un autre chant de louange.
89 Pour achever la prière du peuple de Dieu et conclure tout le rite de Communion, le prêtre dit la prière après la Communion, dans laquelle il demande les fruits du mystère célébré.
A la messe, on dit une seule prière après la communion, qui se termine par la conclusion brève qui est :
– si elle s’adresse au Père : Per Christum Dominum nostrum ; Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ;
– si elle s’adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin : Qui vivit et regnat in saecula saeculorum ; Lui qui règne pour les siècles des siècles ;
– si elle s’adresse au Fils : Qui vivis et regnas in saecula saeculorum ; Toi qui règnes pour les siècles des siècles .
Le peuple fait sienne cette oraison par l’acclamation Amen.
-
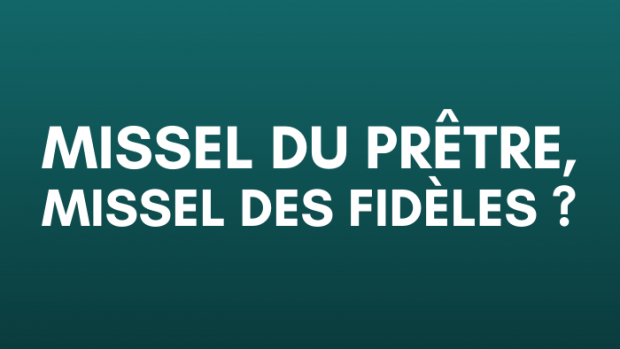
Missel du prêtre, missel des fidèles ?
Qu’il soit improprement appelé le livre du prêtre ou déployé dans de multiples éditions à destination de tous les fidèles, le missel veut faire naître la prière eucharistique de l’Église.
-

Du bon usage de la liturgie : la préparation des dons
Comme les habitudes sont difficiles à perdre ! En 1969, le Missel romain de Paul VI a remplacé « l'offertoire » par « la préparation des dons ». Et pourtant, que disons-nous qu'il va se passer à la messe lorsque la prière universelle est achevée et que l'assemblée s'assied ?
-

Chanter lors de la présentation des dons : éclairage et proposition de répertoire
Chant d'assemblée, chant choral, déploiement instrumental : comment accompagner par la voix et la musique le moment de la présentation des dons au cours de la célébration eucharistique ? Quelques mots sur la place du chant d'offertoire et une proposition de répertoire de chants à adapter à la couleur liturgique.
-

La communion pour les personnes allergiques au gluten
Le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle est régulièrement consulté au sujet de la communion pour les personnes allergiques au gluten (maladie cœliaque). Cette note veut donc apporter quelques éclaircissements dans le but d'aider les pasteurs et les personnes concernées par cette maladie et faciliter leur accès à a communion eucharistique.
-

L’encens dans la liturgie
Cette intervention de Marie-Odile Lalo concluait la formation nationale du département Fleurir en liturgie de mars 2016. Dans le précédent article traitant du sens de la mission des personnes chargées du fleurissement de l’espace liturgique, l’accent est mis sur sept actions caractérisant cette mission. Nous voudrions maintenant dégager trois fondamentaux de « Fleurir en liturgie ».
-

Orfèvrerie liturgique : dans l’atelier de Jacques Schwarz
Pénétrer dans l’atelier de Jacques Schwarz, artisan en orfèvrerie liturgique depuis plus de quarante ans, c’est d’abord découvrir toutes les étapes de la transformation d’une feuille d’argent en calice ou en patène.
Les ressources de l’Église
-
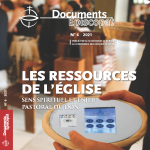
L’offrande de messe : les ressources dans l’Eglise
Quelques points de repère pour conduire le chant de l'assemblée. Au cours des célébrations, on voit souvent intervenir, face aux fidèles, non seulement le prêtre et les lecteurs, mais aussi une personne qui invite l’assemblée à chanter.
-

La quête : les ressources dans l’Eglise
Article extrait du Document Episcopat n°6 - 2021 sur la quête, ressource pour l'Eglise
-

Le casuel : les ressources dans l’Eglise
Article extrait du Document Episcopat n°6 - 2021 sur le casuel, ressource pour l'Eglise
-
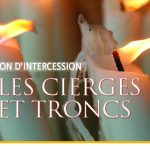
Les cierges et troncs : les ressources dans l’Eglise
Article extrait du Document Episcopat n°6 - 2021 sur les cierges et troncs, ressources pour l'Eglise
-

« Le Seigneur soit avec vous », les quatre salutations de la célébration eucharistique
« Lorsque le chant d’entrée est fini, le prêtre, debout à son siège, fait le signe de la croix avec toute l’assemblée. Ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l’Eglise rassemblée. » (Présentation générale du Missel romain, n° 50) Ce dialogue nous est familier et, par quatre fois, la célébration eucharistique le met en œuvre.
-

Faire mémoire …
Quand vous êtes allés à la messe, quelques fois seulement ou des milliers de fois peut-être, vous avez obéi à Jésus qui prescrit de « faire cela en mémoire de lui ». Peut-être en avez-vous retiré un bienfait ? Peut-être vous n’avez pas pu mettre de mots sur ce qui s’est passé en vous !
-

Les acclamations : l’anamnèse
Par Serge Kerrien, diacre du diocèse de Saint-Brieuc-Tréguier et conseiller pastoral au SNPLS. Le prêtre vient de dire ou de chanter le récit de l'Institution. Il poursuit en invitant l'assemblée à proclamer le mystère de la foi. Nous sommes au cœur de la liturgie eucharistique : c'est l'anamnèse.
-

Prières eucharistiques : Joseph mentionné à la suite de Marie
La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrement a émis le 1er mai 2013 un décret disposant que dans les prières eucharistiques II, III et IV du Missel romain, sera désormais mentionné Joseph à la suite de Marie : depuis toujours les fidèles manifestent une dévotion constante et ininterrompue envers saint Joseph, l'époux chaste de la Mère de Dieu et patron de l'Eglise entière, au point que Jean XXIII demanda au cours du concile que son nom soit ajouté au Canon romain.
-

Outils pédagogiques pour chanter avec le Missel romain
Le Missel romain, dans sa troisième édition typique, encourage les célébrants à chanter les dialogues, acclamations et prières de la messe et à cantiller la prière eucharistique et en particulier la préface. Voici une liste de vidéos pédagogiques[...]
-

Catéchèse du pape : Le Notre Père et l’eucharistie
Chers frères et sœurs, bonjour ! Nous poursuivons nos catéchèses sur la Sainte messe. Lors de la dernière Cène, Jésus prit le pain et la coupe, il rendit grâce à Dieu, et nous savons qu’ensuite il « rompit le pain ». À cette action correspond, dans la liturgie eucharistique de la messe, la fraction du pain. Elle est précédée de la prière que le Seigneur nous a enseignée, le « Notre Père »
-

Le Notre Père dans les rites de communion
Dans la célébration de la messe, la communion apparaît comme l’aboutissement de toute la célébration et le sommet de la participation des fidèles. Elle est préparée par un ensemble de rites qui n’empiètent pas les uns sur les autres, mais forment une suite ordonnée préparant et anticipant ce que la communion va réaliser : faire de fidèles divers et variés un seul corps, celui du Christ.
-

Mise en oeuvre du Notre Père dans la liturgie eucharistique
Dans la liturgie eucharistique, le Notre Père ouvre les rites de communion. Comme il est situé entre la doxologie chantée de la prière eucharistique et le chant de l’Agneau de Dieu, il est bon de s’interroger sur la pertinence ou non de le chanter et, si on le chante, sur le choix des formes musicales qui conviennent.
-
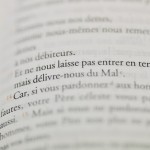
Le Notre Père : prière des fils, prière des frères
Par l'équipe PLS du SNPLS Lors de leur dernière assemblée plénière fin mars, les évêques[...]
-
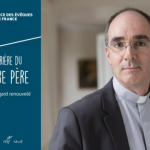
« Notre Père qui es aux cieux », un regard de Mgr Percerou
Par Monseigneur Laurent Percerou, Évêque de Moulins, Président du Conseil pour la Pastorale des enfants et des jeunes Ces quelques lignes sont extraites du commentaire du premier verset du Notre Père paru dans l'ouvrage La prière du Notre Père. Un regard renouvelé aux éditions[...]
-
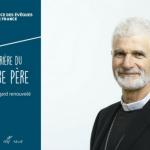
« Que ton règne vienne », un regard de Mgr Jacques Blaquart
Ces quelques lignes sont extraites du commentaire du troisième verset du Notre Père paru dans l'ouvrage La prière du Notre Père. Un regard renouvelé aux éditions Bayard, Cerf et Mame en novembre 2017.
-

« Que ta volonté soit faite », un regard de Mgr Dognin
Ces quelques lignes sont extraites du commentaire du troisième verset du Notre Père paru dans l'ouvrage La prière du Notre Père. Un regard renouvelé aux éditions Bayard, Cerf et Mame en novembre 2017.
-
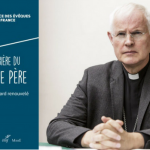
« Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour », un regard de Mgr Carré
Que dit cette demande ? Avec cette demande commence la deuxième partie du Notre Père, celle qui s'intéresse aux besoins fondamentaux de l'être humain sur terre. Cette demande paraît toute simple à première vue. en fait, elle est particulièrement complexe.
-
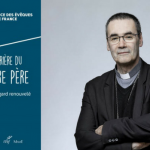
« Pardonne-nous nos offenses », un regard de Mgr Habert
Par Monseigneur Jacques Habert, Évêque de Séez, en charge de la Pastorale du monde rural au sein du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles Ces quelques lignes sont extraites du commentaire du sixième verset du Notre Père paru dans l'ouvrage[...]
-
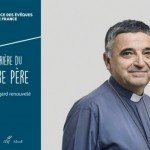
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation », un regard de Mgr Lebrun
Par Monseigneur Dominique Lebrun, Évêque de Rouen, Membre de la Commission épiscopale de Pastorale Liturgique et Sacramentelle Ces quelques lignes sont extraites de l'ouvrage La prière du Notre Père. Un regard renouvelé paru aux éditions Bayard, Cerf et Mame en novembre 2017. L'épreuve[...]
-

« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Note exégétique.
La demande « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ») a remplacé la formule « Ne nous soumets pas à la tentation » dans la nouvelle traduction liturgique du Notre Père entrée en vigueur le premier dimanche de l’Avent 2017. Cet article reprend une « note exégétique » publiée dans le numéro 289 de la revue la Maison-Dieu paru octobre 2017.
-

« Mais délivre-nous du mal », un regard de Mgr Leborgne
Délivre-nous du mal : délivre-nous du repliement et de l'enfermement sur nous-mêmes qui conduit à la mort, délivre-nous de notre refus de nous laisser aimer, délivre-nous de croire que nous serions à nous-mêmes notre propre source, ce qui ne peut qu'engendrer violence et désespoir, délivre-nous de croire que tu ne serais pas Pèr
-

Accueillir une nouvelle manière de prier le Notre Père
Le dimanche 3 décembre 2017 signait l’entrée dans une nouvelle année liturgique. À cette occasion, le Père Marc Boulle a prononcé une homélie dans laquelle il annonça que l’Avent 2017 inaugurait une nouvelle manière de prier le Notre Père.
-

Prier le Notre Père : pour que son règne advienne
Par le père Philippe Loiseau. Le temps de l’Avent est particulièrement approprié pour redécouvrir la prière du Notre Père. De même que l’Avent oriente l’Église vers l’avènement définitif du Règne de Dieu en tension avec le temps présent, de même les sept demandes du Notre Père sont reliées entre elles par un double dynamisme en opposition :
-

L’école du Notre Père
Dieu est si loin, Dieu est tout proche ! Le croyant navigue entre ses deux affirmations, sans doute à l’instar de toute personne humaine qui s’interroge en vérité sur sa relation à Dieu.
-

Notre Père et éthique
Pour bien situer la dimension éthique du Notre Père, il faut avoir à l’esprit que son registre propre est la prière, et non l’éthique. Cependant quelques points communs les rapprochent.
-

Les rites de communion : leur déroulement selon la PGMR
L’art de célébrer, tome 2, Aide‑mémoire des animateurs (Cerf, collection « Guides Célébrer » 10) fournit toujours des repères précieux pour la préparation ou la réalisation de la célébration, en prenant appui sur la Présentation générale du missel romain (PGMR) et sur l’expérience dans la recherche d’un art de célébrer la liturgie.
-

Le geste de paix à la messe, ABCdaire liturgique
Lorsque des participants peu habitués à la liturgie entendent l'invitation : « Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix », certains sont surpris. Ils ne savent ni la raison du geste, ni la manière de le poser. Peut-on les aider à en saisir la portée ?
-

Dans la liturgie, des attitudes
Chacun le sait d’expérience : la liturgie n’est pas spéculative. Elle est action qui s’adresse au baptisé dans toutes ses dimensions humaines : esprit, cœur et corps. Dans l’action liturgique, le chrétien s’engage tout entier et les gestes qu’il pose, les attitudes qu’il prend le conduisent à la contemplation.
-

La messe, chemin vers la paix que Dieu donne
On célèbre parfois des prières pour la paix. Mais toute messe est signe de la paix que Dieu donne aux hommes, et en même temps un chemin pour éduquer à cette paix.
-

La liturgie nous éduque à vivre en frères
Le motif principal qui conduit Paul à adresser sa première lettre aux Corinthiens tient aux conflits qui minent la communauté en prière : « Puisque j'ai commencé à vous faire des critiques, je ne vous félicite pas pour vos réunions : elles vous font plus de mal que de bien.
-

La fraction du pain et sa signification
« La nuit qu'il fut livré, Jésus rompit le pain » (1 Co 11, 23). Après sa résurrection, raconte Luc, les disciples le reconnurent à la fraction du pain (Lc 24, 35). Qu'en est-il de ce geste si significatif qui guérira les disciples de leur aveuglement ? Pourquoi un tel décalage entre cet événement et nos célébrations où la fraction du pain passe si souvent inaperçue ? En a-t-il toujours été ainsi ?
-

La fraction du pain : origine, sens, mise en oeuvre
Imaginons que la messe n’ait pas de nom ou que l’on veuille lui en donner un autre, et que l’on fasse, à cet effet, une enquête auprès des chrétiens, un dimanche matin, à la sortie des églises : « Monsieur ..., Madame ..., êtes-vous baptisé(e) ? - Oui ! - Quel nouveau nom donneriez-vous à la messe ? » Il n’est pas sûr que « Fraction du pain » sortirait une seule fois ! Et pourtant ...
-
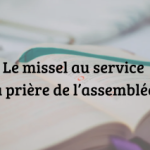
Agneau de Dieu, qui enlèves « les » péchés du monde
Des petits changements ouvrent parfois de grands débats. Il en est ainsi de l’Agnus Dei dans la nouvelle traduction du Missel romain en usage
-

Des Ordinaires pour des temps liturgiques précis
Avent, Temps de Noël, Carême, Temps pascal ... la question d’avoir des Ordinaires propres à des temps liturgiques donnés mérite d’être posée. Mais avant, il convient tout d’abord de s’entendre sur le terme « Ordinaire » lui-même.
-

« Heureux les invités … » : la procession de communion
Entendre chaque dimanche l’interpellation reprise du livre de l’Apocalypse, « Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau », nous engage dans une démarche à la fois ecclésiale et spirituelle, communautaire et personnelle.
-

Catéchèse mystagogique pour la première des communions
En cette période de l’année où est encore majoritairement célébrée la « première des communions » des enfants – mais aussi celle des jeunes et des adultes – nous vous proposons des points d’appuis pour intégrer une catéchèse mystagogique dans le cadre de la célébration de ce sacrement.
-

La place du chant de communion
« Pendant que le prêtre consomme le sacrement, on commence le chant de communion ... » (PGMR n° 86) L'habitude de chanter pendant la communion est très ancienne. Depuis les tout premiers siècles, le chant d'un psaume accompagnait la procession de communion.
-

Vivre en communion : aller porter la communion
Vous trouverez ici un guide pratique pour aller porter la communion aux malades, afin de rester en communion en dehors de la messe.
-

Catéchèse du pape : « Appuyons-nous sur l’Eucharistie »
Au sein du cycle de catéchèses données par le pape François sur les étapes de la messe et l’eucharistie, cette catéchèse portait sur la communion au corps et au sang du Christ et la prière après la communion. Le pape François nous invite à nous appuyer sur l’Eucharistie : « c’est recevoir Jésus qui nous transforme en lui, qui nous rend plus forts ».
-

Eucharistie et partage
Le sujet abordé sous ce titre est devenu vraiment « classique », si ce n’est banal. Le fait qu’il ait été si souvent traité a du moins le mérite d’indiquer qu’il ne s’agit pas là d’une affaire annexe du point de vue de la foi chrétienne. Pourtant, entre les affirmations théologiques, même les plus fortement exprimées, et leur imprégnation dans la vie des communautés chrétiennes, il y a une belle distance : celle qui sépare, jusqu’à la contradiction parfois, les paroles et les actes. Rappelons en tout cas les principales dimensions théoriques du rapport entre l’eucharistie et le partage, c’est-à-dire aussi, plus largement, entre la liturgie et la vie chrétienne, ou encore entre le rite et l’éthique.
-

En dehors de la messe, vivre la communion et la fraternité, comment ?
On s’en souvient, le contexte épidémique a eu des conséquences sur les dispositifs pastoraux qui concernent l’assemblée dominicale, la célébration de l’eucharistie et l’accès à la communion.
-

Vivre la « communion spirituelle » : repères pour le discernement
24 mars 2020 - Comment discerner la question de la « communion spirituelle » lorsque les fidèles n’ont plus accès à la communion sacramentelle ? En raison des décisions de confinement prises pour lutter contre le coronavirus, (...)
-

De l’autel comme « seuil »
Dans un ouvrage sur la messe publié en allemand pendant la deuxième guerre mondiale1, Romano Guardini, un des fondateurs du Mouvement Liturgique allemand, mettait en lumière deux figures de l'autel : « la table » (ch. IX), mais aussi « le seuil » (ch. VIII).
-

Quel espace liturgique pour les églises ?
Par le Père Bernard Klasen, curé de la paroisse de Ville d’Avray, docteur en philosophie et spécialiste d’art sacré et d’architecture religieuse, et professeur à l’Institut[...]
-

L’autel dans le culte chrétien : quelques rappels historiques
Par Norbert Hennique « Comme une source, la table du Seigneur est placée au milieu de l’église, afin que, de toutes parts, la[...]
-
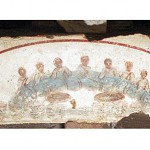
Les figures de l’autel en régime chrétien
Héritages : Le monde gréco-romain où s’implante le christianisme au début de notre ère connaît des autels nombreux et variés. L’autel est l’élément central de la vie de la famille et de la cité, depuis le petit brûle-parfum domestique où l’on sacrifiait quelques grains d’encens jusqu’au monumental autel de Pergame avec ses sculptures impressionnantes.
-

Le siège, l’ambon, l’autel … et les autres
Par Claude Duchesneau Avant même de faire le tour de toutes les questions liturgiques, c’est-à-dire théologiques et pratiques, concernant l’autel, il faut dire une chose[...]
-

L’évangéliaire et l’autel
On peut être surpris lorsque, en tête de la procession d’entrée, on voit un diacre ou un lecteur porter l’évangéliaire et le déposer non pas sur l’ambon mais sur l’autel. Cette manière de faire est conforme à la Présentation générale du missel romain (PGMR) :
-

L’autel, une oeuvre d’art ?
L’autel est lié à l’institution du lieu. Il est disposé non pas tant pour être vu que pour instituer l’être-là de celui qui se tient et regarde, de près ou de loin, et qui reçoit de cet autel même son implication de présence et la forme gracieuse du lien qui le tient à lui-même et à autrui, comme en creux, ou en abyme : place des places. Invitation à soi, ah alio.
L'offrande eucharistique
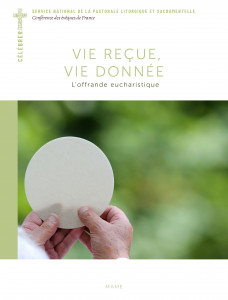
Liturgie domestique
L'autel, lieu de la célébration